
 |
Recherche
|
 |
abonnement Comité de Rédaction et remerciements |
La promotion des recherches sur l'évaluation des Psychothérapies n'est plus seulement un enjeu scientifique. Elle est devenue ces dernières années une nécessité d'ordre éthique et épistémologique. De plus, les polémiques récentes, sur les projets de loi successifs d'encadrement de l'activité psychothérapique en France, ont encore mieux mis en lumière la nécessité d'une réflexion sur le fait psychothérapique, les conditions de sa mise en œuvre, les mécanismes par lesquels il opère et les moyens de mettre en évidence ses résultats.
Il apparaît clairement que la fonction thérapeutique du dispositif relationnel et des modalités techniques utilisées dans les échanges interpersonnels doivent être un objet d'études scientifiques au même titre que les autres moyens thérapeutiques utilisés pour soulager et aider les malades.
Or, on sait depuis longtemps que les faits psychologiques sont mesurables, même d'une façon imparfaite et approximative, et que les changements induits par les psychothérapies peuvent être quantifiés suivant plusieurs domaines, certes emprunts de subjectivité mais pour lesquels nous disposons de moyens d'opérationalisation.
Il s'agit par exemple de l'amélioration symptomatique, de l'amélioration des relations interpersonnelles, de l'efficience professionnelle, de la capacité de satisfaction sexuelle, ou encore de la capacité à faire face à des conflits interpersonnels.
Chacun sait que nos sociétés modernes exigent de façon impérative qu'un minimum d'objectivation soit apportée à l'appui d'une pratique sociale dont le coût est de toute façon assumé par la collectivité.
Mais au delà de cette exigence, les questions scientifiques posées par l'évaluation des psychothérapies correspondent en fait au véritable défi scientifique du 21ème siècle qui est, il me semble, de progresser dans la connaissance des bases neurobiologiques du fonctionnement mental humain.
Des travaux comme ceux de E. Kandel, dont il est question dans ce numéro, ou de G. Edelman et G. Tonini, peut-être mieux connus en France à l'heure actuelle, offrent un cadre de référence intéressant pour confronter certains concepts psychologiques et psychanalytiques avec les données de la biologie.
Mais indépendamment de ces paradigmes d'intégration scientifique qui peuvent donner des grilles d'analyse intéressantes pour des phénomènes observés en psychothérapie, il paraît impératif de développer des moyens des recueil de données et d'évaluation des processus impliqués dans le travail psychothérapique.
C'est un des objectifs que s'est assigné l'association "Psychanalyse et psychothérapie" fondée depuis quelques années avec D. Widlocher et A. Braconnier, afin de promouvoir plus particulièrement des recherches sur l'application de la psychanalyse aux psychothérapies. Cette association essaie de contribuer au développement des méthodes de recherche destinées à l'étude des processus de traitement, des critères de jugement clinique, des modes d'évaluation des résultats des psychothérapies et plus particulièrement de préciser le rôle de la psychanalyse dans le développement des psychothérapies. Des ateliers et séminaires scientifiques périodiques permettant des travaux de recherche dans ce domaine sont régulièrement tenus, visant à développer un courant porté par cette exigence à la fois épistémologique et éthique de l'évaluation.
Pour la Recherche apporte des éclairages intéressants sur cette question.
D. W - Le débat, c’est au fond : Quelle est l’utilité pour la psychanalyse de développer des recherches empiriques ? C’est-à-dire, des recherches dont la programmation est faite à l’avance, avec des hypothèses, une méthodologie, un soutien matériel pour établir cette recherche. Des recherches pour lesquelles on voit ensuite si, d’une part, les hypothèses ont été vérifiées et si, d’autre part, elles ont été utiles. C’est la recherche planifiée, la recherche programmée.
Certains collègues pensent que les travaux sur le processus analytique ou ses résultats seraient indispensables pour le progrès de la pratique. Peut-être, mais je n’en suis pas certain. Si les psychanalystes comptent sur des recherches empiriques pour atteindre ce progrès, ce n’est pas suffisant. Ils doivent compter aussi sur leur propre recherche clinique, c’est-à-dire sur la mise en cause de leur pratique. La psychanalyse, avant d’être une science, est une pratique. C’est une pratique de soin, qui vise à la transformation de la vie psychique des personnes qui se lancent dans ce processus, une pratique de communication. C’est une manière d’échange. Le patient parle, le psychanalyste parle, c’est une parole avec deux ou plusieurs esprits : un esprit qui pense, associe, et un esprit qui prolonge le travail associatif du premier (le travail interprétatif du psychanalyste). C’est une co-associativité, une pensée à deux qui se développe et qui est essentiellement nourrie par la relation qui s’établit entre les deux (cela renvoie aux concepts de transfert et de contre transfert). C’est une pratique de communication, comme je le disais plus haut. Comme toute pratique, elle articule des modèles. Pour moi, un modèle, qui est donc une base de la méthode, suppose une théorie, une technique et une clinique. Par exemple, quand Freud écrit l’interprétation du rêve, il nous propose d’abord une technique : si vous laissez associer votre patient, son rêve se décompose et ces objets de décomposition donnent naissance à de nouveaux objets de connaissance sur le rêve, qui constituent non plus le contenu manifeste mais le contenu latent. Là-dessus, s’est construite une théorie, la théorie freudienne du rêve. Freud présente ce processus comme une procédure. Si vous faites le même travail psychique que moi sur le rêve, vous trouverez les mêmes objets de connaissance, vous ferez la même observation et vous aurez ainsi une théorie.
JM. T - Pourquoi utiliser le terme de modèle ? Théorie, technique, objet de connaissance, c’est la clinique.
D. W - Oui, c’est la clinique. La psychanalyse forme, comme un tout, un modèle. Mais ce modèle est un emboîtement de modèles. Par exemple, si l’on prend un concept comme la notion d’identification projective, voilà un nouveau modèle : si vous entendez des mécanismes d’identification comme une projection venant de vos patients et si vous l’interprétez comme telle, vous constaterez certains effets. Autrement dit, M. Klein propose un petit modèle qui s’emboîte dans le grand. Ce modèle, on peut s’en servir ou ne pas s’en servir. Si l’on n’a aucun intérêt pour ce concept, on ne s’en servira pas. Les écoles de psychanalyse créent des petits modèles, des modèles plus partiels que celui de la méthode elle même.
JM. T - S’agit-il d’une question d’école ou pensez-vous que la question se pose à un moment ou à un autre, avec tel patient avec lequel on utilise tel modèle ou tel autre ?
D. W - Il y a quelques années, on se demandait s’il y avait des théories différentes en fonction des praticiens. Les patients nous conduisent à utiliser plutôt tel ou tel modèle. C’est comme cela que l’on évolue soi-même et que l’on élargit sa palette. On sent qu’un modèle est plus pertinent qu’un autre par rapport à un instant d’une situation clinique. La pluralité des modèles en psychanalyse n’est pas du tout, contrairement à ce que l’on dit souvent, le reflet de querelles, d’ignorance ou d’exclusion. C’est un instrument de progrès, à condition de ne pas tomber dans la polémique et de les faire travailler les uns avec les autres par rapport au cas. Le progrès clinique scientifique en psychanalyse est cette logique de découverte qui implique un affinement et une complexification des modèles.
Ce n’est pas une démarche unique, propre à la psychanalyse. De ce point de vue, il s’agit d’une méthode, d’une démarche que l’on retrouve dans ce que l’on peut appeler les sciences de la modernité. La pédagogie, l’économie, la politique (par exemple) se construisent sur le même type. Quand un chef de gouvernement convoque des économistes pour discuter de ce que l’on va faire et qu’il entend une dispute entre partisans de telle ou telle théorie, il va assister à une présentation de modèles. Ces modèles s’appuient sur des vérifications. Keynes a peut-être eu raison avec le New Deal de Roosevelt, mais il a peut-être eu tort quand Churchill a rétabli l’étalon or. Ce sont des modèles qui fonctionnent à un certain moment, pour une certaine science. Je pense que les sciences dites de l’action humaine (cf. Lacan, EMC, La cure type), que l’on appelle sciences sociales ou sciences humaines, s’appuient toutes sur la diversité et la confrontation des modèles, modèles qui s’appuient fondamentalement sur les pratiques. Je pense que c’est important à rappeler avant que l’on aborde le problème des recherches empiriques.
Ces pratiques sociales, je ne vais pas m’étendre, sont irréfutables. Popper a raison. Il n’y a pas de vérification empirique. On sait bien que les économistes n’ont jamais rien démontré par expérience. Ils proposent des modèles théoriques des faits que les pratiques humaines développent. A ce stade là, les psychanalystes ne peuvent pas démontrer qu’une théorie, comme la théorie kleinienne est meilleure qu’une autre. Il n’y a pas de vérification, de valeur de vérité dans une assertion que l’on fait, mais il y a une valeur de cohérence, une valeur de consensus. C’est-à-dire que l’on s’aperçoit que les notions peuvent être largement utilisées, d’une manière ou d’une autre. Ce qui compte, c’est la reconnaissance publique. On peut parler avec quelqu’un d’autre qui va dire : « Moi, ce dont tu parles, cela me fait sens, cela m’évoque quelque chose ». Ce n’est pas, cela ne devrait pas être, un consensus mou. On est dans telle école, on pense telle chose. Il y a un effort à faire. L’effort est de dire dans quelle mesure on reconnaît l’utilité d’un tel modèle. Quand les gens ont commencé à utiliser le modèle du rêve, ils ont dit : “Cela me fait sens, ça me parle et en effet, je m’aperçois que cela marche“.
JM. T - Il y a deux niveaux dans ce que vous dites. Il y a : « Cela me fait sens » et il y a le fait que « Cela marche ». C’est quand même mis à l’épreuve de la clinique. Imaginons que quelqu’un ne retrouve jamais l’assertion dans la clinique. Devrait-il attendre de la trouver et en attendant, se contenter que cela fasse sens pour lui ?
D. W - Vous avez raison, il y a deux niveaux différents. Dans « Cela marche », il y deux choses : ça marche me donne une intelligibilité de ce qui s’est passé entre ce patient et moi, mais ce n’est pas suffisant. Avec des raisonnements comme cela, on aboutirait à des comportements sectaires. Il suffirait que le patient et le thérapeute soient d’accord. C’est intelligible entre eux, mais cela ne débouche sur aucun changement personnel. L’intelligibilité n’est pas suffisante. Il faut qu’il y ait une certaine efficacité pratique. On se heurte là à quelque chose de beaucoup plus grave, c’est la lenteur et la difficulté avec lesquelles la plupart des psychanalystes peuvent tester l’efficacité même de leur travail et l’opportunité d’utiliser tel ou tel modèle. Cela se fait progressivement, mais avec la lenteur que l’on retrouve dans les pratiques sociales. Cette lenteur se retrouve dans la pédagogie. On met des années avant de changer de méthode pédagogique. Rien ne la démontre. C’est l’usage qui fait que telle ou telle méthode va être abandonnée ou utilisée progressivement. La psychanalyse n’est pas la seule démarche qui utilise des vérifications empiriques lentes et qui repose davantage sur le consensus que sur des démonstrations.
JM. T - Est-ce que cela ne correspond pas à une histoire des mouvements scientifiques ? Il y a eu une période de grands découvreurs et il y a aussi des périodes qui suivent où il s’agit plutôt de valider les connaissances et de les approfondir que de faire de grandes découvertes.
D.W - C’est peut-être la question que l’on peut poser à la psychanalyse. J’ai le sentiment que la période des grands créateurs est passée. Je me trompe peut-être. Il y a eu un moment de créativité, avec une exploitation des différentes tendances que chacun a tirées à soi pour constituer une école latérale. Mais aujourd’hui, les psychanalystes sont beaucoup plus préoccupés de confronter les modèles que de les combattre. On entre dans l’ère du débat et le problème sera de savoir débattre. Je ne suis pas sûr que les psychanalystes sachent réellement comment débattre dans la confrontation des modèles. C’est peut-être aussi là qu’il y a, à côté de la confrontation des modèles, une place pour la recherche empirique dont nous allons parler maintenant.
La découverte clinique peut-elle être validée par la preuve empirique ? Voilà la question qui est posée maintenant.
La méthodologie, on la connaît : on va s’exposer directement à l’épreuve des faits, à partir d’une hypothèse. Mais il y a quelque chose de fondamental dans la recherche empirique. Je dis empirique parce que c’est vraiment l’usage, bien que le mot me déplaise car la clinique est aussi empirique, mais c’est comme cela. Dans cette recherche programmée, il y a toujours une réduction. Les cliniciens ont du mal à l’accepter. On ne prend pas le problème dans sa totalité. On le découpe, on prend une démarche arbitraire. C’est toujours la grande réserve des cliniciens « Vous n’avez pas pris en compte ceci ou cela, c’est beaucoup plus compliqué ». Mais la recherche naturaliste, la recherche qui consiste à tester une hypothèse et à rechercher des données qui vont la confirmer ou non, cette méthode est toujours une réduction. Il faut le savoir et en prendre la mesure dans les résultats.
Peut-être pouvons nous parler maintenant de ces recherches empiriques. Elles portent sur un certain nombre d’objets. Je pense que le principal est celui des effets thérapeutiques obtenus. On commence à avoir vraiment des résultats intéressants à ce sujet, mais probablement va-t-il falloir répondre à la question : « Etes vous sûr que vous comparez les mêmes choses ? Vos thérapeutiques sont-elles vraiment les mêmes ? Vous les définissez par des éléments très superficiels : nombre de séance, longueur, etc., est-ce suffisant ? ». L’étude des processus sera peut-être essentielle demain. Mais nous n’en sommes pas là. Ce dont il s’agit, c’est ce qui concerne les effets thérapeutiques. Il ne s’agit plus de démontrer que la psychanalyse sert à quelque chose. Il s’agit de savoir à qui elle sert, comment elle sert, quelles sont les méthodes qui peuvent le mieux assurer un résultat. C’est un problème d’indication et de moyens. Il faut cadrer les recherches plutôt que d’essayer de démontrer que la psychanalyse sert à quelque chose. C’est une affirmation qui repose sur une telle complexité que cela n’a pas de sens.
JM. T - L’Association Internationale de Psychanalyse a réalisé un document1 où ont commencé à être recensées les recherches planifiées en psychanalyse. Ce recensement a distingué sept grands types d’études. C’est un découpage un peu artificiel, car une étude peut évidemment s’inscrire dans plusieurs chapitres, mais il permet de positionner un peu les choses. Sont ainsi distinguées :
- les études de cas ;
- les études naturalistes pré, post et quasi expérimentales : par exemple, l’étude de R. Sandell menée en Suède ;
- les études de suivi : par exemple l’étude menée en Allemagne par M. Leuzinger-Bohleber et col. et une étude prospective menée par AM. Sandler et col. au centre Anna Freud sur les résultats de la psychanalyse et de la psychothérapie chez l’enfant et les effets qui peuvent être retrouvés chez l’adulte ;
- les études expérimentales : on peut rappeler l’étude de P. Fonagy et G. S. Moran à propos de l’effet de la psychanalyse dans l’évolution d’un diabète chez un enfant (il s’agit d’une étude de cas unique) ;
- les études de processus : ce sont des études qui sont assez compliquées à concevoir, car il s’agit de repérer dans un processus global des éléments particuliers, d’arriver à les décrire et d’en déterminer l’action (en faisant intervenir des fractions de temps) avec, comme exemple, l’étude de Jones ;
- les études de processus et de résultats, avec pour exemple l’étude sur le rêve de M. Leuzinger-Bohleber et H. Kächele ;
- les études sur la psychothérapie avec implications pour la psychanalyse.
D. W - Quelques remarques à ce sujet. La classification proposée a un peu l’inconvénient de mélanger le terrain, les objectifs et les méthodes.
JM . T - Pouvez-vous préciser la notion de fidélité inter juges et le concept de juge, qui peuvent se prêter à des glissements de sens ?
D. W - Le concept de juge est utilisé pour parler de la fidélité entre les évaluateurs, entre les observateurs. C’est s’assurer que les différents observateurs vont bien noter la même chose. Nous faisons actuellement une étude sur les indications de la psychothérapie. Nous avons passé des années sur cette notion de fidélité. On s’apercevait que certaines réponses nous semblaient plus théoriques ou plus cliniques. Il y a eu la nécessité d’un long entraînement. Mais c’est extrêmement positif et intéressant. Les juges sont des collègues. Par exemple, dans l’étude allemande, une cinquantaine de psychanalystes ont étudié les données émanant de cent autres psychanalystes qui rapportaient les cas. Ces cinquante psychanalyses ont fait un travail énorme de confrontation de l’évaluation, donc une étude sur la fidélité de jugement qui était considérable.
JM. T – Cela veut dire qu’à la fin, sur une réalité du même ordre, ils doivent avoir des jugements du même ordre ?
D. W - Oui, ils doivent avoir des jugements du même ordre, ou du moins l’écart entre jugements ne doit pas être trop grand.
J’ai pensé qu’il pouvait être intéressant d’évoquer deux recherches qui ont été présentées à Paris.
La première est une recherche suédoise présentée par R. Sandel2 il y a trois ans dans le cadre des activités de l’Association Psychanalyse et Psychothérapies (APEP) montée pour réaliser des recherches dans ce domaine.
L’organisme de sécurité sociale de Stockholm a payé pendant trois ans des traitements qui étaient pratiqués par des praticiens, non médecins, installés en libéral. Après ces trois ans, si les personnes souhaitaient continuer, elles devaient trouver une autre source de financement. Très rapidement, cet organisme a vérifié quels étaient les effets de ce programme thérapeutique (94-96). L’étude avait pour but de réaliser une évaluation des cas en termes de nature, de gravité des troubles, et de bien être. Il s’agissait en même temps d’interroger les cliniciens qui avaient traité ces patients pour qu’ils donnent un avis sur leur type de pratique dans ces cas. Les cas (environ 700) traités ont été étudiés, mais certains d’entres eux avaient terminé le traitement, d’autres n’avaient pas commencé, d’autres étaient en cours de traitement. Cela a permis de comparer, en remettant tout le monde ensemble, des personnes qui n’avaient pas commencé, alors que d’autres avaient terminé ou étaient en cours de traitement. C’est une grande astuce méthodologique qui a permis d’égaliser les effets, alors que c’est une difficulté majeure dans le domaine des suivis : si on n’est pas suivi au même moment, comment comparer ? D’autre part, ils n’avaient pas fixé de règles techniques : les patients allaient voir qui ils voulaient pour faire tel type de traitement ou tel autre. Ils ont fait beaucoup de travaux sur ce matériel. Je voudrais simplement mentionner quelques résultats intéressants.
Première partie de l’étude - Le résultat principal est qu’ils ont comparé les effets de deux types de psychothérapies selon la fréquence des séquences : psychothérapies avec moins de trois séances par semaine et psychothérapies, pratiquement psychanalytiques, avec trois séances par semaine ou plus (3, 4 ou 5). Ils ont pu observer de façon très significative, en étudiant les patients un an, deux ans, trois ans après, et en faisant l’addition, que si, dans le début des suites d’un traitement, les effets étaient les mêmes selon la fréquence des séances, à plus long terme (à 4 et 5 ans de suivi), ceux qui avaient eu un traitement intensif avaient des meilleurs résultats que ceux qui avaient eu un traitement avec un nombre moins important de séances. La fréquence du traitement avait un effet sur une population générale. Cette constatation était basée sur des critères de bien être, mais aussi sur des critères objectifs : nombre de consultations par an, consommation de médicaments, journées de travail, etc.
Deuxième partie de l’étude - ils ont demandé aux cliniciens : « Pensez-vous que vous avez pratiqué une psychothérapie centrée sur les symptômes avec attitude active avec vos patients ou bien pensez vous avoir pratiqué une écoute et une activité interprétative de type psychanalytique ? » Comme ils avaient dans leur groupe, d’une part, des psychanalystes et, d’autres part, des psychothérapeutes formés dans des instituts, dont un certain nombre n’avaient jamais pratiqué pour eux-mêmes la psychanalyse, ils avaient différentes méthodes. Dans les psychothérapies avec une fréquence faible des séances, ils ont montré que les résultats étaient nettement meilleurs avec les thérapeutes ayant une attitude active. Ceux qui, parmi les psychanalystes, pratiquaient une écoute psychanalytique pure et rigoureuse au rythme de 1 ou 2 séances par semaine avaient de moins bons résultats que ceux qui avaient une attitude active. C’est un résultat très important car nous avons à déplorer combien de psychothérapies à 1 ou 2 séances sombrent dans le néant, alors que l’on veut singer une pratique qui aurait des effets à 3 ou 4 séances par semaine.
JM. T - Cela confirme qu’il y a une sorte « d’effet dose » de la psychothérapie, mais que cet effet dose est lié aussi à l’engagement du thérapeute et à son interaction avec le patient. L’efficacité de la séance en dépend.
D. W - L’engagement du thérapeute n’est pas forcément seulement lié à son statut professionnel, mais à la manière dont il entend travailler avec son patient. Le psychanalyste peut avoir une attitude très active dans une situation et pas dans une autre.
JM. T - Est-ce que cela n’implique pas une interrogation théorique sur l’indication d’un travail de type associatif dans certains cas et plutôt centré sur l’interaction dans d’autres ?
D. W - On peut dire aussi que l’activité peut être plus centrée vers le monde externe et, dans d’autres cas, davantage vers la réalité interne du patient. Cette étude est quand même une étude très globale. Il faudrait reprendre les résultats. Ce genre d’étude coûte cher. Il y a deux difficultés : payer un nombre important de cliniciens et de chercheurs qui vont travailler avec les praticiens et, d’autre part, avoir l’accord des praticiens. La sécurité sociale a vu aussi que cela coûtait plus cher de bien soigner les gens. Cela correspondait à 700 patients et 313 thérapeutes, dont 150 environ étaient membres d’écoles de psychanalyse et l’autre moitié était constituée de psychothérapeutes formés dans un institut de formation de psychothérapeutes d’inspiration très psychodynamique.
L'étude montre que cela coûte plus cher de bien soigner, mais cela montre aussi qu’une pratique plus active est plus efficace.
Nous sommes dans un domaine où tout est à faire. Cette étude ouvre une méthodologie. Elle est évidemment encore très limitée, mais demain, faisons en France cette étude et nous verrons bien quelles difficultés nous allons rencontrer.
JM. T - C’est une démarche sur laquelle insiste beaucoup le document de l’API : l’idée est de pouvoir utiliser des recherches qui ont été difficiles à mettre en place au niveau méthodologique et de réfléchir comment les répliquer, ou encore de développer des recherches complémentaires à partir d’une première expérience.
D. W - C’est le B. A. BA, dans le domaine de la recherche en général, vous en conviendrez. Effectivement, l’appliquer en psychanalyse serait très bien.
La deuxième recherche est plus récente : elle concerne les effets à long terme d’une psychanalyse et d’une thérapie psychanalytique intensive dans le cadre d’une société psychanalytique3. Il s’agit en l’occurrence d’une société allemande (une des deux grandes sociétés de psychanalyse en Allemagne). Cette étude a consisté à interroger un nombre important de personnes ayant eu une psychanalyse ou une psychothérapie analytique assez longue et à se renseigner sur un certain nombre de critères objectifs. Cela était possible parce que cette étude était subventionnée par la sécurité sociale allemande et que celle-ci avait des données concernant le nombre de jours d’hospitalisation, le nombre de jours d’arrêt de travail, la consommation de médicaments, la façon dont ces personnes traitées avaient bénéficié du traitement, etc. De l’autre côté les psychanalystes qui avaient pratiqué ces traitements étaient également interrogés.
La manière de faire a été la suivante : ils ont envoyé à un très grand nombre de psychanalystes la proposition que cette étude soit faite. Les psychanalystes ont pris contact avec d’anciens patients qu’ils avaient suivis. Il y avait au moins 4 ans d’écart entre la fin du traitement et le moment où le clinicien écrivait ou donnait l’adresse de son patient pour lui demander s’il était d’accord pour répondre à un questionnaire et accepter un entretien sur ce qu’il pensait du traitement qu’il avait suivi.
Il y avait donc, d’une part, un accord des cliniciens pour proposer des noms et demander à leurs anciens patients leur participation, et d’autre part, un accord attendu des patients. Sur les 600 membres de l’institution, il y en a eu 2 à 300 qui ont accepté de se prêter à ce jeu, ce qui est quand même considérable ; parmi les patients, il y a eu finalement 400 réponses positives. Il y avait une quarantaine de cliniciens-chercheurs. Il n’était pas question d’avoir un entretien avec 400 personnes. Il y a donc eu un tirage au sort, avec un groupe qui a été l’objet d’entretiens, groupe composé d’une part de patients et d’autre part, éventuellement, de thérapeutes. Pour les autres, il y a eu simplement une enquête.
Ce qui est intéressant dans cette étude, dont l’exploitation des données est d’ailleurs encore actuellement en cours, c’est qu’elle a été à la fois quantitative et qualitative. (voir schémas)
J’ai choisi trois schémas. Le premier présente la méthodologie générale, le second illustre la démarche quantitative et le troisième la démarche qualitative. C’est une étude très solide du point de vue épidémiologique, avec d’un côté les coûts d’assurance, le nombre de jours à l’hôpital, d’arrêt de travail, et d’autre part des auto observations des patients qui ont donné leur version de ce qu’avait été pour eux leur traitement. Et de l’autre côté, des éléments d’évaluation de la part des cliniciens.
JM. T - Les éléments diagnostiques ont-ils été réunis avant la cure ou après ?
D. W - La sélection diagnostique a eu lieu après. Elle ne pouvait pas avoir lieu avant puisque c’était un groupe de personnes qui avaient accepté. La population n’était homogène que pour avoir été en traitement depuis plus de 4 ans pour une psychanalyse ou une psychothérapie intensive et pratiquée par un membre de l’association qui se prêtait à cette étude.
JM. T - Les chercheurs-cliniciens qui ont mené l’étude ont-ils pu retrouver le diagnostic a posteriori ?
D. W - Il y avait des problèmes de confidentialité. Les cliniciens qui allaient voir les patients n’étaient jamais ceux de la même ville. On envoyait quelqu’un de Francfort pour des entretiens avec des patients qui habitaient Hambourg ou Munich, ou vice-versa. En plus, cette quarantaine de cliniciens-chercheurs, qui ont procédé aux entretiens avec les patients et les cliniciens, ont fait un très grand travail de mise en commun des évaluations pour voir s’ils avaient bien les mêmes critères de jugement pour arriver à dégager des données fiables en terme de fidélité.
On est devant un travail qui peut être immédiatement applicable, enrichissant la pratique clinique et qui permettrait pour d’autres travaux de procurer des critères.
JM. T - Ont-ils développé des outils pour évaluer ces trois dimensions ?
Ils n’en sont pas encore là. Ces trois dimensions ont été dégagées à partir d’une analyse de contenu des entretiens des patients et des thérapeutes. C’est là où la fidélité inter juges était très importante. Ils ont énormément travaillé sur la définition de ces critères d’évaluation qui pouvaient être relativement fiables. Maintenant, il va falloir trouver des échelles ou des critères qui permettraient d’objectiver un petit peu mieux ces dimensions.
JM. T. J’espère que cela va donner des idées à nos collègues français. Cela paraît relativement simple à réaliser.
D. W - Le problème, c’est que les cliniciens soient d’accord, qu’ils se prêtent à ce type de recherche. En France, actuellement, je ne suis pas sûr que si l’on demandait à des cliniciens que leurs patients aient des entretiens et s‘expriment sur leur traitement, ils accepteraient. Cela serait considéré comme une atteinte à la confidentialité du malade et à celle du travail du clinicien.
On est devant des résistances importantes ici, dont il faut tenir compte.
JM. T - Est-ce qu’une des grandes difficultés des cliniciens à s’engager dans la recherche n’est pas liée au sentiment de l’immensité de la tâche ? Le fait d’avoir des exemples où cela fonctionne, où les résultats ne sont peut-être pas complets, mais donnent des indications intéressantes, ne peut-il pas avoir un effet d’entraînement ?
D. W - Parmi les réticences des cliniciens, il y en a deux qui sont importantes. C’est d’une part le fait qu’ils ont peu de temps à consacrer à la recherche. De ce fait, ils ont hâte d’avoir des résultats. Or la recherche est une longue patience. Il faut prendre son temps et il ne faut pas être ambitieux quand on fait des recherches. Pour les cliniciens qui ont déjà peu de temps à y consacrer, il est lourd de se lancer dans des études qui n’apportent pas, très rapidement, des résultats satisfaisants intellectuellement. Ce n’est pas la même chose pour celui qui va tous les matins dans son laboratoire de l’hôpital Pasteur et qui a cinq ans pour finir sa recherche. Le chercheur biologiste s’intéresse beaucoup plus à la recherche qu’au résultat. Il aime la recherche pour la recherche. Le clinicien aurait envie d’avoir des résultats tout de suite et la recherche pour la recherche, cela ne l’intéresse pas beaucoup.
Le deuxième point est que l’on se heurte en France à un souci du secret personnel, de l’intimité, et à une sauvegarde très individuelle du travail. Il y a là une résistance dont il faut tenir compte.
Vous avez sélectionné d’autres recherches comme exemples...
JM. T - Oui, cinq études que je vais présenter succintement.
- Une étude de P. Fonagy et M. Target menée au Centre Anna Freud (adresse site : http://www.annafreudcentre.org/) qui a eu un rôle pilote au niveau de la recherche en psychanalyse. Elle aborde une double question que l’on se pose souvent : quel sera l’effet d’un traitement mené chez l’enfant, quand la personne sera devenue adulte ? Est-ce que l’intervention psychanalytique durant l’enfance interviendra comme une protection ? Il s’agit d’une grande étude projective de suivi de jeunes enfants (200) qui ont été traités par un traitement psychanalytique intensif, une psychothérapie simple (1 ou 2 séances par semaine), ou n’ont pas été traités. Les mesures incluent l’adaptation chez l’adulte, le profil psychiatrique, l’attachement, des entretiens sur la façon de gérer les événements de vie et toute une information rétrospective sur la façon dont les gens vivent. Cela rejoint l’étude précédente, avec le fait que l’on a une étude qui prend en compte l’action chez les enfants. La recherche est en cours mais les résultats actuels sont prometteurs sur la valeur à long terme d’un traitement psychanalytique réussi dans la prévention des troubles chez l’adulte.
Il est dommage que des actions analogues ne soient pas faites en France, où il y a tant de choses intéressantes qui sont faites au niveau de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et qui se perdent, faute de suivi.
- Une seconde étude, celle de Moran et Fonagy sur Sally, cette petite fille qui avait un diabète qui n’était pas équilibré. Ce qui est très intéressant, c’est que l’on part de choses qui sont très « basales » : une enfant dont, malgré de nombreuses tentatives éducatives, alimentaires et de tous ordres, on n’arrive pas à équilibrer le diabète. L’hypothèse est que la résolution d’une partie de ses conflits va améliorer sa compliance. C’est l’aspect macroscopique de cette étude. Il est déjà intéressant car, en deux ou trois ans, l’équilibre du diabète est réalisé. Sachant que ce diabète peut avoir une implication vitale et fonctionnelle extrêmement grave, c’est un résultat important.
Deux autres recherches intéressantes concernent l’étude des processus. Il s’agit de décrire de façon un peu précise la question du diagnostic et les actions qui se produisent au cours de la cure.
- La question du diagnostic est abordée avec l’instrument classique de L. Luborsky qui est un moyen pour le clinicien de repérer très rapidement le problème majeur que la personne rencontre dans ses relations avec les autres et de voir comment ce « conflit relationnel central » peut se modifier à partir du moment où il s’actualise dans le transfert et le contre transfert. Instrument modeste mais intéressant, qui montre que l’on peut dégager des outils cliniques à partir de la recherche.
- La question des interactions et de leurs effets entre le psychothérapeute et le patient a été abordée par Jones suivant un protocole assez compliqué (cf. PLR n° 25). Cette étude part de l’observation de la cure d’une femme déprimée. Les séances sont enregistrées (audio et video). Pour chacune d’elles, les juges vont utiliser une centaine de cartes qui sont descriptives : « le thérapeute intervient beaucoup », « la patiente sourit », etc. Les juges vont classer ces cartes en considérant quels sont les jugements les plus pertinents. Le début de cette cure est assez « classique », avec peu d’interventions du thérapeute. Pendant toute une période, la situation est assez immobile. A un certain moment, et sans doute de façon tout à fait inconsciente, le clinicien s’aperçoit que cela ne fonctionne pas très bien ; il devient beaucoup plus intervenant et modifie sa conduite. Une évolution s’ébauche alors très rapidement dans la cure. Cette étude fait également apparaître que l’interaction a des effets dans les deux sens, en particulier sur les affects dépressifs que pouvait ressentir le thérapeute par rapport à une interaction négative de sa patiente.
- Dernière étude, réalisée par des collègues allemands, M. Leuzinger-Bohleber et H. Kächele. L’idée est que l’on va retrouver dans les rêves non seulement les conflits que les personnes rencontrent mais également la façon dont elles les résolvent ou ne les résolvent pas. C’est très intéressant de prendre le rêve comme un indicateur du fonctionnement psychique d’une personne et de ses capacités d’établir un certain type de relation avec le monde et ses objets, de repérer les problèmes qu’elle rencontre et les stratégies qu’elle adopte pour les résoudre. La psychothérapie a été évaluée à partir du repérage des modalités d’action et de résolution ou non des problèmes par le patient et de leur évolution.
D. W – Le moment est venu de conclure et je voudrais répondre à votre question sur le rapport de la psychanalyse avec les neurosciences. Je ne crois pas beaucoup à des études de confrontation, car la psychanalyse explore la vie psychique à un degré de complexité qui pour l’instant excède très largement nos approches du cerveau. S’il ne fait pas de doute qu’il n’y a de pensée que la psychanalyse explore qui ne soit quelque part inscrite dans un neurone (c’est une question de conviction philosophique), en dehors de cela je ne pense pas qu’il y ait véritablement pour l’instant un débat, sauf peut-être dans certains champs particuliers. Je pense au domaine du rêve précisément, où il est intéressant de voir si les productions oniriques sont les mêmes en fonction, par exemple, des différentes étapes du sommeil. Ce sont des choses intéressantes, mais relativement ponctuelles.
J.M. T. - Voici un commentaire récent sur la psychanalyse et j’aimerais avoir votre avis à ce sujet : « Trop de psychanalystes s’en tiennent à une position défensive et isolationniste ...
C’est moi qui ai écrit cela. C’est ma manière de taquiner un peu mes collègues.
Ouverture ne signifie pas forcément compromission. Je préconise une attitude active de présence et de démonstration de la présence. Je pense qu’il faut développer des recherches épistémologiques et méthodologiques, montrer l’importance de la recherche clinique et également la possibilité de développer des recherches dites empiriques, réductrices sans doute mais qui sont utiles et qui ont l’avantage de nous mettre en position de débat avec les sciences voisines.
Références bibliographiques
2. Sandell, R., Blomberg, A., Lazar, A., Schubert, J., Carlsson, J., Broberg, J., (Novembre 1998). As time goes by Long-term outcome of psychoanalysis and long-term psychotherapy. Traduction de l’exposé invité à la conférence « Problèmes méthodologiques posés par l’évaluation des psychothérapies pàsychanalytiques et de la psychanalyse », organisée par l’APEP, l’Association de Santé Mentale du XIIIème arrondissement de Paris, et le Département de Psychatrie de la Salpétrière.
3. Leuzinger-Bohleber, M., Kächele, H. (1988). From Calvin to Freud: Using an artificial intelligence model to investigate cognitive changes during psychoanalysis. In H. Dahl, H. Kächele, H. Thomä (Eds.), Psychoanalytic process research strategies (pp. 291-306). Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo : Springer.
4. Thurin JM., Thurin M., Tieder-Kaminsy S., Kaminsky P., Grümbach A., Widlöcher D.., Analyse descriptive et comparative des rêves au cours d’une psychothérapie. Fonctions du rêve, relations au conflit central du patient, évolution. Étude de faisabilité d’une méthodologie clinique en sciences cognitives appliquée au domaine de la psychopathologie. Rapport CNEP 94 CN 40 - INSERM. http://Psydoc-fr.broca.inserm.fr/EPS/rechreve/rechreve1.html
L’Association Psychanalytique Internationale a engagé une importante réflexion et un état des lieux sur la recherche en psychanalyse. Il en est advenu un document « An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis » préparé par le comité « Recherche » à la demande du président et coordonné par P. Fonagy.
L’ensemble, complété d’une bibliographie, constitue un ouvrage d’environ 350 pages qui peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.ipa.org.uk/research/dl.htm
Ouvrons donc la porte, puisque nous y sommes conviés. Le document comprend cinq parties : introduction ; arrières plans épistémologiques (francophone et anglophone), stratégique et méthodologique (sections A, B, C et D) ; abstracts ; description précise des études menées ; résumé avec conclusion.
La présentation des recherches est donc introduite par un débat épistémologique contradictoire, dans lequel les études rapportées ont été mises de côté. Ce débat met en relation les points de vue de Roger Perron et de Peter Fonagy. Le premier y présente un brillant résumé des réserves que les psychanalystes pourraient avoir à propos des investigations empiriques sur leur travail. Le second appuie ses réflexions épistémologiques sur une implication déjà ancienne et importante dans la recherche empirique en psychanalyse. Sa perspective est prolongée par la justification stratégique des études d’efficacité en psychanalyse et par une première approche de quelques-unes des questions méthodologiques propres à la recherche en psychothérapie, particulièrement sensibles en psychanalyse. Les principales questions du débat sont résumées ci-dessous.
La deuxième grande partie du document présente un grand nombre d’études, concernant le traitement psychanalytique, conduites en Europe et en Amérique du Nord au cours des dernières décades. On y retrouve naturellement celles qui sont présentées dans l’article précédent. Cet espace est conçu comme une ressource de données et ne prétend pas, selon P. Fonagy, être davantage qu’une collection de résumés de travaux menés par des chercheurs psychanalystes. Il n’a pas pour objet, par exemple, de produire un corpus intégré de la recherche évaluative ni d’offrir des conclusions concernant l’efficacité de la psychanalyse comme forme de traitement des troubles mentaux. Des revues de cet ordre sont disponibles ailleurs.
L’impression générale qui ressort à la lecture de ce rapport est que le mouvement est amorcé, que les questions sont posées. Les exemples présentés devraient intéresser chaque psychanalyste, dès lors qu’il se sent concerné par les effets thérapeutiques de sa pratique.
Arrière plan épistémologique
Dans la section A, Roger Perron présente le point de vue francophone sur les problèmes de la recherche psychanalytique1.
Dans un rappel de l’état de la question au sein de l’IPA, qui a lancé un grand chantier avec l’objectif de réunir « une réponse organisée, cohérente et crédible aux affirmations fréquentes selon lesquelles il n’y a pas de preuves de l’efficacité de la psychanalyse ou des thérapies d’orientation psychanalytique », l’auteur fait part de ses réserves sur la conception de la recherche qui prévaut dans ce mouvement (méthodologie et théorie). La psychanalyse française est partagée depuis ses débuts sur deux notions de « l’efficacité » et à partir de là sur deux courants. Le premier s’appuie sur la tradition médicale dont le but essentiel est de soigner des troubles psychiques (des maladies ?) ; le second (dans un contexte plus « humaniste ») vise à favoriser un meilleur développement personnel. Pour R. Perron, le mouvement « recherche » de l’A.P.I. est engagé dans une voie qui suppose une « scientificité » parfois bien naïve quand aux vues théoriques (sur le processus de la cure par exemple), à la méthodologie (procédures quantitatives) et à la pratique (enregistrements de séances d’analyse).
Les arguments les plus forts concernant le caractère illusoire d’une recherche planifiée sont sans doute que, selon R. Perron, la psychanalyse porte sur des « faits psychanalytiques », que c’est la théorie qui prime dans la constitution et la construction des faits psychanalytiques et que l’histoire des théories se fait en général au niveau politique bien plus que sur des critères « scientifiques » dont nous ne disposons pas.
D’autres réflexions portent sur :
Ce sont donc finalement, des éléments d’ordre très différents qui sont avancés et qui conduisent à ce que :
En définitive, le texte initialement très négatif par rapport à la démarche de recherche réserve ce jugement à la cure psychanalytique classique et suggère l’institution de Commissions recherche au niveau des régions et des sociétés elle-mêmes. Il s’agirait également de mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer les vues, les assises théoriques et épistémologiques, les objectifs de recherche, les méthodes et les implications pour la pratique. JM. T.
Dans la section B du document de l’IPA, Peter Fonagy, présente son point de vue concernant les problèmes liés à la recherche psychanalytique. Contrairement à Roger Perron, l’argumentaire de Fonagy n’est que le reflet d’une réflexion engagée par une minorité de psychanalystes anglo-saxons. Cependant, comme l’annonce l’auteur de l’avant-propos : « Il n’est pas impossible qu’il y ait du changement dans l’air ».
La présentation de Fonagy est un texte dense, de plus d’une trentaine de pages. Il explore les problèmes épistémologiques rencontrés dans la recherche en psychanalyse et, pour chacun d’entre eux, il propose les solutions ou orientations méthodologiques qui pourraient nous permettre d’y remédier.
Le premier de ces problèmes, selon Fonagy, concerne l’absence de prise en compte par les analystes des travaux effectués par leurs collègues. En effet, en analysant le nombre de fois qu’un article paru dans l’International Journal of Psychoanalysis est cité dans d’autres journaux psychanalytiques, il constate un vrai déclin au cours des années. Selon lui, « c’est là que se situe le déclin d’intérêt pour la psychanalyse. Pour les autres psychanalystes ». La conséquence de ce phénomène est simple. L’absence d’intérêt des psychanalystes pour les travaux de leurs contemporains, laisse peu de place à une accumulation de la connaissance. Chacun, selon son centre d’intérêt, va développer des projets de recherche spécifiques, appuyés, certes sur les classiques, mais dans des orientations différentes. « Cette fragmentation et cette absence confuse d’hypothèses partagées constituent le socle de ce que Fonagy appelle – l’inévitable disparition de la psychanalyse ». Le premier défi sera donc, pour les psychanalystes, de développer des objets communs.
Le second problème épistémologique concerne la méthodologie. Selon Fonagy, les cliniciens psychanalystes utilisent des inférences inductives pour construire et tester leurs théories cliniques. Cependant, une question se pose : même si des observations passées, souvent très nombreuses, tendent à soutenir les arguments inductifs, « qu’est-ce qui garantit qu’ils continueront à le faire ? ». L’observation de co-occurrences passées possède une faible valeur prédictive. Pour imager son propos, il propose l’exemple suivant : « Bien que nous sachions que les mauvais traitements sur des enfants peuvent provoquer des dysfonctionnements comportementaux, cela ne veut pas dire que cela sera inévitablement le cas ». Selon Fonagy « le point central ici, est que la fonction clé de la théorie, pour les praticiens, est d’expliquer les phénomènes cliniques. En d’autres termes, c’est plus un système heuristique qu’un outil qui permet une véritable déduction ». Trois conditions devraient être réunies afin que la recherche clinique soit un socle méthodologique adéquat pour construire la théorie psychanalytique. Il serait nécessaire d’avoir « (a) un lien logique étroit entre la théorie et la pratique, (b) un raisonnement déductif approprié en relation avec le matériel clinique et (c) il serait nécessaire d’utiliser des termes non ambigus ».
Plus précisément : (a) l’existence d’un lien logique entre la pratique et la théorie psychanalytique, ne peut être démontrée. Six exemples peuvent être donnés. Tout d’abord, la technique psychanalytique s’est construite, selon Freud lui-même, grâce à une succession d’essais et erreurs. Ensuite, il semble impossible de mettre en évidence « une relation réciproque entre la technique psychanalytique et quelque cadre théorique majeur que ce soit ». Par ailleurs, le fait que, dès les premiers congrès internationaux sur la psychanalyse - et tout particulièrement ceux de l’IPA - les avis aient divergé sur la façon dont le psychanalyste travaille, laisse penser que la pratique n’est pas logiquement occasionnée par la théorie. De plus, toujours selon Fonagy, la théorie et la pratique ont progressé à des niveaux très différents. Cette différence permet d’envisager une relative indépendance entre ces deux activités. Dans un même ordre d’idée, un seul volume publié par Freud concerne la technique contre vingt-deux consacrés à la théorie. Enfin, dernier argument, la recherche clinique est « dirigée par ce qui est concrètement utile pour pratiquer, plutôt que par ce qui est vrai à propos du fonctionnement psychique. Aussi, le critère majeur pour mesurer la validité des découvertes en recherche clinique est contaminé par un ensemble de considérations sans souci d’exactitude ».
Ainsi, « l’isolement – auto-proclamé – de la psychanalyse de la médecine, tout comme des sciences psychologiques sont les deux obstacles majeurs qui interdisent à la psychanalyse d’avoir une place à la table de l’Académie du 21ème siècle ». Aucune des avancées faites en psychiatrie ne le fut sans problème. De nombreuses critiques peuvent être faites aux chercheurs en neurobiologie et en psychologie. Aucune théorie ne peut prétendre expliquer la totalité du comportement humain. Cependant, l’avenir de la psychanalyse passe, selon Fonagy, par une collaboration et non une confrontation des praticiens de la psychanalyse avec les chercheurs en psychologie et en neurobiologie.
Mais pourquoi vouloir faire de la psychanalyse une science ? Telle ne semble pas être la question pour Fonagy. Le rapprochement voulu avec la médecine et la psychologie n’oblige pas les psychanalystes à adopter tous les canons de la science contemporaine. Cependant, Fonagy, sans vouloir rester dans une place intermédiaire entre science et art, pose trois questions : « Quels sont les critères que la psychanalyse peut tenir sérieusement ? Et quels sont ceux qu’elle peut négliger ? Et qui décide lequel est lequel ? » Sans répondre définitivement à ces trois importantes questions, Fonagy propose dans un premier temps, au-delà de la question science-non science, d’adopter une attitude plus scientifique. Par exemple, il suggère de tester empiriquement les hypothèses à la base de la théorie psychanalytique. Faute de quoi, la psychanalyse se prive « du jeu croisé entre les données et la théorie qui a tellement contribué au développement de la science au 20ème siècle ». Cette première étape permettrait une meilleure définition - donc opérationnalisation - des concepts les plus importants de la théorie psychanalytique. Il suggère, par ailleurs, que le chercheur psychanalyste travaille sur des groupes d’individus (par exemple, une série de cas) et sur des processus mentaux spécifiques plutôt que des caractérisations descriptives globales. D’une façon générale, nous devons aussi envisager, pour chaque phénomène étudié, l’exploration d’explications alternatives, afin d’identifier celle qui sera la plus appropriée. « Par exemple, l’hostilité et la tendance destructrice des patients limites furent, selon le moment, attribuées à une agression constitutive, à l’attitude non-empathique des soignants, à des stratégies défensives de protection de soi, etc. On ne sait pas clairement si ces explications concurrentes devaient être appliquées à un même individu à différents moments, à des individus différents, ou si une seule de ces explications est correcte et doit être appliquée à tous les individus de la catégorie ». Par ailleurs, adopter une attitude scientifique dans le champ psychanalytique, même si l’on reconnaît à la psychanalyse une certaine compétence plus spécifique dans les phénomènes intrapsychiques, demanderait de développer des modèles interactionnistes incluant une réflexion sur les influences de l’environnement social au-delà des facteurs parentaux pendant les premières années de la vie. En d’autres termes, nous devons développer « des modèles développementaux psychanalytiques actuels, c’est-à-dire plus spécifiques, qui concerneraient les aspects transactionnels dans la genèse du traumatisme. » Par ailleurs, ces modèles développementaux devront tenir compte des facteurs culturels afin d’éviter tout ethnocentrisme.
1. Cette partie, a également été publiée en français dans le Bulletin de la Société psychanalytique de Paris, n° 50, juillet-Août 1998, p 39-51.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le parcours d’E. Kandel est un peu particulier. Psychiatre formé à une période où la psychanalyse était la référence quasi unique en psychiatrie, il est devenu chercheur en biologie. Ses travaux sur la mémoire lui ont valu le prix Nobel de Médecine en 2000.
La perspective proposée est double : réouverture du paradigme psychanalytique aux connaissances actuelles de la biologie ; dépassement du clivage entre perspectives herméneutique et scientifique de la psychanalyse. Ce second aspect impliquerait de se soucier davantage des conditions de recueil de données, de l’analyse des processus et de l’évaluation des effets des actions psychothérapiques. Il est largement abordé par P. Fonagy dans sa réflexion épistémologique (cf. article précédent).
Il s’agira donc ici plutôt de présenter l’esprit et les bases selon lequels la collaboration psychanalyse - neurosciences pourrait s’effectuer avec l’objectif de participer au grand défi du 21ème siècle : la constitution d’une véritable science de l’esprit.
La méthode proposée est de commencer par un éclairage réciproque. E. Kandel engage le dialogue et présente quelques-unes des connaissances actuelles - encore très rudimentaires - réunies par la biologie qui pourraient être utilisées pour ce projet. Trois concepts sont ainsi présentés comme points d’ancrage : la mémoire, le désir et la conscience, ainsi que huit domaines : 1) nature des processus mentaux inconscients ; 2) nature de la causalité psychologique ; 3) causalité psychologique et psychopathologie ; 4) expérience précoce et prédisposition à la maladie mentale ; 5) préconscient, inconscient et cortex préfrontal ; 6) orientation sexuelle ; 7) psychothérapie et modifications structurales dans le cerveau ; 8) psychopharmacologie comme adjuvant de la psychanalyse.
Les deux premiers seront succintement présentés, à titre d’exemple.
- Processus mentaux inconscients
D’un point de vue biologique, les processus mentaux impliquent deux grands types de mémoire, en étroite relation et interaction : la mémoire procédurale (inconsciente) et la mémoire explicite ou déclarative (consciente).
La première, constituée d’outils perceptifs et moteurs, implique différents systèmes du cerveau : les cortex sensoriels (signalisation), l’amygdale (états affectifs), le neostriatum (habitudes motrices et peut-être cognitives), le cervelet (apprentissage des comportements moteurs et d’activités associées). La seconde, constituée par la mise en mots, s’appuie sur l’hippocampe et les structures associées.
Cette distinction et présentation de structures neurologiques distinctes et associées, sous-jacentes aux processus mentaux inconscients et conscients, est d’abord complétée par un questionnement sur leurs éventuels rapports avec l’inconscient psychanalytique, tel qu’il a été utilisé par Freud dans ses derniers travaux avec sa distinction entre : inconscient dynamique (ça et conflits) ; partie inconsciente du moi, innaccessible à la conscience, mais ne corespondant pas à ce qui a été réprimé ou refoulé ; inconscient-préconscient, accessible par un effort d’attention et devenant conscient sous la forme de mots et d’images. La partie inconsciente du moi, directement concernée par les habitudes ainsi que par les outils perceptifs et moteurs, s’inscrirait sur la mémoire procédurale.
Mais le plus important pour le clinicien reste évidemment de savoir comment cette perspective descriptive pourrait avoir une incidence clinique et théorique. Elle rejoint le questionnement du biologiste qui s’interroge sur la façon dont certaines configurations de la mémoire peuvent s’organiser et se transformer. E. Kandel propose de porter une attention particulière au rôle de l’émotion dans les effets de la cure et se réfère aux travaux de D. Stern. Pour ce dernier, beaucoup des changements qui font progresser le processus thérapeutique durant une analyse ne se situent pas dans le domaine du déclaratif mais plutôt dans celui de la connaissance inconsciente procédurale (non verbale) où s’inscivent les « moments de signification » - moments d'interaction entre le patient et le thérapeute. Ceux-ci seraient à l’origine de la réalisation d'une nouvelle forme de souvenirs implicites qui permettraient à la relation thérapeutique de progresser à un niveau différent. Au delà, ils conduiraient à des changements dans le comportement et à des modifications dans les stratégies.
Poussant encore cette réflexion, E. Kandel se demande si les bases procédurales ne seraient pas impliquées également dans l’assimilation des règles morales, règles acquises presque automatiquement, comme les règles de grammaire qui gouvernent notre langage naturel.
Le troisième plan de la proposition générale de mise en interaction de la psychanalyse et de la biologie concerne les prolongements qui pourraient être envisagés d’une telle hypothèse. Ces études pourraient, à différents niveaux (comportemental, clinique et d’imagerie) étudier les différents composants d’un moment de signification et les effets qu’ils produisent.
De façon plus générale, l’observation indirecte par les symptômes et la clinique pourrait être complétée par une observation directe des systèmes sous-corticaux impliqués par la mémoire procédurale psychanalytique.
- Nature du déterminisme psychique
Le deuxième thème porte sur la façon dont deux événements sont associés dans l’esprit. L’idée centrale du déterminisme psychique est que chaque événement psychique se rapporte, de façon causale, à l’événement mental qui le précède. Mais cette relation se fait-elle uniquement par contiguïté et de quels événements mentaux s’agit-il ? Un élément important à prendre en considération est celui de la temporalité entre deux événements. En fait, cet intervalle de temps (inférieur ou supérieur à la demi-seconde) va déterminer la possiblité de penser le premier avant que ne survienne le second. Si cette possiblité existe, le système conscient sera impliqué dans les lectures ultérieures de réalités analogues, alors qu’il ne le sera pas dans le second, les fonctionnements inconscients et procéduraux devenant prévalents et ayant tendance à se renforcer par une véritable prédictibilité des enchaînements où la réaction précède et inhible la pensée. Cet abord peut être intéressant pour aborder certaines réponses immédiates à la réalité qui semblent par nature « impensables ».
On le voit, E. Kandel ouvre la voie à des questions théoriques et pratiques qui concernent quotidiennement les cliniciens, en les posant sous un angle nouveau. Une dimension de recherche est ouverte ...
[1] Eric R. Kandel. La biologie et le futur de la psychanalyse : un nouveau cadre conceptuel de travail pour une psychiatrie revisitée. Traduction par JM. Thurin de l’article paru dans l’Am J Psychiatry 1999; 156:505-524 (à paraître dans Evolution Psychiatrique, n°1, 2002)
Lors de la quatrième des réunions organisées à l’initiative du Comité d’interface INSERM/FFP, en 1997, le fonctionnement des deux seuls instituts de recherche européens consacrés spécifiquement à la psychiatrie avait été présenté : celui de l’Institute of Psychiatry de Londres par le Pr A. Man et celui de l’Institut Max Planck de Munich par le Pr F. Holsboer.
Nous venons de recevoir le Scientific report 1998-2000 du Max Planck Institue of Psychiatry, toujours dirigé par le Pr Holsboer. Sa lecture est particulièrement intéressante car elle montre en premier l’efficacité d’un organisme de recherche consacré à la seule psychiatrie et centré sur la clinique. Le M.P.I. est l’héritier du fameux Deutsche Forschungantalt Fur Psychiatrie, fondé en 1917 par le roi Louis III de Bavière à l’initiative d’Emil Kraeplelin lui-même (il a pris le nom du savant atomiste en 1945 après la période noire du régime nazi). Ce qui frappe à la lecture de ce rapport, est l’amplitude du champ exploré. Ne pouvant mentionner tous les travaux cités, indiquons qu’ils s’organisent selon huit grands axes : anxiété et dépression, dépendances et toxicomanie, troubles du sommeil, neurologie (soulignons que la recherche sur cette partie des neurosciences qui intéresse directement les maladies mentales s’effectue au Max Planck Institute of Psychiatry), neurodégénération, schizophrénie, neuroendocrinologie et enfin histoire de la psychiatrie. Il est prévu dans ce dernier domaine une édition d’oeuvres choisies d’Emil Kraepelin (l’édition des oeuvres complètes du fondateur de l’Institut parait hors de portée de ses chercheurs, étant donné leur ampleur), mais aussi l’histoire de la psychopharmacologie.
Dans tous ces domaines le M.P.I. développe une importante collaboration avec des chercheurs d’autres pays. Le seul regret que l’on puisse avoir est que les chercheurs français y sont peu ou pas associés. Mais ne faudrait-il pas pour cela que la France dispose de l’équivalent du Max Planck Institute of Psychiatry ?
La distinction entre efficacité potentielle (efficacy) et efficacité réelle (effectiveness)
Le premier terme concerne les résultats obtenus par un traitement dans le cadre d’une recherche, le second ceux d’un traitement en pratique courante. Cette distinction est nécessaire dès que l’on veut dégager des inférences causales à partir des relations observées entre différentes variables. Le problème est alors que le choix des variables ne se fasse pas au détriment d’autres variables essentielles comme le choix du traitement et son accessibilité par exemple. Autrement dit, certains résultats peuvent apparaître dans une situation parfaitement définie au niveau expérimental, qui ne se retrouveront pas dans la pratique courante et réciproquement. Ces problèmes se rencontrent de la même façon dans les essais de médicament qui peuvent parfaitement fonctionner dans des conditions d’observance idéale, mais qui peuvent cesser de le faire en pratique quotidienne à cause de leurs effets collatéraux qui feront que le patient « oubliera » de prendre régulièrement son traitement. La « validité externe » concerne la généralisation possible de la causalité observée et peut donc obéir à d’autres critères que ceux de la validité « interne » qui concernent la possibilité de tirer des conclusions à partir de la situation propre de la recherche.
La possible rémission spontanée
Des améliorations spontanées sont mesurables dans la plupart des troubles psychologiques (Bergin, 1971 ; Lambert, 1976 ; Subotnik, 1975). Cela ne veut pas dire qu’elles se font dans le même délai, ni qu’elles sont identiques dans leur résultat. Ainsi par exemple, des études naturalistes de suivi ont montré que des personnes présentant des « états limites » peuvent évoluer vers un syndrome de « burn out » à la cinquantaine. Ce n’est évidemment pas la meilleure solution.
Pour mesurer la différence d’effet, l’évolution des patients traités devrait idéalement être comparée à celle des patients semblables qui ne reçoivent aucun traitement. Mais c’est évidemment irréalisable pour des raisons à la fois pratiques et éthiques. On en vient ainsi à comparer l’efficacité de la psychanalyse soit à celle d’autres méthodes psychothérapiques, soit à celle d’un traitement de routine. Cette solution n’est que partiellement satisfaisante. On court en effet le risque dans le premier cas, de vouloir comparer à l’arrivée des pommes et des oranges, ou dans le second cas, de se trouver dans une situation de grande hétérogénéité avec le groupe de contrôle.
Dernière mise à jour : mercredi 11 juin 2003 16:18:38
Monique Thurin
Editorial - Jean-François Allilaire -
Recherche en psychanalyse : où en sommes-nous ?
Entretien entre D. Widlocher et JM. Thurin
- Le terrain, c’est : « Qu’est-ce que l’on va étudier ? Une population de malades ou deux populations différentes ? ». D’autre part, ce qui manque au niveau du terrain, c’est ce qui va porter sur la clinique elle-même.
- L’objet (l’objectif), c’est : « Qu’est ce que l’on va chercher ? » Une étude sur le processus est différente d’une étude sur le résultat. Il y a peut-être aussi des études possibles sur les connexions neurophysiologiques, des études de développement.
- Les méthodes, qui doivent répondre à trois exigences :
- Il est d’abord nécessaire qu’elles soient adaptées à l’objet. Par exemple, quand on va demander à des cliniciens de pratiquer une recherche sur leurs patients en comparant les résultats. Là, je pense qu’il faut vraiment que les cliniciens prennent conscience de l’importance de la méthode. S’ils veulent faire de la recherche un peu rigoureuse, se donner des hypothèses et avancer dans les échanges, il faut être sûr qu’ils utilisent la bonne méthode par rapport à l’objet qu’ils se donnent. Il y a actuellement un débat sur le cas unique. Un cas unique peut être très utile dans un cas et pas dans un autre. Ce n’est pas en soi un objet de valeur ou de non valeur. Vous citez l’étude de l’enfant diabétique de Moran et Fonagy. Il s’agit d’une petite fille présentant un diabète grave, qui était en psychothérapie à quatre séances par semaine et chez laquelle on a étudié un certain nombre de paramètres par rapport à ce qui se produisait dans le traitement. C’est très intéressant, mais cela ne prouve rien. C’est un cas unique qui apporte un certain nombre d’éléments dans un cas comme celui-ci, alors que si l’on veut savoir par exemple si la psychanalyse est utile pour la toxicomanie, ce n’est pas un cas unique qui va nous démontrer quoi que ce soit. La méthode est fonction de ce que l’on recherche.
- Il faut aussi que l’hypothèse soit réfutable. La réfutabilité est essentielle. Je pose toujours la question : « Est-ce que vous n’êtes pas certain de trouver ce que vous attendez ? Est-ce que vous pouvez trouver le contraire de ce que vous attendez ? Si vous n’en êtes pas certain, c’est possible, sinon ce n’est pas la peine ».
- Un troisième élément est la fidélité inter-juges. C’est très difficile. La recherche clinique est très dépendante de chaque clinicien. Pour réduire ce biais potentiel, il y a des astreintes. La recherche sur les médicaments implique nécessairement la fidélité inter-juges, pourquoi en serait-il autrement avec celle sur la psychanalyse ?
Enfin, un travail d’autocritique
La recherche n’est pas faite pour confirmer ou pour trouver ce que l’on souhaite prouver, mais pour découvrir.
La fréquence du traitement semblait donc jouer un rôle sur une population générale.
Il faudrait mieux spécifier aujourd’hui quelles sont les catégories de patients, du point de vue de la pathologie ou des catégories sociales.
Il y a des résultats épidémiologiques. D’un point de vue subjectif, dans l’ensemble, les gens étaient contents d’avoir été soignés. Mais il n’y avait pas que des gens qui étaient contents : il y en a aussi qui s’étaient aggravés ou ne constataient pas de changement. Il y a eu aussi des données objectives : le nombre de jours de maladie par an a très sensiblement diminué depuis l’analyse. En terme de démonstration des coûts vis-à-vis des organismes, les arguments ne sont pas nuls puisque les chiffres montrent que l’on est passé d’une durée moyenne de 10 jours d’absence, un an avant le traitement, à 6 jours un an après le traitement, et à 4 jours à la fin. Ce sont donc des données tout à fait significatives, vu le grand nombre.
Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont cherché aussi à faire des analyses qualitatives. Il ne s’agissait pas de décrire tous les patients mais de définir des types.
Ils ont ainsi essayé de distinguer chez les patients trois grands axes de résultats, non plus cette fois en termes de jours d’arrêts de travail, mais suivant des critères beaucoup plus psychodynamiques : 1) type de relation d’objet : quelle est la relation que la personne a avec son entourage ? ; 2) regard sur soi-même : capacité de se regarder, de s’étudier, de s’analyser ; 3) créativité, réalisation et capacité d’avoir une vie plus active. C’était trois axes qui permettaient de situer une personne par rapport à ces trois dimensions. En fonction des données cliniques issues à la fois des patients et des psychanalystes, ils ont pu se faire une idée avant traitement et après traitement. Ce sont des types qu’ils ont décrits. Par exemple, le type de Mr H., qui a formidablement amélioré sa connaissance de lui-même, sensiblement amélioré sa créativité et faiblement amélioré (parce que c’était déjà pas mal) sa relation avec l’entourage. Vous utilisez donc deux colonnes : une colonne avant et une après, et cela donne un type de patient. Ils ont pu montrer qu’il y avait des types qui se retrouvaient plus ou moins dans un grand nombre de personnes, ce qui a conduit à une typologie de la population. Evidemment, il y a des concentrations de cas sur des types précis et puis des sujets plus ou moins déviants, si l’on peut dire. Cela leur permet d’avoir une clinique de l’évolution des gens en fonction de ces trois axes : relation avec l’entourage, connaissance de soi et créativité.
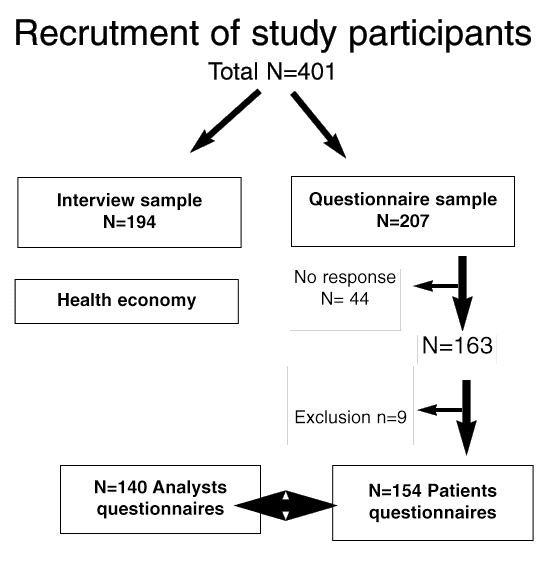
L’autre dimension, assez compliquée et intéressante de la recherche par rapport à ce cas, a consisté en une micro analyse du contenu des séances. Cette analyse a essayé de suivre comment un conflit et sa résolution peuvent avoir des effets repérables au niveau de l’évolution de la glycémie de cette enfant.
Donc deux niveaux : des aspects généraux quantitatifs et des aspects plus qualitatifs qui interrogent sur les processus de la cure, et portent en particulier sur les conséquences de l’insight.
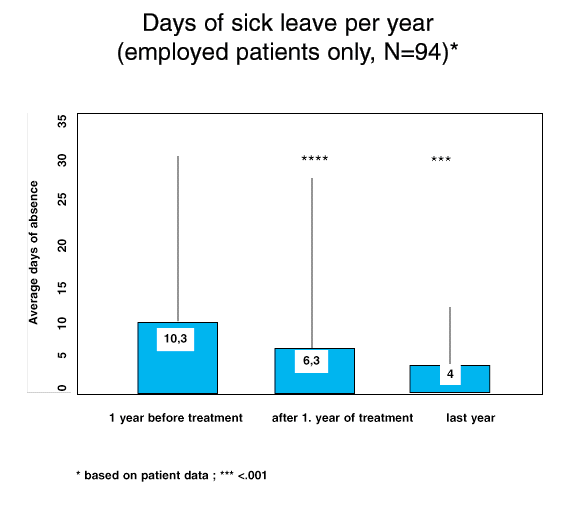
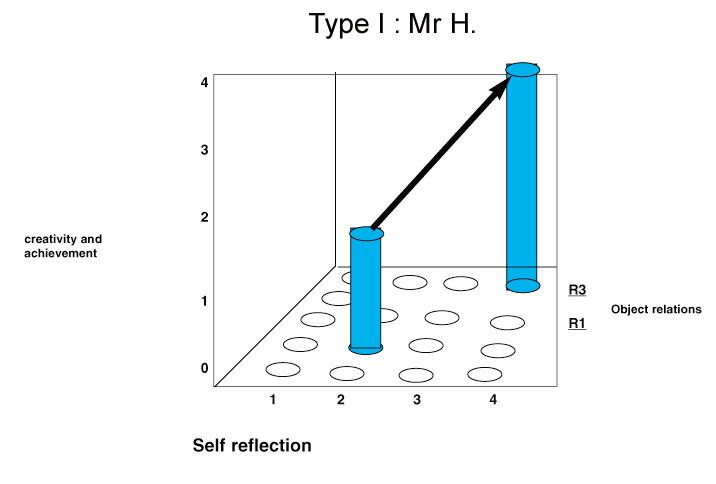
Dans le dernier cas, on est dans une étude qualitative et de typologie et c’est une approche innovante du problème de l’évaluation du processus. Cette recherche semble assez proche de celle que nous avons nous-mêmes menée4 mais qui ne nous renseigne pas vraiment sur la façon dont l’évolution s’est produite.
Je pense qu’il y a aussi des choses importantes dans le domaine thérapeutique, c’est la psychanalyse face aux médicaments. Il y a vraiment une réflexion et des études à mener. Il n’y a aucun antagonisme de fond entre le médicament et la psychanalyse. Ils interviennent à des niveaux complètement différents de l’organisation psychique. Ils se renforcent mutuellement dans des conditions que nous connaissons mal mais qu’il faut préciser.
En revanche, c’est peut-être plus délicat quand il s’agit de dire quelle forme de psychothérapie serait préférable. Là je crois effectivement que la rivalité qui existe dans les pratiques entre thérapie cognitive et comportementale d’un côté, et thérapie psychanalytique de l’autre, qui sont quand même les deux grands piliers des psychothérapies qui existent actuellement, nécessiteraient des études comparatives ; mais je crois surtout qu’elles ont une approche du même cas qui est tout à fait différente. Le problème est plus un problème presque d’éthique qu’un problème d’action thérapeutique : « Qu’est-ce que l’on souhaite obtenir comme effets ? » Il y a là un problème très délicat qui fait que les études comparatives demeurent très difficiles, car sinon on aboutit à quelque chose qui paraît tout à fait correspondre à la fable du “Renard et la cigogne“ : selon l’outil que vous allez utiliser pour tester, vous aurez évidemment un résultat en faveur de l’une ou de l’autre.
1 An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis. Report prepared by the Research Committee of the IPA at the request of the President. Editor and Chair : Peter Fonagy, Ph D FBA. Contributors : Horst Kächele (Europe), Rainer Krause (Europe), Enrico Jones (Process Studies), Roger Perron (Epistemology), Peter Fonagy (Epistemology, UK & US).Une revue ouverte des études de résultats en psychanalyse. Présentation du document de l'IPA
Jean-Michel Thurin et Michaël Villamaux
Concernant la justification stratégique des études empiriques, P. Fonagy examine successivement différents éléments, comme celui du contexte de l’Evidence Based Medecine qui conduit indirectement à ne rembourser que les traitements dont l’efficacité est prouvée, mais qui pose aussi toutes les questions liées au choix des critères sur lesquels on va évaluer les résultats. Sont-ils tout simplement identifiables et mesurables ? Comment évoluent-ils en quelles variations culturelles ? Que signifie « bons » résultats et pour qui le sont-ils ?
Au delà de cette situation conjoncturelle, mais qui risque d’avoir des effets importants, la question générale reste de savoir si la psychanalyse peut bénéficier de la recherche empirique, et comment. La position stratégique préconisée par P. Fonagy est d’utiliser déjà ce qui existe, plutôt que de se perdre dans un débat épistémologique interne. Celui-ci, inaudible pour ceux qui n’appartiennent pas à la discipline, ne manquerait pas en plus d’absorber une énergie requise pour un effort collaboratif pour que la psychanalyse soit appréhendée comme une discipline clinique toujours créative et en évolution.
Reste la question de la méthodologie. Deux problèmes inhérents à la recherche évaluative sont développés (cf. encadré), avant de présenter les différentes méthodes possibles et leurs champs, ainsi qu’une certain nombre d’outils qui peuvent être utilisés.
- la distinction de deux grands types de recherches : celles où prévaut l’attitude clinique, et celles qui utilisent des procédures d’objectivation et de systématisation formelle, inapplicables au matériel et au processus de la cure : toute procédure qui tente de les y introduire a pour résultat de « tuer » son objet même ;
- la place du cas individuel dans la recherche clinique, selon le modèle traditionnel en médecine, à partir duquel on s’efforce de comprendre la spécificité du fonctionnement global de l’individu en cause ;
- l’importance de la démarche clinique dont sont issus jusqu’ici tous les grands modèles théoriques proposés par Freud ; c’est aussi sur la base de la clinique que se sont développées les controverses suscitées par ces modèles.
- pour la cure classique, seule est utilisable la démarche clinique ;
- dans le cas des psychothérapies psychanalytiques, les objections sont plus nuancées et portent sur le caractère parcellisant de la démarche objective, la limitation du traitement statistique, la qualification des « juges » dont l’objectivité risque de n’être qu’apparente.
Ainsi, des études sur l’intervention du psychanalyste dans d’autre démarches thérapeutiques peuvent être envisagées. Elles peuvent concerner l’étude comparative des techniques thérapeutiques et éducatives effectivement utilisées, l’étude du déroulement de ces actions et l’évaluation de leur issue. Les difficultés portent sur : les critères de changement (qui ne doivent pas se limiter aux symptômes), le choix du ou des « juges », la prise en compte d’une possible aggravation en dehors du traitement quand on veut mesurer ses effets. Les études peuvent aussi porter sur l’histoire de la psychanalyse et le fonctionnement des institutions.
Par ailleurs, (b) Fonagy reproche aux cliniciens de ne pas utiliser un raisonnement déductif approprié en relation avec le matériel clinique. Il reprend les arguments déjà énoncés précédemment concernant le problème de « l’inductivisme énumératif » en recherche clinique. Il propose de développer un raisonnement prenant en compte les exemples négatifs, « quand A n’est pas suivi par B ». Fonagy pose comme nécessaire de développer une stratégie épistémologique où la non observation de B suivant A est prise en compte dans la construction de la théorie. Cependant, il reconnaît la difficulté de la tâche. « Demander à des cliniciens d’être attentifs à de tels exemples négatifs me semble être une demande de quelque chose de profondément contre thérapeutique et être spécifique d’une situation clinique où les buts de la thérapeutique et de la recherche ne peuvent pas être poursuivis à égale mesure ». Nous rencontrons là, peut-être, « une limitation centrale à la méthodologie de la recherche clinique ».
Enfin, (c) Fonagy souhaite voir se développer l’utilisation de termes non ambigus. Comme très souvent, il reconnaît la difficulté de la tâche. La complexité des phénomènes observés oblige parfois le théoricien, par ailleurs clinicien, à proposer des concepts dont les définitions fluctuent. Cependant, il s’oppose à l’utilisation de concepts polymorphes. Les psychanalystes doivent pouvoir proposer des définitions sans équivoque, et cela afin d’éviter la tendance à la fragmentation de la théorie psychanalytique.
Les deux principaux problèmes épistémologiques étant ainsi définis : la méthodologie et l’absence de langage commun. Fonagy nous propose de développer un nouveau cadre épistémologique pour la psychanalyse. Ce développement passe, selon l’auteur, par l’intégration dans la théorie psychanalytique des résultats de deux autres importants domaines de recherche : la neurobiologie et la psychologie. Cependant, de nombreux obstacles semblent s’être dressés, au cours de l’histoire, contre la réalisation de cet objectif.
Depuis, entre autres, l’échec de Freud à constituer une neurobiologie psychanalytique, les psychanalystes ont implicitement accepté le dualisme corps-esprit. Les ponts entre la neurobiologie et la psychanalyse semblent à tout jamais rompus. Cependant les oppositions théoriques qui prévalaient, il y a trente ans, sont aujourd’hui dépassées. Les avancées considérables effectuées dans le domaine de la neurobiologie, permettent d’envisager un rapprochement avec la psychanalyse. Freud chercherait très certainement, aujourd’hui, à construire un modèle neuronal du comportement. Parmi les nombreux progrès effectués, nous pouvons citer, par exemple, les travaux dans le traitement de la dépression et du trouble obsessionnel compulsif, sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais, paradoxalement, la réaction des psychanalystes dans leur majorité fut mitigée. Pour Fonagy : « L’idée dominante – qu’il qualifie d’irrationnelle – semble être que la finesse d’investigation psychanalytique, si durement gagnée, serait d’une façon ou d’une autre détruite plutôt qu’améliorée et enrichie par les nouvelles méthodes de recherche ».
La relation des psychanalystes à la psychologie et tout particulièrement à la psychologie expérimentale ne fut guère différente. Les modèles comportementaux basés sur l’apprentissage, trop éloignés des conceptions psychanalytiques, ont souvent fait barrage à un rapprochement. Cependant, tout comme les sciences du cerveau, la psychologie a fait progresser ses modèles et ses outils d’investigations au point d’être considérée, aujourd’hui, comme le champ de recherche le plus en pointe dans l’étude des processus mentaux. Différents facteurs ont contribué à cette transformation. Par exemple : l’utilisation d’une métaphore informatique, le développement d’outils de mesure toujours plus performant ou bien encore l’utilisation de méthodes d’analyse des données toujours plus puissante. Malgré ces changements, la rencontre psychanalyse-psychologie n’a pas encore eu lieu. De plus, au-delà des raisons historiques que nous venons de présenter, Fonagy pointe deux difficultés. Tout d’abord, les psychanalystes ont négligé les opportunités qui leur étaient données de contribuer aux sciences du comportement et tout particulièrement aux études développementales. Citons par exemple, les travaux de Mélanie Klein, si souvent critiqués entre autres par Anna Freud et Glover. Ces études auraient pu être intégrées aux réflexions menées sur le développement des compétences cognitives du nourrisson. Ensuite, depuis plusieurs années, une pression sociale constante invite les psychothérapeutes à développer des pratiques alternatives, centrées sur des problèmes spécifiques, d’une durée moins importante. Cette demande extérieure n’a pas modifié la pratique des psychanalystes. Mais cela a eu pour conséquence de laisser la place à un nombre important de nouvelles pratiques, dont, tout particulièrement, les thérapies cognitivo-comportementales. Fonagy regrette ce refus des psychanalystes, qui se sont, selon lui, contenté du « une taille convient à tous ». Même s’il reconnaît un certain changement ces dernières années, avec par exemple les travaux de Goldfried ou de Jones, il reproche aux psychanalystes, une absence d’innovation, une certaine incapacité à adapter une théorie de la pratique qui, comme nous l’avons déjà écrit, a pourtant par ailleurs si peu de liens logiques avec la théorie psychanalytique.
L’argument une fois admis, que devront faire les psychanalystes afin que l’intégration de la psychanalyse dans la science contemporaine devienne une réalité ? Plusieurs réponses peuvent être apportées. Tout d’abord, l’étude de cas comme seule méthode de recueil de données doit être abandonnée. L’étude de cas n’est pas en soi remise en cause, mais il paraît nécessaire de l’associer à d’autres protocoles confirmatoires. De nombreuses découvertes ont pu être obtenues grâce à cette méthode. Cependant, elles demandent presque systématiquement à être appuyées par des résultats obtenus au cours d’investigations objectivantes indépendantes. Ensuite, même si cela fut rarement le cas et que de nombreux brillants psychanalystes ont pu appartenir à des disciplines autres que la psychiatrie et la psychologie, il semble important que les générations futures de psychanalystes aient une formation de base importante dans les sciences médicales et sociales. Enfin, au risque de voir baisser le niveau de qualité du recueil des données – cela reste à prouver – il sera nécessaire, selon Fonagy, de généraliser l’utilisation des enregistrements audio, vidéo, etc., comme cela a pu être fait dans l’étude des relations mère-nourrisson. Fonagy ne nie pas les biais qui peuvent être introduit par l’utilisation de ces outils d’observation, mais il s’interroge : « Je ne peux pas penser, qu’un psychanalyste pourrait sérieusement défendre que le simple fait d’avoir soi-même participé à un processus analytique, garantisse la diminution des biais dans l’observation ». De plus, qui pourrait « prétendre prendre conscience de la finesse de l’interaction patient-analyste, uniquement à partir de l’observation participative ? ».
D’une façon générale et en guise de conclusion, Fonagy, dans un ultime plaidoyer pour le rapprochement de la psychanalyse et des sciences médicales et sociales, reprend trois propositions énoncées par Kandel : « Comment les processus biologiques modulent-ils les événements mentaux ? Comment la structure biologique du cerveau est-elle influencée par les facteurs sociaux ? Et quel impact les interventions psychologiques, comme par exemple la psychanalyse, peuvent-elles avoir sur le fonctionnement et la structure des circuits neuronaux ? ».
C’est en répondant à ces questions et tout particulièrement à la deuxième d’entre elles, qu’une psychanalyse scientifique à un rôle clair à jouer. M.V
Recherches collaboratives en psychanalyse et neurosciences : les propositions d'Eric Kandel
Jean-Michel Thurin
Avant cette distinction, il avait écrit deux grands articles dans l’American Journal of Psychiatry à l’occasion de l’entrée dans le nouveau millénaire. Dans le second1, il présente de façon très documentée, ses arguments et ses propositions pour une véritable collaboration de recherche entre la psychanalyse, référence majeure et cohérente de la psychiatrie, et les neurosciences.
Max Planck Institute of Psychiatry
Jean Garrabé
Deux problèmes méthodologiques inhérents à la recherche évaluative
Accueil PLR
![]()