| Dernière mise à jour : mercredi 18 avril 2001 16:37:32 Dr Jean-Michel Thurin |
| 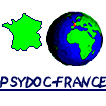
|
PEUT-ON PREVENIR LES ETATS DEPRESSIFS ?
(Pour une ambition prophylactique des états dépressifs)
INTRODUCTION
La diversité des situations et le caractère multifactoriel de l'origine des états dépressifs rend difficile, mais nécessaire, l'approche prophylactique.
Le médecin traitant, “ en première ligne ” sur le front, doit être à même de détecter les situations de vulnérabilité et aider le patient à y faire face. Tout comme le médecin du travail qui ne se cantonne plus aux purs aspects réglementaires et joue, de nos jours, un vrai rôle de dépistage et de prévention.
La prévention des états dépressifs est un objectif essentiel que le médecin ne doit pas perdre de vue dans sa pratique quotidienne. Si le risque de suicide justifie, à lui seul, cette démarche, il ne résume pas les conséquences de la dépression sur la santé des patients qui en souffrent.
Tous les troubles dépressifs s'associent à une morbidité et une mortalité importantes :
·
15 % des patients
souffrant de troubles de l'humeur se suicident. (5) (7) (16)
·
Les chiffres de
mortalité de l’Epidemiological Catchment Area (ECA) Study (18) sur une période de quinze mois sont 4
fois plus élevés chez des patients déprimés,
âgés de 55 ans et plus, que chez des sujets non
déprimés.
·
En ce qui concerne la
morbidité, une étude de Wells (36) et coll., faite sur une
population de Los Angeles, montrait que 23 % des patients atteints d'un
trouble dépressif majeur avaient dû rester au lit, pour des
raisons de santé, pendant quelque temps, durant les deux dernières
semaines, par comparaison au 5 % de la population générale.
·
Par ailleurs, 30 %
des patients rapportaient une baisse de leur activité pendant la
même période, et 38 % une limitation chronique de leur
activité.
·
En France,
l'étude du CREDES publiée en 1996 (24) montre également
que les personnes atteintes de dépression souffrent de 7 maladies,
contre 3 pour les sujets non déprimés, au cours des trois
derniers mois.
·
Selon les estimations de
Davidson (12), si rien n'est fait en matière de prévention, en
2020 la dépression sera la deuxième cause d'invalidité
mondiale, derrière les maladies cardiaques.
Ces chiffres montrent bien qu'en matière de dépression la prévention doit considérer autant les facteurs de risque que l'ensemble des conséquences de la maladie. Ainsi, les actions menées par l'ensemble des acteurs de la filière de soins ne seront pas les mêmes selon qu'on vise à prévenir :
·
La survenue d'un premier
épisode dépressif, chez des sujets présentant des facteurs
de risque et/ou ayant des difficultés existentielles.
·
La mortalité et
la morbidité. Autrement dit, les conséquences ou complications,
dont le suicide, d'un état dépressif en cours de traitement.
·
Les rechutes et
récidives.
·
Les symptômes
résiduels.
·
La chronicisation.
Voici l'analyse de chacune de ces cinq étapes (présentées chronologiquement) avec les stratégies thérapeutiques adaptées à chaque situation particulière.
1 – Prévention de la survenue d'un premier épisode dépressif chez des sujets présentant des facteurs de risque et/ou ayant des difficultés existentielles
La démarche consiste ici, pour le médecin, en un double repérage anticipatif :
·
identifier les
caractéristiques personnelles et environnementales du patient, ainsi que
les événements vitaux (anciens ou récents) susceptibles de
contribuer à l'apparition d'un état dépressif ;
·
reconnaître (et
éventuellement traiter) les signes prodromiques d'un état
dépressif naissant.
En exergue de cette démarche se pose encore la question du “ modèle ” à partir duquel le praticien va porter le diagnostic de dépression. (Cf. chapitre “ Le temps du diagnostic ”)
Ici la modélisation ne se situe pas au niveau sémiologique mais psychopathologique, puisque dès qu'on évoque la réaction face à un événement on est dans le domaine de la dépression réactionnelle.
Sans entrer dans la polémique (certains auteurs, dont Andreassen (17), s'appuyant sur les résultats des études du NIMH, nient la validité du concept de dépression réactionnelle), force est de constater qu'en pratique clinique courante, la dichotomie “ endogène/exogène ” n'est guère opérationnelle.
Pour ne pas réduire le patient à la maladie dont il souffre, il faut tenir compte des liens existant entre la vulnérabilité biologique, les événements de vie, la personnalité, les stratégies d'adaptation (coping, “ faire face ”) et une éventuelle comorbidité avec des troubles psychiques et organiques.
En ce sens, sans aller jusqu'à préconiser l'utilisation systématique des guides d'évaluation des life events (LEDS, EVE etc.), le fait de répertorier et prendre en compte les événements déstabilisants dans la vie du patient est indispensable.
Il est habituel (14) de classer les événements vitaux traumatiques de façon chronologique :
·
Evénements
récents. Apparus peu de temps
avant le commencement de l'état dépressif.
Considérés comme facteurs précipitants et non
étiologiques.
·
Evénements
contemporains. Apparus pendant
l'évolution de l'état dépressif. Considérés
comme facteurs aggravants.
·
Evénements
anciens. Apparus précocement
dans l'enfance. Considérés comme facteurs prédisposants.
L'étude des facteurs précipitants doit tenir compte tant de l'ampleur de l'événement que du retentissement subjectif sur un individu donné. La réaction dépendra autant des capacités du sujet à élaborer (“ coping ”) des stratégies adaptatives opérationnelles que de la présence d'éventuels facteurs protecteurs. Comme aimait à le rappeler Tatossian, en inversant les termes du problème : “ Un changement n'est événement que pour celui dont il change la vie. ”
Concernant les événements anciens, depuis les travaux de Bowlby et Winnicott, on sait que les perturbations des relations précoces induisent une vulnérabilité dépressive chez l'adulte.
Il est intéressant d'établir un parallèle entre ces constats et les études actuelles menées par les psychogériatres sur les événements anciens chez les patients atteints de démence. Clément a évoqué, lors d'un récent symposium (11), une hypothèse analogue à celle de l'étiopathogénie de la schizophrénie : elle associerait une anomalie neurodéveloppementale à des traumatismes précoces, ce qui donnerait des sujets avec une faible capacité d'adaptation aux situations nouvelles et contraignantes. Parmi ces traumatismes précoces, le fait de perdre ses parents dans l'enfance serait un facteur de risque psychosocial important dans l'étiologie de la démence. L'étude de Kivela (19) sur la perte parentale précoce trouve des données statistiquement significatives à ce sujet.
Même si ces données sont à considérer avec précaution, elles semblent démontrer déjà que l'idée que le biologique peut l'emporter sur l'existentiel (ou le contraire) n'est pas d'un grand secours lorsqu'on prétend avoir une vision globale des troubles psychiques.
2 – Mortalité et morbidité,
prévention du suicide
“ Il n'y a rien de plus mystérieux
qu'un suicide. Quand j'entends expliquer les raisons de tel suicide, j'ai
toujours l'impression d'être sacrilège. Car il n'y a que le
suicidé qui les ait connues, et qui ait été en mesure de
les comprendre : elles sont le plus souvent multiples et inextricables et
hors de la portée d'un tiers. ”
Ces mots d'Henry de Montherlant résument la question préalable à toute prise en charge et/ou programme de prévention : est-ce que le geste suicidaire est toujours imputable à un état dépressif ?
Th. Lempérière (23) apporte un début de réponse lorsqu'elle rappelle que la tentative de suicide n'est pas qu'un simple échec du geste suicidaire, c'est un mode de comportement particulier dont l'épidémiologie et la signification psychologique ne sont pas entièrement superposables à celles de suicide.
La tentative de suicide s'inscrit aujourd'hui dans un contexte socioculturel qui la valide.
Les études de prévalence des pathologies psychiatriques, et de la dépression en particulier, à partir des autopsies psychologiques des suicidés, permettent de mieux cerner les relations entre les éventuelles pathologies sous-jacentes et les différents comportements autolytiques.
Les statistiques montrent que 90 % des suicidés présentent un trouble psychiatrique. (3) La dépression s'observe dans la moitié des cas et multiplie par 20 le risque suicidaire. De même, une tentative de suicide est retrouvée dans les antécédents d'un suicidé sur deux et multiplie par 40 la probabilité d'une réussite ultérieure.
Mais le chiffre le plus significatif, lorsqu'on se place
dans une optique de prévention, est celui qui signale que 60 %
à 70 % des suicidants ont consulté un médecin
(souvent leur généraliste) dans le mois précédant
une tentative de suicide. (3)
Il est donc évident que des programmes de formation destinés à améliorer la reconnaissance de la dépression et son traitement pourraient contribuer à optimiser la prise en charge de la dépression et, par voie de conséquence, prévenir le suicide. (Cf. “ La dépression : impact économique et atteinte à la qualité de vie ”)
Une telle expérience à été menée sur l'île de Gotland en Suède par Rutz (28) (29), avec un programme d'éducation complet auprès de tous les médecins généralistes de l'île, sous forme de séminaires et de documentation.
Elle a montré des résultats satisfaisants concernant la prise en charge de la dépression. Les médecins ont ainsi augmenté leur prescription d'antidépresseurs et diminué celle des tranquillisants, réduisant alors le recours aux services psychiatriques et aux hospitalisations. Les arrêts maladie ont été diminués de moitié. Et, surtout, le taux de suicide a été significativement réduit.
|
|
1982 |
1985 |
|
Taux de suicide |
25/100 000 |
7/100 000 |
Les résultats de cette étude sont souvent cités dans la littérature sous forme d'exemple, mais ils sont loin d'être le seul cas où l'on constate des améliorations tangibles en matière de prévention du suicide.
On distingue trois éléments communs dans tous ces programmes.
Le premier, prioritaire, est celui qui consiste à centrer les actions de formation sur un dépistage et une prise en charge précoces des troubles dépressifs.
Viennent ensuite le repérage des populations à risque et l'amélioration de la prise en charge des suicidants.
3 – La prévention des rechutes et des
récidives
Epidémiologie
La plupart des patients souffrant de dépression majeure réagissent favorablement au traitement, mais entre 30 % et 50 % d'entre eux rechutent dans les quatre ou cinq mois qui suivent l'arrêt du traitement antidépresseur.
En moyenne, le nombre d'épisodes dépressifs est de 3, allant de 1 à 6 épisodes dans la vie d'un même patient.
Par ailleurs, le risque de rechutes tend à augmenter après chaque épisode. Seulement 50 % des patients atteints de dépression unipolaire sera asymptomatique un an après le début d'un épisode dépressif majeur. Dans 10 % à 15 % des cas, les récidives dépressives évoluent vers une maladie bipolaire. Dans les formes précoces de dépression, les récidives sont fréquentes, s'accélèrent et se multiplient au fil du temps. (27)
Définitions
Frank et al. (15) ont proposé des critères
pour décrire et évaluer l'évolution et le traitement de la
dépression. Trois phases successives du traitement y sont
identifiées : aiguë, continuation/consolidation et
maintenance.
L'objectif du traitement antidépresseur en phase aiguë, qui dure en moyenne de six à huit semaines, c'est d'arriver à la rémission qui est définie par une diminution significative de la sévérité de l'état dépressif (50 % de réduction de la sévérité des symptômes).
Dans la phase de continuation/consolidation, il s'agit de prévenir le retour des symptômes de la phase aiguë : rechute. Beaucoup d'auteurs (25) préconisent que le traitement avec le même antidépresseur doit être maintenu pendant au moins quatre mois pour prévenir les rechutes.
Maintenance : la guérison est définie par la fin de l'épisode dépressif. Un épisode ultérieur est appelé une récidive pour indiquer qu'il s'agit bien d'un nouvel épisode dépressif et non d'une réémergence de l'épisode précédent.
La séparation des notions de “ rechute ” et “ récidive ” s'avère donc décisive pour évaluer l'efficacité à long terme d'un traitement antidépresseur. (2)
Nombreux sont les travaux, comme celui cité plus haut, qui proposent des stratégies thérapeutiques en fonction du moment évolutif et des éventuelles complications de la maladie dépressive. On constate également des “ habitudes ” de prise en charge empiriques et intuitives, qui sont loin d'être homogènes entre les praticiens.
Devant cette absence de consensus terminologique et thérapeutique, l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale (ANDEM), dans ses Recommandations et références médicales (1) concernant les médicaments antidépresseurs, propose le lexique suivant :
·
Une rémission
partielle correspond à une
période pendant laquelle est observée une amélioration
d'un niveau tel que l'individu n'a plus les critères symptomatiques
nécessaires pour que soit retenu le diagnostic d'épisode
dépressif majeur, tout en conservant certains symptômes de la
maladie.
·
Une rémission
complète est la période
durant laquelle est observée une amélioration d'une
qualité suffisante pour que le patient soit considéré
comme asymptomatique.
·
La guérison est une rémission complète pendant une
durée suffisante (en théorie, égale ou supérieure
à six mois).
·
La rechute se définit par la réapparition de
symptômes dépressifs avant la guérison. Une rechute
survient dans le cours évolutif d'un même épisode
pathologique (de l'ordre de quelques mois).
·
La récidive (ou récurrence) correspond à la
réapparition d'un nouvel épisode dépressif après
guérison du précédent.
Recommandations thérapeutiques
Comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre “ Le suivi du traitement ”, la frontière entre les domaines thérapeutique et prophylactique devient presque invisible depuis qu'on utilise les antidépresseurs au long cours, au-delà de l'amélioration du tableau clinique qui a été à l'origine de la prescription initiale. Nous ne reviendrons donc pas sur le suivi du patient en phase aiguë.
Néanmoins, en ce qui concerne le suivi à long terme, une des études la plus ambitieuses vient d'être publiée dans Am. J. Psychiatry (31). Elle concerne une cohorte de 318 patients porteurs d'un diagnostic de dépression majeure, qui ont été suivis pendant dix ans. Pratiquement les deux tiers des patients ont présenté au moins une rechute, et le nombre moyen de rechutes annuelles est de 0,21. Après chaque récidive, le risque d'une nouvelle rechute est encore augmenté de 16 %. En revanche, le risque de rechute diminue au fur et à mesure que la durée du temps de rémission augmente.
En conclusion, selon les auteurs, il faut être conscient du haut potentiel de récidive de la dépression, et par conséquent ne pas hésiter, surtout après plusieurs rechutes, à poursuivre indéfiniment le traitement antidépresseur à dose efficace.
Cette préconisation du traitement à vie semble rencontrer un assentiment de plus en plus large. Précisément, on trouve dans les recommandations de l'ANDEM un chapitre consacré au Traitement de maintenance ou traitement prophylactique, où il est dit clairement que l'objectif est de prévenir la survenue de nouveaux épisodes chez des patients à risque.
En ce qui concerne les moyens d'y parvenir il semble y avoir un consensus international autour du traitement médicamenteux : il est conseillé d'utiliser la même posologie que celle utilisée en phase d'attaque.
En revanche, pour ce qui est de la durée du traitement à visée prophylactique et les éléments permettant d'identifier les patients à risque, les avis divergent. Selon l'ANDEM, la durée du traitement varie en fonction du nombre d'épisodes dépressifs antérieurs (en moyenne quatre ou cinq ans).
La prise en compte des antécédents personnels de dépression est indispensable mais pas suffisante lorsqu'il s'agit d'établir une stratégie de prévention. L'étude d'autres facteurs prédictifs s'avère un élément essentiel dans la prise en charge, à long terme, des états dépressifs.
Facteurs prédictifs
Toutes les recommandations centrées sur la dépression et la conduite du traitement psychotrope ne doivent pas nous faire oublier le patient et son environnement.
Les études concernant les facteurs prédictifs de rechutes et récidives dépressives sont innombrables. Parmi les plus importantes, on trouve celle de “ Epidemiological Catchment Area (ECA) Program ” datant de 1990.
Voici les facteurs ayant un impact négatif sur le pronostic d'un épisode dépressif.
·
Sexe
féminin : 21 % des femmes ayant fait un accès
dépressif rechutent, contre 12 % des hommes.
·
Age : A partir de
30-4O ans le pronostic de la dépression est, statistiquement, moins
favorable.
·
Statut marital :
veuf(ve), divorcé(e), séparé(e).
·
Antécédents
familiaux de dépression.
·
Antécédents
personnels de dépression.
·
Association d'un trouble
psychiatrique ou d’une personnalité pathologique.
·
Episode dépressif
sévère et durable.
·
Pathologie organique
associée.
·
Episode dépressif
survenant dans le cadre d'une maladie bipolaire.
·
Présence
d'événements stressants et de difficultés existentielles.
·
Absence de support
social.
·
Grossesse et accouchement.
En ce qui concerne les niveaux socioéconomiques ou socioéducatifs et le lieu de résidence, ils ne semblent pas corrélés à un mauvais pronostic. Mais les résultats des études divergent sur ces facteurs.
Quoi qu'il en soit, ces éléments sont autant de points de repère pour le praticien qui doit tenter de dépasser le niveau d'analyse sémiologique pour entrer en relation avec les composantes les plus individuelles, les plus subjectives de son patient.
4 – Prévention des symptômes
résiduels
La nécessité de prendre en compte une éventuelle symptomatologie résiduelle, voire certains remaniements de la personnalité consécutifs à l'épisode dépressif, est évidente.
Diverses études ont montré une fréquence élevée de manifestations telles que l'anxiété, les troubles du sommeil, la perte d'initiative, des modifications du caractère, après disparition de la pathologie dépressive. (1)
Ces séquelles dépressives, trop souvent oubliées, peuvent être repérées à l'aide de l'échelle de dépression de Hamilton, où l'on obtient des scores de 7 à 10. L'importance de ces symptômes résiduels est illustrée par une étude (13) dans laquelle 51 des 101 patients souffrant de dépression unipolaire rechutaient avant un an et montraient des niveaux supérieurs de symptômes résiduels à ceux qui allaient bien après l'épisode dépressif.
De ce fait, certains auteurs (21) pensent qu'il n'est pas justifié de prolonger le traitement au-delà de six mois après la guérison de l'épisode dépressif, sauf pour les patients pour lesquels on décèle l'existence de symptômes résiduels.
Il s'agit le plus souvent de patients ayant eu des épisodes dépressifs particulièrement sévères.
Les préconisations de l'ANDEM sont un peu plus modérées : “ Les modalités thérapeutiques de ces "cicatrices" n'ont pas été systématiquement étudiées. L'usage est généralement de recourir à une thérapeutique purement symptomatique et à une aide psychologique. ” (1)
5 – Prévention de la chronicisation
L'évolution chronique de la dépression a été constatée chez 15-20 % des patients, et la survenue d’épisodes récurrents chez 75-80 % après des intervalles de plus de dix ans. Certains auteurs (27) affirment que, potentiellement, tous les cas de dépression majeure auront une évolution chronique ou avec des rechutes, à condition de les observer pendant une assez longue période.
Indépendamment du chiffre retenu, il existe un certain consensus concernant la stratégie de prévention du risque de chronicisation. Il porte sur deux points :
·
La
précocité et la qualité du traitement, lors du premier
épisode, sont déterminants pour l'évolution
ultérieure de la dépression (cf. plus bas).
·
Après plusieurs
rechutes, particulièrement chez les patients à risque, le
traitement antidépresseur doit être poursuivi indéfiniment
à dose efficace.
Le rôle du médecin du travail dans la prévention des états dépressifs
Comme il a déjà été signalé dans le chapitre “ Le retentissement de la symptomatologie dépressive ”, les médecins du travail, suite à l’évolution de leur rôle premier, se trouvent actuellement dans une position où ils peuvent identifier en priorité les situations professionnelles (le harcèlement, par exemple) pouvant être à l'origine d'une détresse psychologique conduisant éventuellement à une dépression. Leur rôle de prévention est donc ainsi renforcé, dans cette démarche de santé globale.
Concernant le harcèlement moral, le succès médiatique de ce concept ne peut pas s'expliquer seulement par le fait qu'il ait permis de mieux appréhender et circonscrire un phénomène purement psychologique. Trois jugements récents ainsi qu'un projet de loi témoignent du retentissement social de cette question.
·
Le 8 décembre
1999, le Tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a retenu la
responsabilité d'un employeur dans le suicide d'un de ses commerciaux,
et a condamné la société à verser des
indemnités à sa veuve. (22)
·
Le 25 février
2000, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a condamné la Caisse
primaire d'assurance maladie de l'Allier à prendre en charge, au titre
d'accident du travail, le suicide d'un salarié qui s'était pendu
dans les locaux de l'entreprise, estimant que “ l'altération
de l'état psychologique du salarié (...) conduit à
écarter, ou tout au moins à atténuer sensiblement, le
caractère volontaire et réfléchi de l'acte
suicidaire. ”
C'était la première fois qu'un suicide était reconnu
officiellement comme un accident du travail. (4) (33)
·
Dans ce même
état d'esprit, le 28 février 2000, une tentative de suicide a été reconnue comme
“ accident du travail ” par un Tribunal des affaires de
Sécurité sociale (TASS). Le tribunal d'Epinal a
considéré que la tentative de suicide d'une femme de
ménage (défenestration sur son lieu de travail) et les
séquelles (paraplégie) que celle-ci avait
entraînées, rentraient dans le cadre d'un accident du travail.
Cela après avoir clairement établi, grâce aux
témoignages des collègues, l'existence d'un harcèlement
moral de la part de sa supérieure hiérarchique. (22) (35)
Ces jugements ont été très médiatisés et ont permis une prise de conscience collective, tant sur l'ampleur du phénomène que sur le vide juridique existant en la matière.
Dans son article paru dans L'Express du 30 mars 2000, “ Le harcèlement moral condamné ”, à propos des différentes décisions de justice commentées plus haut, la journaliste Marion Festraëts écrivait :
“ Ces décisions de justice entérinent l'existence du harcèlement moral au travail, que la psychiatre Marie-France Hirigoyen décrit dans son livre paru en août 1998. Depuis, des centaines de salariés affirment s'être reconnus dans ces portraits d'employés malmenés, isolés, en proie à des dépressions nerveuses. Les salariés d'une entreprise (...) sont en grève (...) pour protester contre une direction qu'ils accusent de les harceler moralement. ”
Il semble donc évident que nous sommes devant un phénomène d'exemplarité du témoignage véhiculé par les médias, par lequel les personnes reconnaissent non seulement le type de souffrance qu'ils éprouvent mais aussi l'origine de celle-ci. Ce qui leur est proposé, ce n'est pas seulement un modèle clinique, avec une description détaillée de symptômes, mais une modélisation étiopathogénique.
On savait qu'individuellement des personnes souffrant depuis longtemps se décidaient à consulter un médecin lorsqu'elles identifiaient, dans le récit d'un proche où dans la description véhiculée par les médias, la nature dépressive de leur mal-être... Ici le phénomène est analogue, mais la prise de conscience se produit au niveau collectif, comme le montrent ces mouvements de grève. Georges Hage, dans la présentation publique de son projet de loi, fait état d'une situation qui durait depuis fort longtemps :
“ Chez Bouyet, à Montauban, les
insultes les plus graves et les plus ordurières fusent en direction des
salariés. Pendant plus de dix ans, la direction laissera faire.
Exaspérés (...) les salariés se mettent en grève et, au bout de neuf jours (...), obtiennent satisfaction par le remplacement de leur DRH. ”
Projet de loi
Le 14 décembre 1999, le groupe communiste a déposé une proposition de loi “ relative au harcèlement moral au travail ” à l'Assemblée nationale.
Tout comme les médecins, les législateurs ont le souci du consensus terminologique évoqué plus haut, comme en témoignent les 4 pages (d'un texte qui en comporte 8 !) consacrées à la seule définition du concept. En exergue de ce chapitre, il est dit explicitement que “ de la définition du harcèlement moral au travail dépend l'efficacité et l'orientation choisie pour la proposition de loi ”. Le harcèlement devra s'entendre comme “ un harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail ”.
Les auteurs du rapport justifient le choix du terme
"harcèlement" par le fait qu'il est l'équivalent de
celui “ (...) désigné sous le nom de mobbing par les Anglo-Saxons (...) ”, et parce que “ il
est étroitement lié à la médiatisation qu'a connue
récemment le phénomène ”.
Les auteurs du rapport suivent donc la terminologie utilisée par Leymann
et Hirigoyen (cf. “ Le retentissement de la symptomatologie
dépressive ”), tout comme leurs conceptions
étiopathogéniques, puisque, dans l'exposé des motifs, ils
écrivent que “ la victime du harcèlement
moral se trouve souvent atteinte de pathologies multiples pouvant conduire
jusqu'au suicide. ”
Il est donc logique de lire plus tard, dans la partie consacrée à la prévention, que “ le médecin du travail devrait pouvoir intervenir plus efficacement. Les médecins ont des propositions intéressantes comme celle de faire inscrire dans le tableau des maladies professionnelles les pathologies liées aux conséquences du harcèlement moral au travail. Une prochaine réforme de la médecine du travail étant prévue... ”
Ainsi, en cas d'adoption du texte, la loi entérinerait en fait l'existence d'une “ relation directe et essentielle ” (voir plus haut) entre certaines conditions de travail et des troubles psychiatriques, avec, comme conséquence, l'élargissement de la notion de “ danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ” consacrée par l'article L.231-8 du Code du travail. D'autres articles sont également visés, par les auteurs du projet, en vue d'une modification, comme l’article L.241-10-1, puisqu'il serait question d’” inclure le harcèlement moral au nombre des causes pouvant justifier l'intervention du médecin du travail, à travers notamment le recours au certificat d'inaptitude ”.
Il s’agirait donc d’un profond remaniement législatif en perspective, dont on peut trouver les prémices dans l'étude commandée en 1998 par l'INSEE et le ministère du Travail à propos de Travail et charge mentale. Cette étude est basée sur l'enquête Conditions de travail, où sont répertoriés et quantifiés plusieurs indicateurs de pénibilité mentale : sentiment de responsabilité, urgence, moyens insuffisants, relations tendues, peur des sanctions, etc. Les résultats de l'étude montrent que la crainte de sanctions est aujourd'hui le facteur de charge mentale qui pèse le plus sur les salariés.
Lorsque le député Georges Hage, à l'origine du projet de loi, a interpellé Martine Aubry à propos du harcèlement moral, lors de la séance de l'Assemblée nationale du 30 juin 1999, la ministre du Travail a fait référence à cette étude en ces termes :
“ L'enquête sur les conditions de travail qui a été réalisée par l'INSEE et par mon ministère en 1998 montre que cette charge mentale et ces pressions s'accroissent. C'est en tous cas le sentiment des salariés eux-mêmes, puisque 60 %, contre 45 % il y a sept ans, craignent des sanctions et s'angoissent (...). 30 % des salariés vivent des situations de tension avec leur hiérarchie (...). Vous venez de m'apprendre que le groupe communiste s'apprête à déposer une proposition de loi en la matière. Je peux vous dire, d'ores et déjà, que je lui porterai une grande attention et que je la considère avec un a priori favorable. ”
En somme, bien que le terme pour désigner le phénomène soit apparu récemment, le harcèlement moral a préexisté à sa propre définition et à sa médiatisation. Ce n'est donc pas la découverte d'un événement nouveau mais son amplification qui a déclenché le signal d'alarme. La ministre légitime le remaniement législatif à venir par le fait que “ ces pressions s'accroissent ”. Tout comme Georges Hage qui, dans l'exposé des motifs de son projet de loi, écrit : “ Si cette forme de harcèlement moral au travail est ancienne, sa nouveauté réside dans la gravité, l'ampleur et la banalisation du phénomène. ”[1]
CONCLUSION
L'expérience semble démontrer que les démarches de soin et de prévention ne peuvent plus être considérées comme deux temps différents dans la prise en charge des troubles dépressifs.
De plus en plus de travaux démontrent que les premiers éléments de prise en charge, au début d'un premier épisode dépressif, peuvent déterminer l'avenir du patient.
Parmi les plus récents et significatifs, on trouve une étude française auprès du personnel de l'EDF, qui constitue, pour l'épidémiologie française, un équivalent de ce que représente la population islandaise pour l'épidémiologie internationale. Dans les deux cas, on dispose d'une population très importante, relativement homogène, remarquablement stable, avec des dossiers médicaux très bien tenus... Il s'agit d'une étude de la cohorte GAZEL (6) (9) (10), qui se déroule depuis dix ans et a pris en compte le suivi d'un peu plus de 20 000 employés de la compagnie. Dans cette cohorte, une enquête parmi les patients souffrant de dépression a montré que la qualité de la prise en charge, lors du premier épisode dépressif, revêt une importance particulière. D'après les auteurs, un traitement mal adapté à la gravité des manifestations cliniques peut, en effet, entraîner un passage à la dépression chronique, et cela pratiquement dans un cas sur deux.
La qualité du traitement initial est donc déterminante pour l'évolution ultérieure de la dépression. Cela remet en question la conception selon laquelle – la plupart des épisodes dépressifs ayant une rémission spontanée – l'intérêt du traitement psychotrope se limite à la diminution de l'intensité de la souffrance du patient et à la réduction du temps d'évolution de l'accès.
Ainsi, il est évident qu'un traitement antidépresseur efficace doit améliorer non seulement les symptômes en phase aiguë, mais également prévenir la survenue d'autres épisodes dépressifs.
De cette conception globale et sur le long terme de la prise en charge des états dépressifs découle le fait que les médecins généralistes se trouvent dans une position où ils vont accompagner le patient, même au-delà de la disparition des symptômes.
Cette “ mission ” semble de plus en plus leur être acquise.
| Dernière mise à jour : mercredi 18 avril 2001 16:37:32 Dr Jean-Michel Thurin |
| 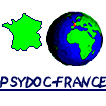
|