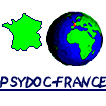REPUBLIQUE FRANÇAISE
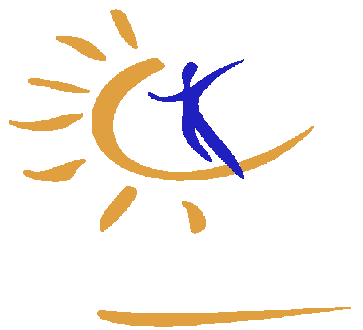 MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE PARIS
SERVICE SANTE PUBLIQUE
Le bilan de la mise oeuvre des recommandations données dans la circulaire du 5 Août 1996 pour améliorer la prise en charge des patients atteints d'infection à VIH, montre que cette question a été prise en compte, notamment en créant des comités SIDA au sein des établissements ou services psychiatriques. Il est par contre apparu lors des différentes rencontres nationales que les établissements psychiatriques ne se préoccupaient pas suffisamment de la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Le Dr Christiane Charmasson a donc été chargée par la Direction des Hôpitaux d'élaborer des propositions et un plan d'action avec les professionnels des secteurs psychiatriques et les représentants de la DASS de Paris pour répondre à ces besoins.
Tout au long de l'année 2000, un groupe de travail, animé par le Dr Charmasson et des représentants de la DASS, auquel ont participé les représentants des directions et présidents de CME des 5 Etablissements Publics de psychiatrie de Paris ainsi que les associations UNAFAM et FNAP-PSY, s'est réuni pour redynamiser la prévention en l'élargissant aux risques liés aux pratiques sexuelles en psychiatrie.
Suite aux conclusions du groupe de travail, il apparaît nécessaire de vous proposer des orientations de travail sur trois thèmes :
- l'infection VIH et les maladies sexuellement transmissibles
- la contraception, les interruptions de grossesse
- les abus et violences sexuelles
Pour chacun de ces thèmes, il est souhaitable d'établir des protocoles concernant la prévention, la conduite à tenir en cas d'urgence et le suivi des personnes (voir protocole ci-dessous).
Je souhaite vivement qu' en vous appuyant, notamment, sur les comités SIDA et le réseau Espas, vous puissiez démarrer dès 2001 la réalisation de ce programme.
Mes services restent à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.
Le groupe de travail auquel vous participez continuera de se réunir pour faire le point sur l'évolution des travaux, ceci au rythme de deux séances par an.
Pour chacun de ces thèmes, il est souhaitable d'établir des protocoles concernant respectivement la prévention, la conduite à tenir en cas d'urgence et le suivi des personnes.
1. Prévention.
- Sensibilisation des chefs de service.
- Formation du personnel médical et infirmier.
- Mise à disposition de matériel (plaquettes d'information, préservatifs, gel).
- Réalisation d' actions de prévention s'appuyant sur un cadre méthodologique avec définition des objectifs, du public ciblé, des acteurs, des modalités d'évaluation envisagées.
2. Conduite à tenir en urgence.
- Mise à disposition de protocoles de prophylaxie après exposition aux risques.
- Liste des référents médicaux à contacter
3. Suivi.
- Renforcement des collaborations entre médecins somaticiens et équipes de soins psychiatriques.
1. Prévention.
- Améliorer la connaissance des pratiques de contraception actuellement utilisées et en favoriser l'accès. Repérer les différentes pratiques, sur les IVG.
- Améliorer l' accès aux consultations d'orthogénie (planning familial, consultation gynécologique ou généraliste).
2. Conduite à tenir en cas d'urgence et suivi.
- Contraception d'urgence : Accès à la pilule du lendemain, au stérilet...
- Développer les collaborations avec les services de gynécologie obstétrique.
1. Définition - Prévention.
- Aspects medicolégaux : information et diffusion du cadre législatif.
- Un groupe de parole pour les médecins et soignants sur « institution et sexualité » apparaît comme une aide pour aborder les problèmes liés à la sexualité en institution.
2. Protocole d'urgence à définir.
3. Protocole de prise en charge des victimes et des agresseurs.
Le groupe de travail auquel vous avez participé continuera de se réunir pour faire le point sur l'évolution des travaux, ceci au rythme de deux séances par an.
Le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris