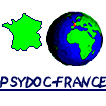
L’intitulé de la question qui nous est posée comporte trois termes dont le choix et l’agencement autour d’un verbe exprimant la nécessité, suscitent en eux-mêmes des interrogations. L’emploi du premier terme, "crise suicidaire", vise de toute évidence à englober l’idéation, les ruminations suicidaires (avant ou après un passage à l’acte), tout autant que les tentatives de suicide, afin de ne négliger aucun aspect. Est-ce à dire qu’une même prise en charge peut s’appliquer indifféremment à l’idéation et au passage à l’acte suicidaire ? Celle-ci concerne-t-elle uniquement le sujet en détresse ou doit-elle également impliquer son entourage ? Le terme "suivi" ne se limite pas seulement au champ médical et comprend deux modalités, l’ambulatoire et l’institutionnel, s’étendant de l’éducatif au sanitaire en passant par le social. Mais même si l’on s’en tient aux conditions du suivi médical pour rester dans notre domaine de compétence, force est d’examiner la question sous l’angle du médecin généraliste et de celui du psychiatre, en nous demandant à partir de quoi et de quand un suivi "spécialisé" s’impose. D’autre part, le mot "suivi" exprime davantage que "prise en charge" la notion de relation thérapeutique s’inscrivant dans la durée, même brève, puisque l’action qu’il sous-tend consiste à "voir" et "revoir" le sujet en souffrance. Dès lors, doit-on assimiler une évaluation approfondie effectuée en plusieurs temps ou sur plusieurs jours à un "suivi" ? Quant à la temporalité introduite par l’expression "suivi à court terme", renvoie-t-elle à la rapidité de sa mise en œuvre ou à la brièveté de son application ?
On le voit, il y a là matière à interprétations diverses, celles-ci pouvant contribuer à expliquer certaines divergences de points de vue entre praticiens. Nous tenterons donc de définir le plus précisément possible les différents niveaux de réponse qui nous semblent devoir être envisagés.
L’effroyable paradoxe du suicide réside dans cette triple dimension (2) :
- le sujet croit connaître les raisons de son idéation suicidaire, alors qu’il en ignore les soubassements profonds, sa volonté de rupture étant la résultante de plusieurs registres superposés (oublier ses difficultés, cesser de souffrir, faire disparaître les problèmes, trancher dans le vif d’une relation aliénante, se distinguer radicalement à travers sa défection provisoire ou définitive, supprimer le corps propre pour devenir un "pur esprit"...) ;
- le sujet se méprend sur son "envie d’en finir", car ce qui l’anime est de "cesser de non-exister", c’est-à-dire d’imposer son existence aux yeux des autres, fut-ce en se débarrassant de sa corporéité pour imprimer à jamais sa place et son identité dans la tête de ceux qui restent;
- le sujet prétend ou cherche à se convaincre que son idéation suicidaire n’engage que lui-même, alors que sa quête éperdue - mourir non pour disparaître mais pour exister - s’adresse toujours à l’autre.
Vouloir anéantir des pensées inacceptables, détruire le corps propre perçu comme un fardeau ou une entrave à la "liberté d’être", attaquer en soi des représentations ineffaçables d'autrui, hanter pour toujours la mémoire des survivants, constituent ainsi plus les termes d’une revendication existentielle désespérée que les traits d’un supposé "désir d'auto-élimination". Ces aspects masqués contribuent d’ailleurs à expliquer l’importance de la culpabilité (et, par voie de conséquence, celle des mécanismes de disculpation défensive) chez les suicidants et leurs proches, culpabilité dont l’intensité douloureuse atteint son acmé chez les familles endeuillées par un suicide.
L’écheveau complexe et "sensible" que constitue la crise suicidaire demande à être dénoué avant qu’il ne soit trop tard, que le sujet soit animé d’idées de suicide ou rescapé d’une tentative de suicide (et donc à haut risque d’une récidive). Dans un cas comme dans l’autre, une prise en charge est indispensable. Son objectif est triple :
- effectuer avec le sujet (et, chaque fois que possible, avec ses proches) un travail de "dépliage" des différents facteurs concourant à la genèse de la crise suicidaire, afin d’identifier la nature et les véritables enjeux de la souffrance ressentie, sachant qu’il serait imprudent, voire irresponsable, de miser sur une éventuelle résolution spontanée de l’épisode, les mêmes causes risquant de provoquer les mêmes effets à court ou moyen terme;
- déterminer les réponses thérapeutiques les plus appropriées pour réduire la souffrance et les symptômes qui lui sont associés, et amorcer un travail d’élaboration psychique pour intégrer, dépasser cette souffrance en lui donnant du sens et se réorienter vers l’envie de vivre;
- définir, chaque fois que nécessaire et en partenariat avec d’autres intervenants, les modalités d’aménagements éducatifs, familiaux et sociaux susceptibles de participer au "rétablissement identitaire" du sujet en détresse et à sa reconnaissance par ses proches, dans le respect des intérêts de chacun et en tenant compte de leur capacité à gérer la situation de crise.
Qui doit assurer cette prise en charge ? Sans sous-estimer le rôle que peuvent jouer en matière de prévention les éducateurs au sens large et tous les "aidants naturels" (professionnels ou bénévoles), nous pensons que le suivi médical - généraliste et, si besoin, spécialisé - doit être considéré comme indispensable, à condition qu’il s’inscrive dans une véritable politique de réseau transdisciplinaire et inter-institutionnel. A condition aussi qu’il ne se confonde pas avec une simple surveillance de prescription médicamenteuse, fut-elle appropriée et tout à fait nécessaire. Quant à la question de savoir si la prise en charge doit être proposée en ambulatoire ou en milieu hospitalier, nous préconisons d’en déterminer l’indication à partir d’une évaluation minutieuse de l’état clinique du sujet, de sa capacité ou non à s’interroger sur le sens de son mal-être et des possibilités qu’a l’entourage d’en examiner de leur côté les tenants et aboutissants. L’hospitalisation du sujet suicidaire est recommandée lorsque l’une, au moins, des situations suivantes est observée :
- Le sujet présente des signes dépressifs particulièrement intenses et/ou des symptômes évocateurs de troubles graves de la personnalité;
- Le sujet se montre réfractaire à toute forme de suivi, bien qu’il exprime des idées de suicide et développe une symptomatologie anxio-dépressive nécessitant un traitement;
- Le sujet semble incapable de lutter seul contre ses ruminations suicidaires et multiplie les appels au secours (demandes insistantes de rendez-vous supplémentaires, sollicitations téléphoniques répétées, etc.) ;
- Le sujet effectue divers passages à l’acte à type de conduites de risque ou de violences auto-infligées, sans parvenir à exprimer son mal-être autrement que dans l’agir;
- Le sujet accepte en apparence le suivi ambulatoire, mais celui-ci ne permet aucune amélioration, voire s’accompagne d’une aggravation des idées de suicide;
- Une séparation provisoire d’avec le milieu familial et professionnel semble indispensable pour que le sujet puisse enfin "se poser" et réfléchir à ses difficultés inter-personnelles;
- L’environnement familial apparaît déficient, toxique ou lui-même débordé par d’autres souffrances.
A ces circonstances qui concernent les sujets suicidaires de tous âges, nous ajoutons le cas particulier des adolescents qui multiplient les conduites de rupture (fugues, mises en danger diverses, ivresses répétées à l’alcool ou au haschisch, "clashs" relationnels itératifs, scarifications et brûlures auto-infligées, etc.) sans toujours les reconnaître comme suicidaires. Réticents à investir d’emblée une prise en charge dont ils ne comprennent souvent ni l’intérêt ni le sens, ces adolescents acceptent davantage les "séjours de rupture" qui leur sont proposés dans des services hospitaliers spécialisés pendant quelques jours. A charge pour de tels services d’offrir un cadre thérapeutique spécifique destiné à approfondir l’évaluation initiale, à initier si besoin un traitement médicamenteux adapté, à faciliter l’orientation vers une structure de soins psychiatriques dans le cas où celle-ci s’impose, et à favoriser l’ébauche d’une élaboration psychique de la crise qui pourra se poursuivre en ambulatoire. Le concept d’unité de crise, tel qu’il est actuellement répandu, nous semble imparfaitement répondre à tous ces objectifs pour au moins deux raisons : la brièveté de la durée de séjour, trop courte lorsqu’elle est inférieure à cinq jours, rendant illusoire une réelle "mise à plat " des difficultés du sujet et de son entourage ; l’insuffisance de conceptualisation d’un véritable "cadre thérapeutique" dont nous pensons que la précision dans la définition des espaces et des temps institutionnels se révèle indispensable pour apaiser la crise et engager une prise en charge appropriée.
Moins de 20 % des jeunes suicidaires ou suicidants ont besoin d’être hospitalisés en service de psychiatrie. Les autres, c’est-à-dire la très grande majorité, sont en crise identitaire et relèvent d’un suivi ambulatoire. Le problème est que pour l’accepter, ils doivent en comprendre le sens et être accompagnés dans cette démarche. C’est pourquoi nous préconisons que les intervenants de psychiatrie de liaison chargés de l’évaluation initiale des suicidants dans les services d’urgence soient étroitement associés aux dispositifs de consultation ou d’hospitalisation proposés en relais. C’est pourquoi encore nous affirmons que la création d’unités de transition dotées d’un cadre thérapeutique spécifique permet d’établir un dispositif-relais essentiel qui ne se confond ni avec une unité de crise ni avec un service de psychiatrie traditionnel. Notre équipe du centre Abadie dispose ainsi de 15 lits accueillant 400 adolescents par an (80 % de suicidants, 20 % de suicidaires) pour une durée moyenne de séjour de dix jours, afin de les préparer à s’investir, dès la sortie, dans un suivi ambulatoire. Notre expérience de huit années de fonctionnement indique que, dans ces conditions, six sujets sur dix s’impliquent ultérieurement dans le suivi proposé.
Si l’on admet cette façon de voir qui repose sur quinze années de clinique suicidologique, on comprend que pour nous toute crise suicidaire impose non seulement une prise en charge initiale mais un suivi ambulatoire ultérieur. Doit-il être défini " à court terme " comme l’interroge la question qui nous est soumise ? Le borner ainsi dans le temps présente le risque de laisser entendre à tort qu’en réponse à la crise - dont la notion renvoie à une durée brève de l’ordre de l’instant, du moment, de l’épisode - serait idéalement proposé un suivi "bref", voire une "intervention-minute". En revanche, les trois points-clés qui nous semblent devoir être retenus sont les suivants : prise en charge initiée le plus rapidement possible ; aménagements spécifiques facilitant un relais ultérieur ; mise en place d’un suivi adapté dont la durée n’est pas d’avance déterminée.
L’offre de soins repose sur plusieurs principes :
- Etablir une relation de confiance
La première règle consiste à nommer la souffrance suicidaire, sans la juger, la banaliser ou la nier. En dehors des cas où le sujet évoque directement son idéation morbide, il faut pouvoir lui dire les inquiétudes que l’on éprouve à son sujet, lorsqu’on le sent en danger. À l’inverse de ce que d’aucuns croient, ce type d’intervention n’a jamais pour effet de "donner au patient des idées noires qu’il n’aurait pas spontanément ressenties". En levant toute ambiguïté, il soulage au contraire le sujet en détresse, le reconnaît explicitement comme tel et lui indique que l’on ne craint pas d’aborder un thème que beaucoup jugent tabou, ce qui autorise le patient à livrer son vécu intime.
La deuxième règle consiste à distinguer formellement confidence, connivence et confidentialité, chaque fois que le sujet cherche plus ou moins consciemment à faire du médecin le "complice" de son projet mortifère ("Je ne le dis qu’à vous", "Je vous demande de respecter ma décision et de ne pas me trahir", etc.), en rappelant que la démarche de soins vise à apaiser la souffrance, non à supprimer la vie, et que le secret médical ne saurait se confondre avec une non-assistance à personne en danger, encore moins à une complicité de meurtre.
- Centrer l’échange sur la souffrance du sujet
Lorsque le sujet accepte d’évoquer ses ruminations suicidaires, l’objectif du médecin ne consiste pas à lui opposer "toutes les bonnes raisons qu’il devrait avoir de rester en vie", à s’efforcer de lui "changer les idées" d’une manière artificielle et plaquée, à le culpabiliser ou à proposer force conseils qui ne rassurent évidemment que celui qui les prodigue. Il ne s’agit pas non plus de s’enliser dans un débat pseudo-philosophique sur les éloges comparés de la liberté de chacun à disposer de lui-même, du droit de vivre donc de mourir, du courage ou de la lâcheté. Le médecin a pour but principal d’amener le sujet suicidaire à restaurer en lui l’envie de vivre en l’aidant à identifier la nature de sa souffrance pour pouvoir y faire face et lui donner un sens. À charge, pour lui, d’éviter les projections personnelles et d’inviter le patient à se poser des questions. En réalité, le sujet en détresse n’attend pas de réponses toutes faites à des problèmes qui lui sont intimes. Il a besoin d’être reconnu, écouté et encouragé à appréhender sa souffrance avec moins de peur et de honte.
- Faciliter la mise en mots des affects
Chez le sujet suicidaire, l’agir - sous toutes ses formes - est vécu comme le seul moyen efficace d’apaiser la souffrance psychique. Il donne au sujet l’illusion d’une maîtrise et vise à diminuer transitoirement les tensions internes en leur donnant une voie de dérivation. Le problème est que celles-ci réapparaissent très vite en l’absence d’élaboration, obligeant le sujet à reproduire des actes en lieu et place d’une parole qui ne parvient pas à exprimer la douleur morale ressentie. Le médecin doit donc inciter le patient à mettre des mots sur ce qu’il éprouve et lui proposer une écoute active. L’important est de ne pas laisser le sujet croire que l’on peut "le comprendre à demi-mot" ou "se mettre à sa place", mais de l’amener au contraire à découvrir que la verbalisation des sentiments et des émotions peut l’apaiser plus durablement que l’agir et lui permettre de faire des liens et des associations donnant du sens à sa souffrance.
- Définir la nature des soins proposés
À partir des propos recueillis et des signes constatés, le médecin doit indiquer au patient ce qu’il pense de son état et discuter avec lui des modalités thérapeutiques à mettre en place, en ambulatoire ou en institution spécialisée. Le choix est évidemment fonction en premier lieu de la gravité de la symptomatologie, mais il dépend aussi de la capacité du sujet à s’investir dans un projet de soins. En présence de signes tangibles de dépression, l’annonce du diagnostic doit se faire sans ambiguïté en utilisant des mots très simples. La prescription de médicaments doit s’assortir des explications et des recommandations ad hoc (bénéfices escomptés, précautions d’usage, posologie, durée, possibles effets secondaires...). Il est également utile d’insister sur le fait que la prise en charge ne se limite pas à la seule administration de psychotropes. On sait en effet que la résolution d’un épisode anxio-dépressif majeur et la prévention des rechutes imposent, conjointement au traitement médicamenteux, un travail d’élaboration psychique destiné à permettre au patient de donner un sens à sa souffrance. Quant aux modalités de la relation thérapeutique, elles doivent être précisées, de même que le principe général de la psychothérapie, lorsqu’elle est retenue, demande à être éclaircie. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'écoute psychothérapique ne consiste pas à prêter une attention passive et silencieuse à une parole manifeste qui ne dirait rien ou qui déviderait en continu une kyrielle de plaintes et de récriminations. Elle n'a pas non plus pour but de fournir des conseils censés amener le sujet à faire des choix qui ne seraient donc pas les siens. Au moyen de modalités particulières qui lui sont spécifiques, c'est à une écoute active qu'invite la psychothérapie, avec pour objectif le rétablissement des différents champs du langage, c'est-à-dire aussi bien le langage intérieur et ses chaînes associatives, que le discours parlé mettant en mots le ressenti et le vécu. Chemin faisant, le travail ainsi produit permet au sujet de composer avec ses propres ressources et de développer des réponses personnelles.
Quoi qu’il en soit, certains patients ne voient pas en quoi telle ou telle prise en charge peut changer leur situation, eux qui attribuent leur idéation suicidaire à une faillite affective et/ou matérielle irréparable. En l’occurrence, il n’est pas rare d’entendre de la part de quelqu’un qui relie sa détresse à une rupture sentimentale : "que pouvez-vous changer à ma situation ?" Le médecin doit alors indiquer que l’aide proposée ne consiste pas à résorber magiquement le problème, mais à permettre au sujet de l’examiner sous d’autres angles, car c’est précisément en évoquant ses difficultés à un tiers non impliqué dans "le problème" que le sujet peut découvrir de nouvelles perspectives qui l’aideront à le résoudre ou à le dépasser.
Face à un patient qui refuse tout soin et qui revendique "qu’on le laisse se suicider", il convient d’opposer un discours et une attitude fermes qui ont d’ailleurs souvent pour effet de rassurer le patient. Dans les cas les plus graves, une procédure d’HDT doit être retenue, l’hospitalisation sous contrainte permettant d’amorcer des soins jusque-là catégoriquement refusés par le patient. L’expérience indique d’ailleurs que la plupart des HDT peuvent être rapidement levées et se poursuivre par une prise en charge à laquelle le patient adhère de plein gré.
La prise en charge du sujet suicidaire a les objectifs suivants :
- Contenir le sujet en souffrance suicidaire
Il s’agit de lui proposer un cadre thérapeutique adapté et tolérable : visite des lieux et lecture commentée avec un soignant du règlement intérieur stipulant ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, les horaires des différentes activités, etc.; inventaire et retrait, dès l’admission et en accord avec le patient, des objets personnels jugés dangereux, sans pour autant aboutir à une "fouille douanière" et à l’instauration de "mesures d’allure carcérale" (remplacement systématique des couverts en métal par des couverts en plastique, confiscation des lacets de chaussures, etc.) qui confondraient contenance et détention ; suppression momentanée des contacts avec l’extérieur lorsque ceux-ci réactivent la détresse du sujet; disponibilité soignante pour répondre aux sollicitations du patient et régulièrement lui proposer des entretiens de soutien ou d’évaluation afin de substituer la parole aux passages à l’acte.
- Evaluer l’état psychique du sujet de manière approfondie
Il s’agit de collecter et d’examiner les arguments cliniques, psychopathologiques et sociaux permettant une appréciation plus fine de la symptomatologie et de la situation socio-familiale considérées. Cette évaluation pluridisciplinaire représente idéalement une synthèse des différentes approches effectuées par chaque professionnel de l’équipe (psychiatre, psychologue, infirmier, assistante sociale...). Elle suppose des temps d’échanges et de concertations institutionnels dont la fréquence et la régularité contribuent à la stabilité du cadre thérapeutique. Lorsqu’une conduite à tenir est définie, les dispositions qui en découlent doivent être discutées avec le patient, ses proches et le médecin traitant afin d’obtenir leur adhésion et leur alliance.
- Initier ou modifier le traitement
Il s’agit d’articuler les différentes modalités de soins de façon synergique (chimiothérapie, entretiens d’élaboration, groupes de parole, activités d’expression, etc.) que la prise en charge en ambulatoire ne permet pas en situation de crise. Il est à cet égard capital que le médecin traitant soit étroitement associé aux décisions retenues.
- Permettre une médiation effective entre le sujet et son entourage
Il s’agit de constituer un espace tiers susceptible de les aider - séparément puis ensemble - à prendre la mesure de leurs dynamiques personnelle et familiale et à identifier, au moins en partie, les enjeux de leur détresse. L’hospitalisation permet d’entériner la souffrance du sujet et, dans un premier temps, de se centrer sur elle; mais elle doit rapidement déboucher sur la restauration du dialogue entre le sujet et ses proches.
- Déterminer les modalités optimales de suivi ultérieur
Il s’agit de prendre en compte l’évolution du patient, ses besoins d’accompagnement ou de soutien, ses possibilités d’implication dans un travail d’élaboration psychique, la qualité de l’étayage familial et social, etc. Là encore, plus les soignants s’interrogent précocement sur la forme et le contenu des soins à poursuivre en post-hospitalisation, plus ils associent le médecin traitant à cette démarche, plus ils impriment une dynamique qui facilitera la prise en charge ultérieure. Le séjour en institution doit en effet avoir pour objectif de préparer le patient à des relais ambulatoires futurs pour éviter qu’il ne s’"installe" dans une position passive et régressive "en marge de la vraie vie", même si cet axe thérapeutique nécessite des réhospitalisations ou des aménagements transitoires (hôpital de jour, de nuit...).
En pratique, nombre de médecins se sentent démunis devant un patient suicidaire et la nécessité d’un suivi à court terme se heurte à plusieurs obstacles :
- Le manque de formation des médecins généralistes
L’approche de la psychiatrie reste insuffisante dans l’enseignement de la médecine, tant du point de vue théorique que clinique. En médecine générale, les symptômes dépressifs le plus souvent repérés sont la fatigabilité, les troubles du sommeil et l’anxiété (4), d’où la fréquence des réponses thérapeutiques dirigées sur ces seuls signes. D’autre part, la formation psychiatrique succincte reçue pendant ses études ne permet au généraliste de se familiariser avec les techniques d’entretien et d’écoute. Dès lors, il ne sait pas toujours établir une relation thérapeutique souple évitant "l’interrogatoire" rigide au profit de questions simples mais directes permettant au patient d’extérioriser des ruminations pessimistes, une réduction des intérêts, une anhédonie. Certains praticiens interrogent rarement sur les idées suicidaires, craignant à tort de les susciter par leurs questions. Une autre difficulté réside dans le seuil de sévérité à retenir. En l’absence de critères spécifiques, le médecin est tenté de prendre en compte les répercussions sur le fonctionnement social du patient, bien plus que la sévérité des symptômes dépressifs eux-mêmes.
- L’ambivalence des patients suicidaires
Les études épidémiologiques indiquent que le nombre de patients suicidaires ayant consulté un médecin généraliste dans les semaines précédant leur passage à l’acte, est non négligeable : 20 % des suicidés l’ont fait dans la semaine précédente, 83 % dans l’année, la densité de consultation augmentant à mesure que l’on se rapproche du suicide (5). Les patients en détresse psychologique qui consultent un médecin sont donc en attente d’une aide. Il leur est cependant très difficile de faire état de leur idéation suicidaire, par peur d’être jugés ou incompris par un interlocuteur dont ils veulent conserver l’estime. Ils appréhendent "l’étiquette psy" et cherchent souvent à présenter leurs plaintes d’une manière "logique", quitte à taire certains aspects de leur souffrance. C’est sans doute aussi la crainte de décevoir l’autre par un "aveu de faiblesse" qui explique pourquoi les patients suicidaires ne consultent pas toujours LEUR médecin habituel mais un autre praticien, comme l’indique une enquête récente effectuée dans cinq régions françaises (6). Quoi qu’il en soit, ils évoquent des préoccupations somatiques, expriment des allusions plus ou moins voilées, se perdent dans des détails conjoncturels, etc., en espérant secrètement que le médecin saura "lire entre les lignes" et reconnaître leur détresse. Leur demande ambiguë pourrait se résumer de la manière suivante : "Je vais mal mais je ne parviens pas à vous dire à quel point; à vous de le voir et de m’aider à l’exprimer si vous voulez que je vous fasse confiance". Il n’est pas rare que la démarche de certains patients suicidaires soit totalement paradoxale : ils envisagent la consultation d’un médecin à la fois comme un "ultime recours" et comme la dernière preuve d’échec qui leur manque pour définitivement se convaincre que "l’on ne peut plus rien pour eux". Dans de tels cas, plus le praticien se montre désarmé, incapable de nommer leur souffrance et d’évoquer le caractère ambigu de la "demande", plus ces patients se sentent abandonnés et incompris. C’est la raison pour laquelle le médecin doit proposer une alliance thérapeutique qui imprime en retour une demande au patient ("Je vois que vous souffrez mais je ne peux vous aider qu’avec votre participation. NOUS devons sortir de cette impasse qui nous rend otage de votre détresse"). En la matière, l’empathie, le respect et l’authenticité du médecin peuvent fonctionner comme de véritables leviers thérapeutiques capables d’écarter réticences et ambiguïtés du patient.
- La solitude du médecin dans sa conduite à tenir
L'intervention "à chaud" du médecin généraliste au domicile d'un patient ayant fait une tentative de suicide (TS) ne se limite pas à l’assistance somatique. D’ailleurs, les situations les plus délicates à gérer ne sont pas celles où le transfert immédiat du suicidant en milieu hospitalier s'avère indiscutable. Ce sont au contraire celles qui autorisent a priori toutes les discussions, le passage à l'acte étant d'apparence minime. Le médecin est alors souvent l’objet de multiples pressions émanant du patient lui-même, réfractaire à l’hospitalisation proposée, de son entourage qui craint le qu’en-dira-t-on et qui est tenté d’annuler un acte interrogeant la dynamique familiale, ou de certains urgentistes sollicités par téléphone qui estiment l’acte trop bénin pour justifier une admission. Le fait est que l'on estime à 20 ou 30% la proportion des TS ne conduisant pas à une hospitalisation, surtout lorsque celles-ci impliquent des sujets jeunes (6). La banalisation, le déni ("Il ne s’est rien passé") ou la crainte d'une dramatisation exagérée sont en grande partie responsables de tels évitements. Cette négation de l'acte suicidaire est malheureusement source de récidives, car certains sujets en détresse réitèrent leur geste avec plus de violence pour que leur souffrance soit entendue. Dans l'expérience de notre équipe, 75 % des suicidants récidivant à très court terme - c’est-à-dire dans les trois mois - n'avaient pas été hospitalisés lors de leur précédente tentative (2).
En réalité, adresser un suicidant aux urgences est, la plupart du temps, préférable à toute autre disposition, à la fois pour des raisons somatiques et psychologiques. Du point de vue strictement physique, les arguments ne manquent pas (effet retardé de certains produits absorbés, incertitudes concernant la nature exacte des produits en cause, congruence variable entre la dangerosité potentielle d’une substance et l’altération de l’état de conscience qu’elle induit, potentialisation entre eux des toxiques ingérés, etc.). Du point de vue psychologique, si une TS sévère dans ses diverses composantes (préméditation, forte intention de mourir, précautions prises pour ne pas être découvert, répercussions somatiques importantes) engage naturellement le médecin à se montrer réservés quant à l’état psychologique du sujet, il serait faux de croire qu’une TS de moindre gravité somatique correspondrait à une souffrance psychique minime. Que le suicidant parle d’un désir de mourir, de dormir ou d’oublier, l'adresser aux urgences - même si son état somatique ne semble pas l’imposer - répond à une exigence : reconnaître et gérer l’expression d’une volonté de rupture qui demande à être contenue et évaluée hors du milieu familial.
Or, le médecin généraliste est confronté à trois types de problèmes :
- Il doit parvenir en un minimum de temps et dans des conditions souvent sommaires à expliquer le bien-fondé de sa décision d’orientation à un patient et à un entourage fréquemment opposés à une telle décision;
- Il doit pouvoir compter sur la cohérence de l’institution hospitalière dans son rôle de médiateur et de tiers, en accueillant tous les suicidants, y compris ceux dont l’état physique semble loin d’être critique, et en relayant les soins somatiques par une évaluation médico-psycho-sociale approfondie in situ;
- Dès la sortie de son patient, il doit avoir rapidement connaissance des conclusions de l’équipe hospitalière, ce qui est encore loin d’être le cas. Un omnipraticien sur cinq seulement est contacté par le service de soins où le patient a été hospitalisé (6). Nombreux sont les praticiens qui reprochent à l’institution hospitalière le manque de communication et de coordination avec eux, le retard et le caractère trop peu explicite des courriers qui leur sont adressés, l’absence de contacts spontanés de la part des services hospitaliers, la trop courte durée des hospitalisations, les délais trop longs pour obtenir un rendez-vous ultérieur de consultation psychiatrique, etc.
- La crainte de la "psychiatrisation"
Lorsque leur médecin généraliste évoque avec eux l’utilité d’un "relais psy", beaucoup de suicidants sont a priori réticents, par peur de tout ce qui touche à la folie ou par conviction erronée de connaître la nature de leurs difficultés. Ces patients sont en effet dans l'incapacité de s'investir dans un projet thérapeutique dont ils ne perçoivent ni l'intérêt ni le sens. En panne d'élaboration psychique, ils sont aussi très souvent en attente d'une résolution magique de leurs conflits, misant sur l'oubli, la fuite ou la subite compréhension de leur entourage. Pour aplanir ces résistances et accompagner les patients dans une démarche de soins appropriée, le rôle du médecin traitant est primordial. Mais l’omnipraticien doit accepter d’être le pivot autour duquel s’organise la prise en charge et il doit être reconnu comme tel par l’entourage et ses confrères spécialistes amenés à intervenir. Or, de nombreux médecins généralistes font état de difficultés à ces différents niveaux:
- Certains praticiens considèrent la psychiatrie comme une spécialité "à part", aux confins de la médecine, avec des logiques et des fonctionnements flous ou incompréhensibles. Cette attitude de défiance n’est pas seulement liée à l’ignorance de cette spécialité; elle est largement amplifiée par l’hermétisme de certains "thérapeutes" et leur absence injustifiée de volonté de collaboration transdisciplinaire;
- D’autres praticiens se sentent prisonniers des intérêts contradictoires du suicidant et de ses proches et ne parviennent pas à passer le relais, craignant la stigmatisation ou la dramatisation abusive autour de la notion de "troubles mentaux". Au delà de leurs propres réticences éventuelles vis-à-vis de la psychiatrie, ces médecins perçoivent mal leur rôle de médiateur et de tiers référent;
- D’autres enfin, les plus nombreux aujourd’hui, déplorent le manque de correspondants psychiatres et les délais anormalement longs pour obtenir un rendez-vous.
Tous ces aspects méritent des améliorations et une plus grande concertation inter-professionnelle. Les réticences du patient pour accepter un "relais psy" sont souvent liées à celles de l’entourage et aux diverses résistances médicales plus ou moins conscientes émanant du praticien ou de ses correspondants. Afin que le sujet n'éprouve pas un sentiment d'abandon ou de rejet, le médecin doit lui expliquer pourquoi un tel relais est souhaitable et ce qu'il convient d'en attendre. Ce peut être parce que les symptômes présentés nécessitent un avis spécialisé, voire imposent l'instauration et la surveillance d'un traitement chimiothérapique spécifique. Il est important de dire à un patient que les troubles qu'il présente ne disparaîtront pas d'eux-mêmes et que l'aide d'un psychiatre est indispensable. Ce peut être aussi parce que l'écoute simple, même attentive, n'apparaît plus suffisante. L'indication d'une psychothérapie est alors à discuter. Cela suppose que l’omnipraticien collabore avec des correspondants thérapeutes dont les méthodes lui sont connues et qui acceptent de recevoir les patients adressés, même si l’indication d’une psychothérapie reste encore à évaluer. Préalablement informés et préparés à cette démarche par leur médecin, ces patients-là investiront d'autant mieux le relais proposé qu'ils en auront compris le sens et l'utilité potentielle, et qu'ils ne vivront pas ce passage comme un abandon qui ne dirait pas son nom. Cette articulation entre omnipraticiens et professionnels de santé mentale est incontestablement l'un des maillons essentiels du réseau transdisciplinaire requis pour la prise en charge des patients en détresse suicidaire.
1. POMMEREAU X, Approches thérapeutiques du suicide de l’adolescent, La Revue du Praticien, 1998, 48 : 1435-1439.
2. POMMEREAU X, L’adolescent suicidaire, Paris : Dunod, 1996, 238 p.
3. POMMEREAU X et Coll, Dépression et suicide, Programme de Recherche et d’Information sur la Dépression, SmithKline Beecham éd., 2000, 64 p.
4. BOYER P et Coll, Dépression et santé publique, Données et réflexions, PRID, Acanthe, Masson, SmithKline Beecham, Paris, 1999.
5. PIRKIS J, BURGESS P, Suicide and recency of health care contacts. A systematic review. Br J Psychiatry, 1998, 173 : 462-474.
6. Prévention des suicides et tentatives de suicide : Bilans régionaux. Etat des lieux 1995-1997. Paris : Prémutam, 1998 : 25-33.
Dernière mise à jour : dimanche 29 octobre 2000 19:36:11 Monique Thurin
| | | 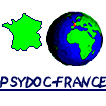
|