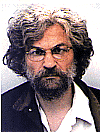Modalités du sevrage des opiacés
Proposition, négociation et adaptation des conditions pratiques du sevrage
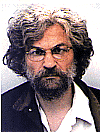
Dr Marc VALLEUR
Centre Médical Marmottan
Créé en 1971 par Claude Olievenstein, pour accueillir et prendre en charge des toxicomanes lourds, le Centre Médical Marmottan reste en 1997 l'un des rares lieux en France disposant spécifiquement d'une hospitalisation pour le sevrage.
Du début des années 70 à 1996, les toxicomanes en France ont, pour la majorité, été des héroïnomanes.
Même si la vocation de Marmottan dépasse le simple cadre du sevrage, et si l'abstinence n'est en rien le passage obligé de toute prise en charge, il est raisonnable de considérer que ce centre a développé, au fil des ans, une expertise certaine en la matière.
La base principale des réflexions présentées ici est donc la pratique instituée dans le service toxicomanie du centre Marmottan.
Il est bien évident que la pratique d'un lieu aussi spécifique ne peut que donner des indications générales, et non constituer un modèle rigide, transposable dans des cadres institutionnels différents (médecine de ville, hôpitaux généraux, C.H.S, C.M.P, et plus encore, milieu carcéral, etc.).
L'étude de la littérature internationale montre d'ailleurs une très grande diversité des approches, et la persistance de fortes polémiques depuis des décennies.
Aux États-Unis par exemple, les études portent tant sur la "maintenance" à la méthadone (la majeure partie des publications en matière d'opiacés concernent la méthadone, non l'héroïne, et "le toxicomane" américain est cocaïnomane, plus qu'héroïnomane) que sur des traitements résidentiels (dont des communautés thérapeutiques, parfois très dures, peu médicalisées, pratiquant le "sevrage-bloc"), ou sur des traitements "de conversion", basés sur les douze étapes d'Alcooliques anonymes / Narcotiques anonymes.
Les études étrangères, notamment nord-américaines, si scientifiques soient-elles, ne sont d'autre part pas purement et simplement transposables à d'autres pays : les modalités de l'usage des drogues, la vie quotidienne d'un toxicomane, dépendent beaucoup du contexte historique, social, et culturel. Les modes de prise en charge sont très influencés, non seulement par l'organisation sanitaire des pays concernés, mais aussi par les cadres légaux réglementant l'usage des substances illicites...
Il est douteux qu'un consensus scientifique puisse, dans un tel contexte, être exempt d'enjeux sociologiques de pouvoir, de volonté corporatiste d'appropriation d'un champ d'intervention.
Plus qu'un consensus d'ailleurs, la diversité des réponses, si elle est alliée à une possibilité de choix libre et éclairé pour le sujet concerné, pourrait être le meilleur garant d'une adéquation entre les besoins et les offres de soin.
De la désintoxication au sevrage
Réduire au sevrage la prise en charge des sujets toxicomanes serait une erreur qui nous ramènerait aux conflits qui agitèrent le monde médical dans la dernière partie du XIXème siècle, autour des cures de sevrage, qui pour certains devinrent des "cures de désintoxication". Avec J.J. Yvorel, on peut rappeler que les débats firent rage entre partisans de la méthode de suppression brusque (la "méthode allemande" de Levinstein), et les partisans de la cure lente, dégressive (la "méthode française", adoptée par Ball, Pichon, etc.).
Laurent Tailhade répartit ses critiques contre les deux méthodes : de la première, dont la cruauté choque, certains patients ont même "l'indélicatesse d'en mourir" (les toxicomanes de l'époque étaient parfois âgés, et peu aptes à supporter un "sevrage-bloc"), de la deuxième, les patients sortent en général plus dépendants qu'à l'entrée, et délestés de leur argent par des médecins "marchands de soupe"...
Erlenmeyer proposera une plus raisonnable "méthode rapide", où la cure de morphine dégressive est ramenée à une dizaine de jours.
Il est aujourd'hui assez généralement admis que le traitement d'une toxicomanie doit s'étendre sur des années, et que le sevrage n'en est ni le centre, ni même le passage obligé : les "traitements d'entretien" au long cours, sont basés sur le principe d'une gestion de la dépendance aux opiacés : l'initialisation de ces traitements ne passe pas forcément par une phase de sevrage.
Les modalités pratiques de prise en charge du sevrage ne concernent donc qu'une petite part du long travail d'accompagnement des patients toxicomanes : nous sommes bien loin du fantasme de la "désintoxication".
Le syndrome de sevrage
Il s'agit donc de rendre tolérable les douleurs physiques, et la souffrance psychique liées à la phase de manque, dans le cadre d'une démarche volontaire d'arrêt de la prise de drogues...
Des échelles standardisées : échelle de sevrage d'Himmelsbach, échelle de Wang, Opiate Withdrawal Scale (version longue, ou brève), permettent de mesurer objectivement et / ou subjectivement l'intensité des différents symptômes de sevrage.
Nous pouvons utiliser une grille synthétique, dans laquelle les symptômes sont regroupés en quatre groupes :
|
Psychique
Insomnie
Angoisse
Signes dépressifs
Agitation/excitation
Envie de came
Fatigue/Faiblesse
| Digestif
Nausées/Vomissements
Constipation
Diarrhée
Crampes d'estomac
Anorexie
| Algique
Douleurs musculaires/"osseuses."
Autres douleurs viscérales
| Neurovégétatif
Rhinorrhée
Frissons
Sueurs
Chaud et froid
Baillements
Chair de poule
Tremblements
Mydriase |
Principes généraux
- Le volontariat
C'est sans doute l'élément le plus important pour décider du bien-fondé de la démarche de sevrage :
Des problèmes se posent ici à plusieurs niveaux :
Déjà De Quincey se moquait de Coleridge, qui demandait à ses serviteurs de l'empêcher de pénétrer dans la pharmacie pour acheter du laudanum : cette résolution était toujours valide... pour le lendemain.
Le cadre thérapeutique et le contrat (v. plus loin) tendent à prendre en compte cette dimension de "différence entre la volonté et le désir".
- La gratuité et l'anonymat
Sont garantis par la loi du 31/12/70 aux toxicomanes volontaires pour se soigner. Comme nous partons du principe que le volontariat est une condition préalable au sevrage, ce devrait donc être la règle.
Ajoutons que la stigmatisation liée à l'usage de drogues est telle, qu'une dépénalisation de cet usage ne suffira sans doute pas à rendre caduque la disposition concernant l'anonymat.
Ce principe, qui redouble le secret professionnel, permet d'éviter les intrusions d'instances extérieures dans le dispositif soignant.
En pratique, nous connaissons bien sûr le nom de nos patients. Mais nous ne demandons jamais de papiers d'identité, et pouvons faire des dossiers sous pseudonymes. Même notre carnet à souches hospitalier n'est pas nominatif.
Cette disposition du droit à l'anonymat se heurte souvent à des réalités administratives, en dehors des centres de soins spécialisés. (Il faudrait réfléchir par exemple à des procédures anonymes de prescription de stupéfiants).
La gratuité n'est pas liée à l'anonymat, mais est une garantie d'accès aux soins pour tous. Rien dans la pratique ne justifie l'idée que payer, pour un sevrage, aurait quelque valeur thérapeutique.
- Le cadre et le projet thérapeutiques
Le sevrage : prestation de service ou moyen d'accompagnement au long cours ?
Le centre Marmottan, d’abord centre d’accueil, s’est structuré en fonction de l’idée qu’il ne pouvait exister de traitement “standard”, à partir des demandes manifestes, patentes, de nos clients, plus comme un lieu de prestation de services, que comme un établissement proposant un programme thérapeutique bien défini.
Traitements ponctuels en ambulatoire, hospitalisations pour sevrage, aides sur le plan médical ou social, constituent toujours l’essentiel de notre pratique quotidienne. La prise en charge, l’accompagnement au long cours, s’instaurent progressivement, pour une partie de notre clientèle, en fonction de la qualité de relation qui s’établit au fil du temps. Les psychanalystes ont coutume de considérer que dans une cure, la guérison arrive comme un effet secondaire, “de surcroît”. Ici, c’est l’engagement même dans un processus thérapeutique qui arrive comme “en plus”...
Il n'y a donc guère à négocier, ou à faire une analyse de demandes latentes, qui ne seraient que masquées par la demande manifeste : il s'agit d'abord d'accepter d'aider une personne en situation de détresse, et, par la suite, de voir si l'aide apportée peut mener à une démarche thérapeutique au long cours.
Le but de cette approche pourrait être d’adapter l’accompagnement à l’infinie diversité des cas individuels, y compris quant aux objectifs à atteindre.
Le moteur de cet accompagnement non coercitif au long cours serait la relation à un thérapeute référent, garant d’une continuité, mais dans un cadre éminemment intersubjectif : l’institution joue le rôle de tiers, ou de contrôle, dans ce qui reste avant tout une relation entre deux personnes.
(Nous sommes en quelque sorte à l’opposé d’une relation médecin - malade, où il s’agirait de diagnostiquer, de lire des symptômes au delà de la relation, et de traiter une maladie, dont le corps du sujet ne serait que le support. Cette différence de logique explique le caractère répétitif des tensions entre le monde de la médecine, de l’hôpital, et celui des intervenants en toxicomanie. Les tensions sont nettes, autour des interactions entre services, quand un “client” d’une institution spécialisée est aussi “malade”, suivi dans un service de maladies infectieuses : les divers intervenants ne parlent pas du même point de vue, donc pas tout à fait du même corps, du même sujet...).
Cette importance première de la relation individuelle, intersubjective, pose deux séries de problèmes, qui sont probablement en fait étroitement interdépendantes :
Nous sommes donc très loin d’une volonté de traiter tous les toxicomanes, et nous n’avons guère les moyens de définir des modèles de programmes de soins standardisés.
La question du contrat
La notion de contractualisation des pratiques est aujourd’hui fort galvaudée, en toxicomanie particulièrement, mais aussi dans l’ensemble des champs d’intervention sociale. Trop souvent, la référence au contrat est une simple pétition de principe. Les glissements de sens, du contrat à la règle, peuvent correspondre à une déviation des buts de cette contractualisation : protection des institutions et des intervenants, plus que respect du patient, du client, du bénéficiaire.
Rappelons donc que le contrat, “convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”, implique un certain nombre de conditions, et doit se différencier, de la parole, mais surtout de la règle, du règlement.
Un contrat suppose une parité entre les parties, une position d’égalité qui, seule, permet une adhésion authentique.
On peut admettre que notre pratique consiste à considérer nos clients comme adultes et responsables, donc en mesure de passer d’authentiques contrats. Mais ce contrat, passé en quelque sorte avec la “part non malade” du sujet, pose certains problèmes, et constitue souvent autant un moyen et un but de la prise en charge, qu’un préalable intangible. Pour protéger une partie de lui-même contre une autre, un sujet pourrait être tenté d’accepter un contrat léonin, de renoncer à sa capacité de négociation, de se soumettre, après la dépendance à la drogue, à une autre forme d’aliénation. Il est essentiel qu’un thérapeute ne se croie pas réellement investi d’une toute puissance, ou plutôt que le cadre institutionnel ait toujours une fonction de garant de la pratique contractuelle : le contrat peut ainsi être basé sur une parole, sur l’engagement réciproque de deux personnes, mais dans un cadre médiatisé par l’institution.
Cela implique un engagement réel des soignants, et non l’application creuse de quelque rituel. Cela suppose aussi de prendre les moyens pour que le client soit le plus libre possible de son choix. (C’est pourquoi il serait impossible de passer un contrat avec l’entourage, le conjoint, etc, au nom de quelqu’un d’autre).
Dès le premier accueil le contrat doit être explicité, ou considéré comme implicite : le volontariat par exemple peut nécessiter de faire revenir seul un client accompagné, par des parents, des amis, un conjoint...
Le pendant de la convivialité souhaitable à l’accueil est le respect du lieu et de sa vocation : deal, plans, consommation de produits sur place ne sont guère plus tolérables que la violence.
- A l’hospitalisation, s’ajoutent à ces règles l’absence de sorties et de visites, comme de téléphones personnels. la fouille lors de l’entrée.
Les “ruptures de contrat” sont en quelque sorte incluses dans le contrat général (droit de partir à tout moment).
Les durées d’hospitalisation sont renégociables en cours de séjour, et les durées prévisionnelles doivent être modulées en fonction des clients, comme des produits en cause. (p. ex. plus de 8 jours pour codéine, buprénorphine, 2 semaines voire plus pour méthadone...).
De même le seuil d’exigence doit au maximum être adapté au cas particulier de chaque client. Venir totalement "clair" peut être difficile pour certains. Dormir la journée est plutôt souhaitable aux débuts d’un séjour pour sevrage de crack, coke, ou amphétamines... De façon générale, nous pensons que plus l’engagement des soignants est authentique, moins l’application de règles se fera de façon rigide.
L’institution n’a pas qu’une fonction maternante, ou groupale (identité), mais aussi une fonction “paternante”, de rappel de limites, voire dans certains cas, de confrontation.
Les "vidages" (mises à la porte pour violence, deal, prise de drogue...) et tricardages (temps d'interdiction de séjour, pour une durée variable...) ont leur fonction thérapeutique dans une prise en charge au long cours. Souvent les transgressions sont des reproductions ou répétitions d’agirs faisant partie d’un mode de vie. Les sanctions ne sont pas à concevoir comme quelque programme de punition-récompense, mais comme la transposition d’un vécu, dans ce qui joue le rôle de lieu transitionnel. Transgressions et sanctions finissent par déboucher sur une parole, une symbolisation.
Mais il faut toujours se méfier de la possibilité de dérive institutionnelle, de la tentation d'exclusions visant le confort des équipes : le contrat, appliqué de façon rigide, serait alors un outil, non de prise en charge, mais de sélection des clients les plus faciles et les plus dociles...
Ces bases générales doivent pouvoir se retrouver dans les divers lieux d'hospitalisation, comme dans les cadres de sevrages organisés en ambulatoire.
- La question des rechutes
Dans cet accompagnement, il apparaît le plus souvent que la dépendance aux drogues n’est qu’un élément participant d’un style de vie, et qui peut, à certains moments, ne pas être le problème essentiel : la délinquance, la prostitution, la violence, les difficultés psychologiques, familiales, sociales, ne peuvent se résoudre qu’au terme d’un long cheminement, et après de nombreuses périodes de crise. La “rechute”, non seulement peut faire partie d’un processus de maturation, mais elle est souvent la meilleure réponse que trouve le sujet pour faire face à ses difficultés : plus qu’à une “prévention des rechutes”, nous travaillons à une maturation progressive des sujets, dans laquelle les rechutes sont à intégrer comme partie du processus.
Si l’on admet que les rechutes font partie d’un processus de maturation au long cours, nous devons travailler en fonction de ces étapes prévisibles : d’abord, très concrètement, en apprenant à nos clients à éviter les surdoses accidentelles, liées à la diminution de la tolérance après un sevrage, comme à éviter dans l’avenir, (même s’ils sont persuadés de ne plus reprendre de drogues), les contaminations par usage de seringues souillées.
Ensuite, en diminuant la culpabilité et la dramatisation de ces rechutes, ou de ces “dérapages” : nous ne faisons plus, au moins pour les premières tentatives, du temps d’abstinence après un sevrage, un critère d’évaluation de notre action. Un meilleur critère serait, au contraire, la facilité pour un client de revenir nous voir, après avoir rechuté.
Permettre à un maximum de personnes d’accéder à l’institution, et garder le contact avec un maximum d’entre eux, sont nos premiers objectifs, pour que s’instaure une prise en charge dont les résultats ne pourraient être évalués qu’après plusieurs années.
Il est évident qu’un tel style d’accompagnement non coercitif au long cours, non seulement ne devrait pas s’opposer à des stratégies de réduction des risques, mais implique cette réduction des risques comme un complément naturel.
Le but du traitement n’est ici pas l’abstinence en soi, mais une plus grande souplesse de fonctionnement du sujet, un accroissement de sa possibilité de faire des choix.
Question de pratique : de quoi décrochent les dépendants aux opiacés ?
Depuis quelques années, le profil des "toxicomanes" se modifie, notamment en ce qui concerne les substances utilisées. Nombre d'entre eux continuent à se dire héroïnomanes, mais sont en fait dépendants d'autres opiacés, de benzodiazépines, d'alcool...
A titre d'exemple, voici les chiffres concernant les hospitalisés pour sevrage au Centre Marmottan, en 1997 :
Au niveau de l'ensemble des produits utilisés, l'évolution est encore plus nette :
Il est donc évident que les techniques d'accompagnement du sevrage, notamment quant aux chimiothérapies, et aux durées du traitement, doivent tenir compte de ces polydépendances.
Le sevrage en ambulatoire
Lorsque les conditions de vie du sujet le permettent, il est possible d'organiser le sevrage en consultations ambulatoires. Les sevrages dégressifs sur quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, transition entre traitement d'entretien et sevrage (méthadone, buprénorphine) devraient augmenter. Nous utilisons le plus souvent le propoxyphène (antalvic), associé à des anxiolytiques et hypnotiques, en cures dégressives, sur une à deux semaines.
Deux points doivent être soulignés :
Le sevrage en milieu hospitalier
- Hospitalisation spécialisée
Depuis bien longtemps l'équipe de Marmottan ne croit plus en la magie d'une "cure de désintoxication", pas plus qu'en une prise en charge linéaire qui viserait de façon standardisée à la production d'individus abstinents.
La cure de sevrage n'est qu'une scansion dans le cadre d'un accompagnement au long cours, permettant au sujet de remettre en question tous les aspects de son existence.
L'hospitalisation ne constitue donc qu'une petite part de l'accompagnement proposé par Marmottan, mais elle est aussi un moment riche, complexe, intense, souvent déterminant pour l'avenir.
A trop souligner que le sevrage physique n'est qu'un détail, à trop dénoncer les vieilles croyances médicales en la magie de la cure, nous risquons d'occulter cette intensité d'un temps de manque accepté et vécu en groupe.
L'urgence apparente, parfois la violence des demandes d'hospitalisation traduisent la blessure narcissique, l'humiliation, le constat d'échec fait par un sujet : la drogue l'a aidé à vivre, à être différent, mais elle n'a été qu'une solution provisoire. Il n'a pas été plus fort que les autres et il n'arrive plus à s'en sortir tout seul.
Pour un thérapeute, et particulièrement un psychiatre psychanalyste parisien, recourir à l'hospitalisation est aussi le constat de ses limites : l'écoute ne suffit pas toujours, la relation singulière doit s'accommoder de moments de prise en charge institutionnelle, partagés en équipe.
La plupart des tensions entre médecins et infirmiers, entre Accueil et Hospitalisation, ne tient qu'à cette dialectique de l'individuel et du collectif : elles soulignent la difficulté à personnaliser l'accompagnement de chaque patient, à faire en quelque sorte du sur-mesure, voire de la haute couture, dans le cadre d'un travail à la chaîne...
Dans certains cas, une première hospitalisation a valeur essentiellement diagnostique : les changements spectaculaires en quelques heures ou quelques jours, traduisent la qualité singulière d'un mal de vivre que les effets de la drogue et des médicaments, le vécu quotidien et stéréotypé de la "galère" avaient pour fonction d'occulter. Nous ne savons alors qu'après cette épreuve, ce "bain des sorcières" si le client (normal ? névrosé ? pervers ? psychopathe? psychotique ?...) a les moyens de respecter la loi de l'institution, le contrat et les règles minimales de la vie en groupe.
Mais pour les anciens, la répétition des sevrages ne les rend guère plus faciles. Heure par heure, jour par jour, il faut tenir, vivre l'excès de présence d'un corps longtemps absent, anesthésié, oublié. La panique, les moments d'angoisse débordante sont bien connus des infirmiers : angoisse du début de la nuit, rappelant les moments d'aller galérer, chercher de la came. Panique à certaines heures, celles où précisément le dealer pourrait être là, à quelques stations de métro. En laissant chaque hospitalisé libre à tout moment de partir, nous évitons la dangereuse sécurité d'une contrainte extérieure. Cette difficulté des moments de doute est corollaire d'une expérience de liberté : seuls les clients peuvent "décrocher". Nous ne faisons que les y aider.
Le jour, la nuit, les infirmiers parlent, écoutent, participent à diverses activités. Surtout ils évitent la constitution de petits clans, les "plans", l'introduction d'une ambiance de "squatt" ou de défonce, tentations permanentes du groupe visant à esquiver les angoisses de chacun.
En faisant le bilan d'une année, nous serions aussi tentés de ne retenir que les moments les plus durs : accès de violence, "vidages" difficiles après une introduction de came, transgressions du contrat et leurs sanctions agies avant d'être parlées.
Ce serait oublier que pour une majorité les hospitalisations se sont "bien passées". Et que réussir à retrouver un certain rythme de vie, la différence entre le jour et la nuit (rêver... d'abord de poudre, puis d'autre chose...), partager les activités les plus anodines peut constituer une étape importante.
Vivre simplement la banalité du quotidien dans le respect mutuel : en période calme, le miracle ordinaire de l'expérience d'une nouvelle vie prend, pour un observateur extérieur, la forme lisse d'un groupe mal différencié, luttant par l'humour contre les tensions, par la parole et les activités diverses contre l'ennui...
Une majorité d'hospitalisations menées à terme sont des réhospitalisations. Les réunions hebdomadaires avec les clients montrent souvent l'hétérogénéité du groupe quant à l'évolution de chacun. Souvent nous soulignons le fait que la "rechute" est possible, et que l'important est de ne pas la dramatiser, de se donner le droit de revenir.
Ainsi les hospitalisés apprennent-ils peu à peu à renoncer à certaines croyances, au mythe de la "volonté", et à éviter la dramatisation de la "violation de l'abstinence".
L'urgence des demandes d'hospitalisation est le plus souvent plus psychologique que réelle : elle traduit une crise personnelle, la panique de l'entourage, parfois une pression de la police ou de la justice. Ces demandes méritent donc un minimum d'analyse et d'éclaircissements préalables (enjeu de la rencontre entre le client, son médecin et un infirmier). Mais nous avons toujours tenu à respecter deux principes essentiels :
- Autres lieux hospitaliers, chimiothérapie
Que ce soit en hôpital général ou en hôpital psychiatrique, existent des unités spécialisées, qui peuvent fonctionner sur les mêmes principes.
L'investissement humain important qui existe au Centre Marmottan nous conduit à accorder plus d'importance aux activités, à la qualité de la présence et de l'encadrement, qu'à la chimiothérapie proprement dite.
(20 infirmiers pour 16 lits de sevrage nous permettent une grande disponibilité, la nuit comme le jour. Sauna, massages, relaxation, salle de sport, groupe philo, réunions, etc... jouent un rôle important).
Les traitements proposés doivent être adaptés au cas par cas.
Nous utilisons particulièrement la guanfacine (estulic), dérivé de la clonidine, d'action longue, qui réduit considérablement les souffrances du sevrage, tout en permettant une participation active aux activités : trois prises quotidiennes, après vérification de la pression artérielle et du pouls, ne nécessitent pas le maintien des patients au lit.
Les premiers jours, ou dans les phases difficiles, du propoxyphène (antalvic) est ajouté à ce traitement, toujours dans l'idée de rendre le manque le plus supportable possible.
Anxiolytiques et hypnotiques sont généralement prescrits, à dose faibles, et de façon dégressive.
En principe, les traitements sont diminués de façon à ce que le sujet puisse passer au moins un jour ou deux sans traitement avant la sortie.
Dans d'autres lieux (service du Dr Jacob, à Jury-Les-Metz, par exemple), les neuroleptiques sédatifs et hypnotiques (tercian, théralène), sont beaucoup plus utilisés, du moins les premiers jours, avec de bons résultats.
En milieu général, la clonidine (catapressan) est encore employée, du fait que le cadre se prête plus au fait que les patients restent alités plus souvent.
Autres modalités
De très nombreuses techniques de sevrage ont été expérimentées, et montrent une efficacité certaine. Cela peut aller de l'emploi de l'électrothérapie transcutanée par courant de Limoge (Dr. Daulouède, Bordeaux), à l'acupuncture, etc...
- Sevrage dégressif
Il devrait être une modalité de plus en plus employée en ambulatoire, dans les centres d'accueil comme en médecine de ville.
Il peut aussi devenir une modalité de sevrage hospitalier. (P. Lauzon, à Montréal, utilise avec succès la méthadone en cures courtes, dégressives, pour sevrage en milieu hospitalier.).
- Emploi d'antagonistes opiacés
Naloxone (antagoniste d'action rapide et brève) et naltrexone (antagoniste d'action longue) sont employées dans certains programmes de sevrage. On peut douter de l'intérêt de substances qui précipitent, ou aggravent la symptomatologie du manque. Il serait envisageable toutefois d'y recourir, à la demande des patients, pour raccourcir les cures, dans certains sevrages dont la durée devient source d'épuisement (sevrages de méthadone).
- "Sevrage minute"
L'emploi des antagonistes a été récemment proposé pour faire des "sevrages minutes", en quelques heures, sous anesthésie, avec emploi de clonidine, couplée à naloxone, puis naltrexone. Cette technique est plus que discutée.
Conclusion
- Proposition
Plus qu'une proposition, il s'agit d'accepter une demande de sevrage d'un sujet qui, pour des raisons diverses, désire arrêter d'être dépendant.
Plus que vérifier la motivation de ce sujet, il s'agit de vérifier sa liberté de faire un choix, et de ne pas appliquer le désir de l'entourage, du juge, de la police, etc...
Nombre de demandes de sevrage correspondent à des situations de crise, dans lesquelles le sujet ne supporte plus son mode de vie quotidien : comme le disent les membres Alcooliques anonymes ou Narcotiques anonymes, il "touche le fond".
Il faut donc pouvoir répondre, et rapidement. Mais il faut aussi bien expliquer, tant les modalités du sevrage, que ses limites.
Il faut aussi être sûr que l'après-sevrage se passera dans des conditions suffisamment bonnes, (même si le but est de reprendre des opiacés ), pour que la rupture d'équilibre entraînée par le sevrage, ne conduise pas à une situation pire qu'au départ : dans certains cas, la poursuite de la toxicomanie, ou un traitement de substitution, constituent des réponses mieux adaptées.
- Négociation
Le "contrat" doit lier les deux parties, et être réellement accepté. Mais il ne doit pas servir, par une rigidité excessive, de mode de sélection des patients les plus dociles. Le thérapeute doit simplement s'engager à rendre le sevrage le moins pénible possible, dans le cadre de traitements préalablement expliqués. De l'autre côté, usage de drogue, trafic, violence, peuvent être des motifs d'interruption de la cure de sevrage.
A tout moment, au cours du sevrage, le sujet doit pouvoir interrompre celui-ci, sur simple demande (Ceci exclut tant le recours à des hospitalisations sous contrainte, que des procédés qui viseraient à rendre un départ très difficile).
- Adaptation des conditions pratiques
Pour qu'une approche contractuelle soit possible, il faut que le patient ne soit pas dans un état d'aliénation totale. Un contrat de sevrage peut être passé avec tous les types de patients, y compris psychotiques, mais le problème de la comorbidité psychiatrique peut poser la question de lieux différentiels pour le sevrage (ou l'initialisation de traitements de substitution), et le traitement d'épisodes psychiatriques aigus (Et dans les cas où des troubles psychiatriques majeurs justifieraient une hospitalisation à la demande d'un tiers, sevrage ou prescription d'opiacés seront à intégrer au traitement psychiatrique, au mieux des intérêts du patient).
Il faut pouvoir éviter que les pressions - souvent légitimes ou du moins compréhensibles - de l'entourage familial ou social, ne deviennent une contrainte absolue, en ménageant un espace thérapeutique propre au patient (les lieux susceptibles d'organiser des sevrages pour mineurs sont par exemple actuellement très rares).
Annexe : bibliographie (toxibase)
- Sur la clonidine, et ses dérivés (guanfacine, lofexidine) :
documents N° 1, 29, 47, 61, 73, 78, 103, 109, 114, 127, 140, 187, 194, 197, 213, 215.
- Sur l'emploi d'antagonistes morphiniques, ou les "cures-minute" :
27, 28, 76, 118, 131, 168, 184, 202, 216.
- Sur l'emploi de la méthadone pour sevrage :
96.
- Sur la buprénorphine :
172.
- Sur la médecine de ville :
34, 35.
- Sur l'électrothérapie :
6, 9, 142.
- Sur les échelles d'évaluation du sevrage :
65, 110, 111, 138.