

|
le Livre Blanc
|
|---|
D. Widlocher et D. Kipman
Il a fallu que le groupe de travail détermine dès le début un angle d’attaque clair. Aussi à l’habituelle dénomination des « sciences humaines » – dites encore plus banalement sciences « molles » – avons-nous délibérément préféré « sciences de l’esprit ».
Sciences humaines et sciences de l’esprit ont souvent été considérées en France, comme équivalentes (traduites parfois l’une pour l’autre) . Mais elles recouvrent en fait des champs et des approches différents. Par exemple, tantôt « histoire » est incluse dans les sciences humaines, tantôt elle en est exclue.
Par ailleurs, dans l’usage courant et même si on se réfère aux facultés, les sciences humaines sont essentiellement contstituées de la psychologie et de la sociologie ; mais parallèlement, une distinction existe entre sciences humaines et sciences sociales [Levi-Strauss ] qui concernent certaines branches de la psychologie (sociale) et évidemment la sociologie.
L’objet de ce chapitre n’est pas de livrer les glissements qui se sont révélés au fil de l’histoire concernant ce concept, mais d’essayer d’exposer les éléments issues des sciences de l’esprit qui, pour les psychiatres et pour la psychiatrie, ont été source d’avancées et permettent des orientations pluridisciplinaires.
Considérer l’esprit comme un objet scientifique présente en ce moment un intérêt supplémentaire : c’est de permettre de penser et de mieux cerner les rencontres, les limites et les incompatibilités entre l’approche des sciences de l’esprit et celle des neurosciences, appliquée à un objet proche.
Ajoutons que rassembler, ainsi que nous le faisons, les sciences de l’esprit nous évite d’avoir à commenter les difficultés dans lesquelles se débat la psychologie, éclatée en de nombreuses branches qui ont chacune besoin d’un adjectif pour s’autonomiser : de la psychologie expérimentale à la neuropsychologie, de la psychologique dynamique à la psychologie cognitive ou à la psychologie développementale. Il n’empêche que la psychologie au singulier, reste un terme implicateur d’usage courant.
A première vue, que la psychiatrie soit essentiellement liée aux sciences dites « de l’homme » est une évidence. Ce qui reste étonnant, c’est qu’il faille périodiquement le rappeler sous la pression de ceux qui, à des titres divers, prêchent pour une psychiatrie mécaniciste, organiciste, réifiée. Ces sciences ont évolué, elles traversent des difficultés structurelles qui permettent de se rendre compte que ces liens sont complexes et parfois fragiles. Aujourd’hui encore, la place des sciences de l’esprit dans la formation, la recherche, la pratique en psychiatrie est sous estimée. Quelle que soit l’importance que l’on donne aux sciences de la nature, aux neurosciences et à leur articulation avec les sciences de l’esprit, il n’empêche que les données scientifiques de ces dernières et le lien - voire la dépendance - de la psychiatrie à leur égard est fondamental et fondateur. L’évolution de la psychiatrie, l’émergence du concept de santé mentale sont en interconnexion avec l’évolution des sciences de l’esprit et avec les conditions socio-économico-politiques du moment. Mais elles ont aussi leur dynamique propre.
La psychiatrie est une discipline médicale qui partage avec toutes les autres cette caractéristique commune : les médecins appliquent à un champ particulier des connaissances scientifiques venues et empruntées à diverses sciences. Le lien avec les sciences de l’esprit est parfois associé à la philosophie : ce serait en revenir à une définition antique de celle-ci, ou le philosophe était le savant absolu. On entend aussi que les sciences de l’esprit seraient inappropriées ou dépassées : les sciences de la nature s’appliquent évidemment au fonctionnement humain et c’est même une tendance forte au sein de la psychiatrie contemporaine. Les sciences de l’homme deviendraient alors les sciences de l’âme, les psychologies sous diverses approches.
On ne peut désormais ignorer que les connaissances venues des sciences de l’esprit sont authentiquement scientifiques, ce qui contribue à différencier les psychiatres des guérisseurs qui n’appliquent que des recettes et des méthodes.
On a pris l’habitude de séparer les sciences dures et les sciences molles, sciences de la nature et sciences de l’homme ; or cette distinction apparaît désormais clairement inappropriée. Elles s’attachent les unes et les autres à des objets parfois invisibles, ou à des fonctions qu’elles ne peuvent décrire, atteindre, comprendre que par le biais de l’interprétation de données objectives ou objectivables, et de modélisation abstraite. Il faut ajouter que cette étape intermédiaire implique directement l’observateur comme élément de l’observation, par exemple.
En un mot, l’objet d’attention et d’action des psychiatres est le fonctionnement et les dysfonctionnements du psychisme. Ce fonctionnement peut être abordé de plusieurs manières :
- Soit à travers la description des comportements individuels et collectifs ; la compréhension des attitudes et des contre-attitudes face à des situations données.
Le récit et le langage restent les média privilégiés et essentiels pour aborder ces comportements, attitudes, histoires personnelles et collectives.
Le langage, les média d’échanges individuels, interindividuels et collectifs sont ainsi des sciences au cœur de la penséeet de l’esprit, comme objet à la fois réel et immatériel. Un autre abord, très prometteur est celui de l’éthologie.
- Soit encore par l’appréhension des processus physiologiques, des modifications anatomiques, génétiques, électriques, électroniques, biochimiques : c’est alors l’appel aux sciences de la nature.
Toutes les sciences de l’esprit auxquelles il sera fait référence ici ont en commun : une théorie et ses postulats. Le statut scientifique de certaines d’entre elles peut être discuté, car les références affirmées comme théoriques sont en réalité idéologiques et les postulats des dogmes. C’est le questionnement auquel on doit soumettre également les “ sciences ” économiques et les économistes, voire l’histoire et les historiens ; tout comme on est en droit d’interroger le statut scientifique de corpus ayant besoin d’un adjectif pour exister : techno-sciences, par exemple.
- Soit enfin par l’utilisation à l’intérieur de la théorie, de modèles qui ne rendent compte que d’une partie des faits étudiés. Compte tenu de la particularité de leur champ, et de sa parcellisation (clinique, catégorielle), les psychiatres, les soignants, sont souvent plus friands de modèles (qu’ils prennent pour des théories alors qu’ils n’en sont que des morceaux amovibles) que de théories.
Ces préliminaires épistémologiques posés, il est possible de dresser une liste limitée, non exhaustive, des principales sciences en question et des mouvements qui se dessinent en leur sein. Seront donc examinées rapidement (car c’est la loi du genre) :
Les sciences de l’esprit individuel
. psychanalyse bien sûr, avec le recentrage de ses multiples modèles ;
. les sciences cognitives et comportementales, qui souffrent paradoxalement d’un phénomène de mode.
Les sciences de l’esprit collectif
Elles seront séparerées artificiellement, en fonction des pratiques psychiatriques, en sciences de l’esprit collectif et en études des groupes restreints (famille, entourage, institution) et des groupes larges (culture, société, langage).
- Pour les groupes restreints, nous retiendrons : la théorie générale des systèmes et le traitement des familles ainsi que les apports des sciences de l’esprit aux dynamiques institutionnelles.
- Et pour les groupes larges :la linguistique, la sociologie et l’ethnologie.
- Enfin, une place particulière, parce qu’ambiguë, sera réservée aux sciences historiques (histoire, archéologie, paléontologie).
Cependant, la catégorisation individuelle ou collective n’est pas pertinente dans l’usage psychiatrique qui peut en être fait.
La pratique psychiatrique se situe, on l’a (presque trop) répété, à un carrefour entre le biologique, l’individuel (diagnostic et traitement) et le collectif (famille, groupe, société, culture) dans l’espace et le temps « l’homme est un tout et une histoire »). Aussi, après en avoir fait état, nous n’utiliserons plus cette classification.
Il est bien évident que tout classement est artificiel et qu’il convient de noter évidemment que la psychanalyse, les sciences comportementales et cognitives et la systémique ont développé des formes d’intervention pour les personnes, les familles, les organisations sociales. Elles éclairent et sont éclairées par l’éthologie, la linguistique, l’ethnologie et l’histoire. C’est ce que nous tentons de présenter dans la suite de ce chapitre.
La psychanalyse n’est pas seulement une pratique qui joue un rôle majeur dans le champ de la psychiatrie. Elle constitue une science autonome de l’esprit humain.
Cette position la place à la fois dans le cadre des sciences naturalistes (comme la psy-chologie dans son ensemble) et dans celui des sciences dites humaines, qui rendent compte de la subjectivité des relations interpersonnelles et de la pragmatique de la communication. Cette distinction se fonde sur des questions de méthode et d’épistémologie. La question préalable est de définir les champs d’application de la connaissance psychanalytique.
La psychanalyse occupe une position scientifique à un tri-ple titre. Elle est en soi un outil de connaissance de l’esprit humain ; grâce à cet outil, elle s’applique à différents domaines d’investigation ; enfin, elle constitue un double objet de connaissance comme pratique et comme savoir.
Depuis son origine, contemporaine de l’émergence d’autres sciences comme la physique quantique, les mathématiques non-euclidiennes, etc., elle constitue une méthode d’investigation et de traitement (association libre – entendement des processus inconscients – transfert – etc.). Cette méthodologie est bien connue et elle a porté ses fruits depuis l’origine dans le champ de ses applications dans la pratique psychiatrique et en dehors du cadre thérapeutique (groupes thérapeutiques ou naturels, institutions, etc.). La question posée actuellement par les psychanalystes est celle de savoir si cette méthode a évolué avec le temps et peut continuer d’évoluer, ou si, fixée une fois pour toutes par “ l’invention freudienne ”, les développements ultérieurs n’ont guère modifié la structure de l’outil. On en connaît déjà et pressent l’évolution logique : sur un socle théorique inamovible – les fondements de la science – les modèles, les pratiques, les applications sont en plein mouvement, d’autant que des champs d’investigation se dévoilent et se précisent, parfois grâce aux apports des sciences de la nature.
L’expansion du domaine de connaissance a été déjà très marquée au cours de ces cinquante dernières années et devrait continuer à l’être dans les prochaines décennies. Dans le champ de la psychiatrie en général, les applications de la psychana-lyse à d’autres modèles psychopathologiques que celui de la névrose ont indiscutablement apporté des connaissances nouvelles, indépendamment de leurs effets thérapeutiques. L’exemple de la psychose montre bien que la pratique de thérapeutiques médicamenteuses qui en a bouleversé le traitement n’a pas stérilisé la recherche psychanalytique, pas plus d’ailleurs que l’étude cognitive des mécanismes de pensée psychotiques.
La psychanalyse dite appliquée connaît actuellement des remaniements épistémologiques et méthodologiques dont on peut attendre des retombées très intéressantes sur des phénomènes comme la victimologie, la violence, le vieillissement, etc.
Une certaine réponse de la psychiatrie aux problèmes de société actuels ne peut être envisagée sans l’apport de la psychanalyse. De nombreuses rencontres internationales à propos de la violence, des traumatismes, des abus sexuels, du risque, de l’identité (individuelle, communautaire, nationale, supranationale, etc.) mobilisent des responsables politiques et des professionnels qui prennent en compte la clinique psychanalytique.
La méthode psychanalytique, en retour, peut être, elle-même, étudiée par des procédures objectives. Cette proposition ne recueille pas l’assentiment unanime des psychanalystes considérant que la dimension intersubjective qui guide la pratique clinique est d’une nature qui la rend totalement non pertinente pour des approches objectives. Il existe aujourd’hui suffisamment de travaux pour considérer que cette position négative de principe mérite très largement d’être débattue.
Comment aborder des processus comme les mécanismes de défense, les affects, les processus primaires de pensée, etc. ? Le principe de l’interdisciplinarité ne devrait pas être récusé en soi. Les recherches sur le langage, sur l’expression faciale, sur les effets psychophysiologiques, sont pratiquées depuis longtemps avec des résultats varia-bles mais sans que le principe de l’interdisciplinarité ait été contesté. Les développements de l’imagerie cérébrale et de la neuropsychologie cognitive devraient permettre d’ouvrir de nouveaux champs de recherche. Il en est de même pour l’éthologie comparative et les sciences du développement. L’interdisciplinarité évoquée ici, bien entendu, pourrait s’évoquer ou s’invoquer dans d’autres disciplines.
Il faut bien noter qu’en bonne démarche scientifique, il ne s’agit pas de trouver un consensus « mou », ou un point de vue global, « holistique » de Sirius (bio-psychosocial). Il respecte la fonction d’étayage – ou de réputation – des apports des autres disciplines sur le modèle élaboré à partir de ses propres hypothèses théoriques.
Il s’agit de la nécessité d’une confrontation constante entre disciplines scientifiques, entre scientifiques, et, d’avantage encore – par une sorte de nécessité interne aux modalités des pratiques – entre scientifiques et « applicateurs », praticiens, cliniciens.
Cela renvoie :
- à la place de la personne, ou de la personnalité dans toutes ces démarches ;
- au nécessaire respect des sciences entre elles.
La mise en route de recherches empiriques, au sens large, devrait permettre de faire progresser le débat méthodologique et de sortir d’un débat idéologique qui constitue souvent un obstacle au développement des études sur le terrain. Dans ce contexte, il est impossible d’exclure la psychanalyse d’une rationalité scientifique qui, sans elle, deviendrait moins rationnelle que passionnelle.
L’émergence relativement récente des modèles cognitifs est venue modifier l’approche des opérations de pensée et ouvrir une nouvelle perspective de recherche des troubles mentaux.
La psychologie cognitive prend pour objet les processus de pensée, la “ boite noire ” laissée de côté par les béhavioristes, c'est-à-dire la manière dont l’information est saisie, traitée, stockée et récupérée ou utilisée pour élaborer une réponse. Elle traite donc du sujet aux prises avec son environnement dans son interaction avec le milieu.
Cette perspective cognitive, dite du traitement de l’information, s’est développée conjointement avec une autre approche dite aussi cognitive et qui se donne pour objet l’étude des contenus de pensée. Beck en a fourni un modèle théorique et une méthodologie clinique. Cette approche conduit à des ouvertures thérapeutiques, cognitivo-comportementales.
La perspective du traitement de l’information se centre sur les opérations de traitement dont les contenus sont les produits, et non sur les contenus de pensée. Cette perspective et le paradigme théorique qui la sous-tend sont le résultat de la rencontre d’un intérêt nouveau, en psychologie, pour les états mentaux et les opérations mentales négligés par les béhavioristes, et du modèle de fonctionnement des ordinateurs constituant un modèle possiblement analogique du fonctionnement de l’esprit. Cette perspective a été initiée par Piaget et Chomsky. Le modèle théorique originel est donc celui du traitement de l’information, traitement supposé, à l’image des ordinateurs, sériel, découpé en étapes de traitement. Les méthodes utilisées pour décrire ces opérations sont de deux ordres : la simulation (ce sont les systèmes experts) et les tâches expérimentales.
Les sous-disciplines de la psychologie peuvent tirer bénéfice de l’observation pathologique en même temps qu’elles les éclairent. Cette pluralité explique pourquoi nous ne pouvons définir le concept de psychopathologie cognitive de manière unitaire à partir de ses limites. Il s’agirait donc plutôt d’un ensemble de connaissances scientifiques que d’une science unitaire encore constituée. Les limites et les modèles cognitivistes, en matière de psychopathologie varient selon les sous-disciplines envisagées. Que l’on s’intéresse par exemple au champ des interactions sociales ou à la psychophysiologie, l’important est d’identifier le “ noyau dur ” de la psychopathologie cognitive : non pas les fonctions intellectuelles, comme les cliniciens le croient trop souvent, mais les opérations élémentaires non conscientes, qui contribuent à l’élaboration des états mentaux complexes. C’est bien en ce sens que l’on peut concevoir une approche cognitive des états émotionnels et des motivations.
Autre critère pour définir ce noyau dur : la méthode expérimentale. Ce qui fait la particularité de celle-ci, c’est la référence à deux variables indépendantes, la “ maladie ” croisée avec l’exécution d’une tâche. Bien entendu, le terme de maladie désigne ici une construction hypothétique qui est précisément attestée par ce que l’on attend chez un malade donné d’un dysfonctionnement cognitif qu’il s’agit précisément de retrouver. Quant à la variable dépendante, c’est évidemment le résultat mesuré de l’exécution de la tâche, que celui-ci soit évalué en terme de performance ou, comme nous le savons, plus souvent en terme de durée.
A partir de ce noyau dur, les applications vont pouvoir être multiples. Mais surtout, de là vont pouvoir naître des constructions théoriques, des modélisations qui constitueront les constructions hypothétiques pour de nouvelles investigations expérimentales, et aussi des modèles de lecture de la clinique. C’est à partir de là que pourront être abordées les correspondances avec l’activité cérébrale proprement dite, en particulier par les techniques d’imagerie, et par ailleurs l’approche pharmacologique.
Ainsi, le chemin est encore long, et heureusement prometteur, pour que nous continuions d’avancer dans cette psychopathologie nouvelle, qui ne cherche nullement à réduire les autres démarches mais, au contraire, à les éclairer et à en tirer également profit. Nous avons à nous interroger sur trois types de rapports : les rapports des activités mentales élémentaires avec l’affect, le cerveau et l’action. C’est peut-être dans une perspective plus étho-écologique que l’on devra, dans les prochaines années, situer le champ de ces recherches.
La psychiatrie combine des démarches pluridisciplinaires, transdisciplinaires et interdisciplinaires. Ses domaines d’exploration et d’action concernent de multiples niveaux d’organisation, impliquant les échelons moléculaires, macro-moléculaires, hormonaux, neuronaux, comportementaux, langagiers, communicationnels, cognitifs, environnementaux, etc. Elle se décline également en de multiples sous-disciplines : psychiatrie biologique, psycho-dynamique, familiale, sociale ou communautaire, institutionnelle. Elle est par excellence une discipline concernée par l’hypercomplexité des systèmes humains. Elle est constituée par un corpus de connaissances qui évoluent rapidement, et de savoir-faire qui ne sont pas en reste. À ce titre, les descriptions approximatives qui précèdent sont particulièrement interpellées par la science des systèmes, et plus précisément par la science des systèmes complexes.
Cette appartenance médicale et psycho-sociologique apparaît dans le titre même de l’ouvrage princeps de Philippe Pinel, le “ Traité Médico-Philosophique ”, puis dans l’intitulé de la plus ancienne société savante française de psychiatrie, la Société Médico-Psychologique.
La théorie des tendances psychologiques de Pierre Janet, relevant de champs de forces en tension, la théorie des instances psychiques de Sigmund Freud, la théorie organo-dynamique des niveaux de conscience de Henri Ey, proposeront des élaborations reposant sur des principes systémiques.
La science des systèmes ouvre à des enjeux épistémologiques de première importance devant la complexité de la psychiatrie contemporaine. Elle ne saurait être une sous-discipline de la psychiatrie, puisqu’elle questionne la grande majorité des sciences, dans leurs aspects disciplinaires et interdisciplinaires. On peut donc chercher à comprendre le fonctionnement de la psychiatrie, des réseaux de professionnels de la santé mentale et du champ social, des institutions par le biais d’approches systémiques peut être plus facilement que par d’autres biais.
Réciproquement, la diversité des pratiques cliniques et des théories psychiatriques participe à l’évolution de la science des systèmes. Pour Ludwig van Bertalanffy, la personnalité peut être appréhendée comme un système biologique actif, présentant des propriétés de spontanéité, d’homéostasie, de croissance, de différenciation, d’inscription symbolique au sein des systèmes sociaux. Dans cette perspective, la maladie mentale est une perturbation des fonctions systémiques de l’organisme psycho-physique. Gregory Bateson élargira cette conception en tenant compte de l’environnement de l’organisme, des communications et des interactions que cet organisme développe avec son écosystème (relations interpersonnelles, familiales et sociales, contexte technique et épistémique, etc.).
L’étude des systèmes relèverait des sciences conjecturales. Elle repose sur un va et vient entre théorisation, méthodologie, modélisation, action, qui interfèrent avec les domaines disciplinaires et inter-disciplinaires spécialisés.
Quoi qu’il en soit, on peut suggérer, dans une perspective systémique, que les méthodologies analytique et holistique se complètent, voire se renforcent, plus qu’elles ne s’excluent mutuellement.
La méthodologie analytique cherche à décomposer un système pour étudier les constituants sous-jacents. La description, toujours plus précise, des faits relèverait de la constatation des effets de cette décomposition. Une telle décomposition en vient à détruire l’objet étudié, mais permet d’appréhender ses constituants sous-jacents, voire ultimes.
La méthodologie holistique cherche à l’inverse à appréhender un système comme un tout dans ses contextes d’existence et d’ évolution. Il s’agit moins d’unifier, et de réduire à un modèle unique, que de considérer que « le tout est davantage » ou autre chose « que l’ensemble des parties ».
Le système, aux contours éventuellement flous et variables, est moins enfermé dans ses limites et frontières que caractérisé par ses zones de contact. La description des comportements d’un système serait liée aux interactions que ce système entretient avec son environnement. Plus un système est complexe, plus son fonctionnement interne échappe à la compréhension de l’observateur extérieur (effet de boite noire et de machine non triviale). Ces deux méthodologies sont ainsi à la fois complémentaires et antagonistes. Des approches incompatibles par leur théorie ou leurs méthodes peuvent cependant fournir des éléments utilisables dans d’autres approches. La première conduit à une sorte d’entomologie qui risque d’aboutir à une vision statique de niveaux d’organisation, emboîtés entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. À ses échelles extrêmes, mais aussi à l’échelle “ humaine ” d’observation, surgissent toute une série de paradoxes (interférences entre systèmes observants-observés, relativisme des descriptions en fonction du système de référence choisi). La seconde apparaît davantage dynamique, elle s’intéresse à des processus globaux, évolutifs et transformatifs. Mais elle risque d’aboutir à des représentations approximatives, dépendantes de la subjectivité et des finalités de l’observateur et/ou de l’acteur. Il ne faut cependant pas oublier que l’approximation, l’aléatoire et le probabiliste font partie intégrante des modes de réflexion et des concepts scientifiques.
Dans les faits, si ces deux approches ne peuvent être utilisées en même temps, elles méritent d’être soigneusement articulées en fonction des exigences de la clinique.
La souffrance humaine s’inscrit dans le corps et le cerveau, s’exprime dans les activités comportementales et mentales, infléchit les interactions, affecte l’écosystème global du patient et des personnes avec lesquelles il maintient des liens de dépendance vitale, voire de survie. Récursivement, les défaillances du système, à différents niveaux de son organisation, produisent ou entretiennent la souffrance.
Les cliniciens ont repéré les paradoxes et les « double binds » qui caractérisent les systèmes familiaux en prise avec les formes graves de pathologie mentale, marquant les défaillances des processus d’autonomisation. Le repérage des formes de schismogenèse (complémentaire, symétrique et réciproque) caractérisant les interactions interpersonnelles et collectives a été d’une aide précieuse pour appréhender les interférences complexes qui surgissent entre les patients, leurs familles et les équipes de soins.
La démarche éco-systémique conduit à des modalités d’intervention à la fois diversifiées et spécifiques : prescriptions (du symptôme, du statu quo, de tâches, du “ semblant ”), ritualisation des échanges permettant de canaliser les déchaînements émotionnels et de symboliser les situations de violence), exploration et transformation des contextes dans une finalité thérapeutique. Ces modalités d’intervention aboutissent à la création des cadres d’intervention thérapeutique et à l’organisation des soins :
- D’une part, ces modalités d’intervention donnent lieu à la mise en œuvre de protocoles de psychothérapies individuelles, de thérapies familiales, multi-familiales, de thérapies de réseau. Cette mise en œuvre repose sur des concertations entre patients, familles et équipes soignantes, aidant à la conception des interventions thérapeutiques, à la délibération entre partenaires et à la prise de décision.
- D’autre part, l’organisation des soins permet de concevoir des polarités ouvertes et coordonnées d’actions thérapeutiques différenciées : interventions d’urgence, interventions à court, moyen et long terme, permettant la prescription des chimiothérapies, des psychothérapies individuelles et collectives, des thérapies institutionnelles. Le patient et ses proches apprennent alors à se repérer face à ces contextes multiples, à les utiliser en fonction des difficultés qu’ils rencontrent concrètement, à augmenter leurs degrés de liberté et à promouvoir progressivement des processus d’autonomisation.
On voit, a propos des sciences systémiques, comment peut s’établir le va et vient permanent entre scientifiques, chercheurs, enseignants et praticien ; et comment ce va et vient peut intégrer les questions et apports des patients et de leur entourage.
L’éthologie peut être définie comme la biologie comparative des comportements animaux et humains dans leurs contextes naturels d’apparition et d’expression. Elle s’inscrit dans le cadre de la théorie de l’évolution des espèces et considère que les formes que prennent les comportements, au même titre que les formes anatomiques, organiques et physiologiques, non seulement varient selon les espèces, mais encore ont fait l’objet de multiples transformations et différenciations depuis l’apparition du règne animal.
L’éthologie “ objectiviste ”, qui tient compte ainsi de la “ niche écologique ” des espèces pour les observer et pour comprendre leurs conduites, a été une alternative pertinente face au béhaviorisme. Ce dernier postulait en effet que les organismes vivants supérieurs disposaient essentiellement de mécanismes d’apprentissage sur le mode de circuits stimulus-réponse, susceptibles d’adapter les conduites à n’importe quelle situation vécue ou observation de laboratoire. Pour l’éthologie objectiviste, il existe un ajustement évolutif et dynamique entre les comportements d’une espèce et son adaptation à un écosystème donné, et la capacité plus ou moins développée de créer cet écosystème, de le modifier, voire de le généraliser.
Un tel point de vue permet de considérer que l’esprit humain est le produit de l’évolution des espèces (phylogenèse), du développement individuel (ontogenèse) et de l’histoire culturelle (culturogenèse). Ces trois processus sont en interaction permanente.
Des échanges fructueux se sont ainsi développés entre l’éthologie humaine et la psychiatrie générale, la métapsychologie psychanalytique, les sciences des systèmes, de la communication et de la cognition. L’éthologie a largement contribué au développement de la psychiatrie évolutionniste (Albert Demaret 1979, David M. Buss, 1997, Michael McGuire & Alfonso Troisi, 1998, Anthony Steven & John Price, 1966-2000).
Sur le plan psychopathologique, de nombreux troubles ont pu être éclairés par des études comparatives entre espèces : hystérie (comportements simulés, phénomènes hypnoïdes, catalepsie), phobie (réactions de fuite liées à des situations de danger ou à des situations traumatiques), troubles obsessionnels compulsifs (activités de déplacement liées à des conflits de comportements), énurésie, encoprésie (troubles du marquage du territoire), anorexie mentale (réactions de survie alimentaire en situation de famine), schizophrénies, paranoïa (réactions de survie en situation d’hostilité, catatonie), dépressions (réactions à la perte du partenaire sexuel ou parental), toxicomanies (perturbations des comportements de dépendance), exhibitionnisme (affichage du phallus érigé), déviations sexuelles (troubles de l’empreinte sexuelle).
Par exemple, l’observation des espèces sauvages a permis de remarquer des signes typiques de réactions dépressives chez les animaux confrontés à la perte d’un congénère affectivement investi : disparition de la mère pour un petit, disparition du compagnon sexuel chez un adulte. C’est ainsi que sur le plan du développement psychoaffectif, l’étude du comportement d’attachement, de son développement et de sa différenciation a permis d’en préciser les caractéristiques et la complexité. Celui-ci est médiatisé par des systèmes de signalisation (cris, babillages, sourires, mouvements d’aggripement, etc.) à partir de processus d’empreinte aux personnes familières, en particulier la mère. L’empreinte permet l’acquisition des indices olfactifs, visuels, tactiles, auditifs, qui caractérisent les personnes familières et permet la distinction entre celles-ci et les étrangers. Une fois réalisée, cette acquisition n’est pas modifiable par des apprentissages conditionnés (atténuation de l’attachement en cas de comportements agressifs de la mère, par exemple). Le comportement d’attachement présente un caractère instinctif dans son déclenchement, même si l’objet sur lequel il se porte est acquis. Il a pour fonction de protéger des dangers extérieurs et de développer le sentiment de sécurité, de confiance en soi, de bonheur au contact d’autrui.
L’étude comparative des comportements animaux et humains montre non seulement des parentés phylogénétiques importantes, mais aussi des sauts qualitatifs qui aboutissent au constat que le genre humain échappe en grande partie aux catégorisations opérantes dans le règne animal. L’émergence du langage doublement articulé, l’élaboration de rapports sociaux, d’organisations sociales de plus en plus complexes, la réalisation de contextes artificiels qui modifient, voire menacent, l’écologie de la planète terre, le déploiement des phénomènes mythiques, religieux, idéologiques, épistémiques, font de l’animal humain un être à part, qui ne peut être réduit à ses origines animales.
S’il existe des analogies fonctionnelles sur le plan des comportements alimentaires, des comportements sexuels et reproductifs, des comportements filiaux et parentaux, des hiérarchies sociales, etc., il existe également des homologies évolutives qui limitent, voire rendent obsolètes, des analogies fonctionnelles :
L’utilisation de la parole dans la conversation où la palabre remplace l’épouillage social, mais l’activité langagière va bien au-delà : elle devient un instrument qui démultiplie les capacités cognitives, donne accès au monde symbolique, transfigure les rapports que l’homme entretient avec la réalité.
De même, le processus d’auto-domestication a généré chez l’homme une grande variabilité dans l’expression phénotypique des morphologies anatomiques et comportementales : chez l’homme, l’intensité et l’importance des comportements instinctifs, de même que la taille, le poids, la corpulence, varient beaucoup d’une personne à une autre. L’homme “ civilisé ” a perdu, ou canalisé, ses origines sauvages. Pour autant, le repérage de ces vestiges sauvages n’est pas sans intérêt dans le cas des pathologies mentales et comportementales graves. Celles-ci ont ainsi pu être interprétées comme des réactions de survie ayant eu une valeur adaptative dans les contextes préhistoriques d’hominisation, contextes actuellement disparus ou réprimés par l’évolution culturuelle.
Si l’objet de la linguistique pour Saussure était « la langue », un objet facile à découper en éléments formant une structure, son objet est devenu aujourd’hui « le langage » (sciences du langage) et se décline en différentes approches théoriques. La linguistique se trouve ainsi concernée par l’ensemble des processus de pensée telle qu’elle s’exprime à travers son produit privilégié : le langage.
Dans les lignes qui vont suivre, il s’agit d’évaluer les questions que se sont posées de tout temps les psychiatres à propos du langage de leur patient, et comment ces questions peuvent être replacées dans un espace de réponses possibles en s’appuyant sur les outils théoriques issus des sciences du langage. La psychiatrie a emprunté de façon empirique aux linguistes ou aux philosophes du langage certains de leurs outils pour tenter de rendre compte du fonctionnement psychique d’un patient à partir de sa mise en mots. Mais deux questions fondamentales ont été sinon éludées, du moins quelque peu oubliées, alors qu’elles se sont posées et se reposent en permanence : celle de l’utilité et de la fonction du langage dans un processus thérapeutique et celle de la possibilité de dégager non seulement les indicateurs d’une évolution, mais des stratégies discursives qui rendent possible cette évolution.
L’utilisation du langage en psychiatrie semble aller de soi dans le double registre du diagnostic et de la thérapeutique. Au delà de ce qui peut apparaître comme une évidence, se pose la question des modèles de référence sur lesquels s’appuie cette pratique et la façon dont les sciences du langage ont été instrumentées ou pourraient être utilisées dans l’avenir à partir des nouvelles données et outils dont elle dispose. A ce niveau, se pose la question de la collaboration des psychiatres avec les linguistes et celle d’une véritable formation aux sciences du langage.
Les propos du patient sont-ils pertinents pour le diagnostic ? (et pour quel type de diagnostic ?) Pour évaluer l’évolution de sa maladie ? Pour le traiter ?
Ces questions naïves semblent un préalable et pourtant nous allons voir que les réponses ne sont pas aussi simples qu’on pourrait s’y attendre.
C’est aux comportements que se sont principalement intéressés les psychiatres de Pinel à De Clérambault. Le langage mis en avant est celui du psychiatre grand stratège, tel Pinel qui doit calmer, se faire craindre ou ruser pour obtenir un comportement moins violent de la part des patients ou pénétrer le secret de leurs pensées :
« Le talent de prendre avec eux le ton de la bienveillance ou un air imposant, et de les subjuguer par la force lorsque les voies de la douceur ne peuvent suffire »
« Il y aurait de la maladresse à leur marquer une intention directe de les observer et de pénétrer le secret de leurs pensées par diverses questions sur leur état : la crainte de se trahir leur inspire une sorte de réserve et de contrainte qui les fait paraître tout autres qu’ils ne sont... » .
Pour de Clérambault, il s’agit de déceler les éléments diagnostiques qu’il recherche pour mettre à jour le syndrome d’automatisme mental, ce qui le conduit également à situer le langage dans la référence de la ruse et de la tactique "Par un dialogue en apparence diffus mais semé de centres d'attraction pour les idées, nous devons amener le sujet à un état d'esprit dans lequel il sera prêt à monologuer et discuter, à partir de quoi notre tactique sera de nous taire, ou de contredire juste assez pour paraître ne pas tout comprendre, mais être capable de tout comprendre ; alors le sujet se permettra des expansions imprévues de lui et laissera tomber des formules dont il croit que nous ne prévoyons pas les conséquences. De tels malades ne doivent pas être questionnés mais manoeuvrés et pour les manoeuvrer, il n'y a qu'un seul moyen, les émouvoir ".
Pour Freud, les propos du patient sont d’autant plus pertinents qu’ils constituent les outils même de sa théorie. La stratégie langagière est conçue dans le cadre de l’action thérapeutique à partir de l’expression synthétique partagée avec le patient de la cause de ses troubles (l’interprétation). “Évitons de lui faire immédiatement part de ce que nous avons deviné parfois très vite, ou de lui communiquer ce que nous croyons avoir deviné. Réfléchissons longuement avant de décider du moment où il conviendra de lui faire connaître nos constructions, attendons l’instant propice qui n’est pas toujours facile à déterminer. En règle générale, nous attendons, pour lui communiquer notre construction, nos explications, que le patient soit lui-même si prêt de les saisir qu’il ne lui reste plus qu’un pas à faire, celui de la synthèse décisive. Si nous procédions autrement, si nous lui jetions à la tête, avant qu’il n’y ait été préparé, nos interprétations, celles-ci resteraient inefficaces ou provoqueraient une violente explosion de résistance qui gênerait ou compromettrait la continuation du travail. ... [ si nous respectons ces principes] “notre savoir est devenu le sien“ .
Le diagnostic est, on le voit dans ces différents cas, conçu autour d’un secret, connu et caché dans un cas, ignoré dans l’autre. Le langage en est dépositaire.
Mais a-t-on répondu pour autant aux questions posées plus haut ? Certainement pas, si l’on néglige la spécificité du dialogue du patient avec le psychiatre.
Le patient vient parler au psychiatre dans un cadre et un contexte tout à fait spécifiques. Le dialogue s’y accomplit dans une sphère d’échange particulière. Ce concept de sphère d’échange est essentiel. Développé par M. Bakhtine , il met l’accent sur un fait banal : l’homme est multidimentionnel. Il est à la fois un enfant (il a des parents), un mari (ou une femme), un père (ou une mère), un travailleur (il est actif dans une tâche, il obéit aux règles, à une (des) personne, il donne des ordres, etc.). Il est un ami, un collègue, un sportif, un patient... Dans toutes ces dimensions (ces sphères d’échange), il utilise le langage et organise (naturellement) son discours en correspondance à la situation. Par exemple, dans l’entretien médical, c’est en principe le médecin qui initie le dialogue et le patient qui répond. Ici il serait stupide de porter un diagnostic de « passif » pour le patient, par exemple, à l’issue d’une analyse de cet échange. De même, la méfiance ou l’alliance sont directement liés à la façon dont est construite cette sphère d’échange.
Dans la subtilité de cet entretien, et cela peut paraître contradictoire, tout le discours du patient est question et il s’inscrit dans le cadre de l’attente d’une réponse qui le concerne en propre. Par exemple, si le patient dit : « j’ai mal à la tête », son psychiatre ou son psychanalyste ne lui répondra pas “moi c’est aux pieds ”, ce qui ouvrirait le discours du patient sur celui du soignant. En fait, le discours du patient reste ouvert sur lui-même, qu’il obtienne ou non une réponse directe. C’est ce qui lui donne la possibilité d’exprimer son vécu et de faire retour sur ce qu’il exprime. C’est une des spécificités fondamentale du dialogue avec un psychiatre.
Une personne souffre et tente d’exprimer sa souffrance à une personne qui écoute (professionnellement) et qui tente de répondre. Le dialogue est spécifique et des expressions du patient telles que « Je n’ai jamais dit ça à personne », « ici je peux tout dire » sont des phrases classiques qui reviennent en entretien ; mais aux autres, on dit autre chose (ou d’une autre façon). On est alors dans une autre sphère d’échange.
Dans cette sphère d’échange, où la stabilité du cadre, le non jugement, la pérénité de la relation, le secret professionnel sont installés, le processus thérapeutique peut se mettre en place avec ses multiples fonctions : expression, appel, structuration de la pensée et des souvenirs et (quelquefois ou toujours ?) sa dynamique développementale où le transfert figure certaines de ses étapes.
Trois grands courants se sont imposés en psychiatrie :
Le structuralisme (notamment avec Saussure et Jakobson). Il se propose de découper le discours en éléments, d’analyser ces éléments et de voir comment ils s’organisent entre eux pour donner un sens.
La pragmatique (avec Austin et Searle) s’intéresse à l’intention portée par l’énoncé concernant un acte à accomplir. Austin a élaboré une théorie des actes “ illocutoires ” à partir de leur valeur (se rapportant à une convention), valeur qu’il dissocie de la signification. Chez Austin, la signification est équivalente au sens et à la référence. Elle correspond à l’acte locutoire. Par exemple, dans l’énoncé : “ à présent, vous allez retourner à votre travail ” je fais un acte locutoire (l’enchainement des unités linguistiques constituant l’énoncé a un sens pour tous) ; correspondant à cet acte locutoire, j’ai à ma disposition toute une série d’actes illocutoires différents : un ordre, une question , etc. L’énoncé va prendre ainsi la valeur d’un ordre ou d’une question, etc. Si l’énoncé produit de l’effet, s’il énerve, s’il soulage, s’il convainc, etc. et que cet effet est prévu par moi, j’aurai accompli également un acte perlocutoire (j’aurai provoqué un effet sur les sentiments, les pensées d’autrui par le fait de dire).
La forme logique de l’acte illocutoire dans son lien avec le contenu propositionnel a été exprimée par les théoriciens (Searle et Vanderveken) à l’aide du symbolisme suivant : F(p) où p est le contenu propositionnel et F la force illocutoire. En psychopathologie, on s’est intéressé principalement à l’acte illocutoire.
L’analyse conversationnelle (initiée aux Etats-Unis dans les années 60), est aujourd’hui utilisée notamment par les psychologues auprès de patients schizophrènes. Elle se base sur l’interaction (situation discursive, partenaires de l’échange verbal, tour de parole, reprise, reformulation, accord, désaccord des différents locuteurs, etc.).
Utiliser l’un ou l’autre de ces courants revient à réduire considérablement le discours d’un individu qui parle à un autre. “ Le discours du schizophrène ”, le “ discours du dépressif ” sont des termes utilisés qui ne reflètent en fait qu’un aspect du discours en le généralisant. C’est l’enchaînement des éléments du discours, (dont ces trois courants ne sont d’ailleurs pas exclus, mais font partie intégrante de ce qu’est le discours d’un individu) qui paraît être un des concepts clés pour rendre compte d’un discours, un autre serait l’hétérogénéité de ces éléments et la distinction général/particulier.
C’est ce que nous allons tenter de démontrer dans le dernier paragraphe.
Il existe différentes façon de relater un fait : par un récit, un commentaire, une description... On utilise ainsi toutes sortes de « genres de discours ». Les genres de discours sont "une façon de dire", de signifier d'une manière particulière. Ils sont importants à repérer pour plusieurs raisons :
- Etant stables, les genres de discours induisent un type de réponse : dès les premiers éléments de l’énoncé d’un locuteur, l’interlocuteur se prépare à lui répondre d’une certaine façon ;
- Articulés au thème, ils renseignent sur la distance qu'entretient le locuteur avec l'objet de son discours ;
- Associés à l'emploi du "je", les genres de discours apparaissent comme une possibilité de se présenter différemment (comme réfléchissant au fait relaté, ou comme le vivant, ou encore interrogeant l’autre, etc.).
Nous voyons qu’à un premier niveau, celui d’une macro-analyse, les genres de discours apportent des informations très importantes et que leur repérage par le psychiatre est simple. Il convient d’être attentif pour repérer les mouvements qui se produisent dans le discours. Le passage d’un genre à un autre (d’un récit à un commentaire par exemple), met en lien des éléments que parfois seule une analyse objective permet de révéler. Un exemple simple va le montrer : on demande à un enfant qui se réveille en sursaut de raconter son cauchemar. Il serait étonnant qu’il le fasse à partir du genre « récit » uniquement « j’étais dans une grande maison, et un méchant est arrivé, il courrait après moi... ». A un moment donné, ce qui a provoqué la peur et le réveil va être narré à partir d’un « commentaire », par exemple : « tu sais, le méchant, il ressemblait à... ». Le mouvement qui s’effectue ici est très important car il fait percevoir l’objet du discours non détaché encore de l’enfant, il implique son interlocuteur dans le discours, il révèle plus précisément l’objet de la peur, etc. Autrement dit, ce passage d’un genre de discours à un autre renseigne le clinicien que quelque chose se passe dans le cours de la pensée, qui signale l’émotivité, etc.
Pour le diagnostic : Le langage livre les éléments d’une sémiologie « médicale » mais aussi des éléments disparates lesquels, repérés dans le discours, permettent de faire des liens beaucoup plus précis entre l’expression verbale et la réalité psychique de la personne. On parlera ici de « micro-analyse », du locuteur dans son discours avec les notions de subjectivité, de temporalité, de signes insistants...
Des repères linguistiques objectivent la marque subjective d’un individu dans son discours. Le premier repère est le « je » prononcé par la personne, mais est-il suffisant pour marquer la subjectivité ? Non. Par exemple quelle implication du locuteur entre deux énonciations telles que : 1/ une personne entend un bruit venant d’une autre pièce et demande à l’occupant de cette pièce « qu’est-ce que tu fais ? » l’autre répond « je ris » et 2/ une personne qui dit « je vais faire du sport » ? L’implication du sujet est beaucoup plus importante dans le second exemple que dans le premier. Dans le premier énoncé (je ris), la personne décrit une action qu’elle est en train de faire, dans le second, il y a projection d’une action avec un implicite qui peut être « je suis trop gros, je me ramollis ou encore tout simplement « j’ai envie de faire du sport ». L’analyse de la subjectivité dans le discours, on le voit, implique que les éléments associés au « je » soient finement analysés. Ils montreront comment la personne s’implique dans son discours et, par corrélation, à l’objet du discours, comment elle établit le rôle qu’elle y tient (actif, passif), comment elle y distribue les rôles, ceux qui sont inclus dans le discours et celui qu’elle dédie à son interlocuteur (psychiatre), dans quel espace-temps elle place l’objet du discours, etc.
Pour le soin et la rééducation : le langage constitue un problème de professionnel, une technique à acquérir, mais aussi des repères à cerner (récupération de la fonction méta (capacité de distanciation par rapport à son propre discours) ou de l’utilisation de la modalisation (capacité de passer du binaire à la complexité), par exemple. Ces repères vont permettre de situer l’évolution des compétences linguistiques de la personne, lesquelles reflètent souvent en psychiatrie son état, les actions possibles du professionnel et leurs modalités.
La notion d’évaluation est ici plus que pertinente, elle est indispensable. Elle intervient également lorsque, en situation d’étayage, se pose la question du niveau du langage du patient par rapport auquel on se place pour intervenir. Ce concept d'étayage est essentiel en psychopathologie, notamment dans les troubles de l'acquisition du langage ou sa rééducation. C'est en fait un outil dont on se sert couramment, lorsque l'on est par exemple avec un enfant et que l'on essaie de lui faire raconter une histoire...
Cerner les différents types d'étayage est très précieux pour évaluer où se placent les difficultés de la personne qui a besoin d'aide au niveau de son discours et également objectiver ses progrès. Dans les cas où la rééducation est très pénible, et surtout durant les premières semaines, la prise en compte de la frustration est capitale. Il s’agit d’évaluer le moment où le patient va se décourager, ce qui peut avoir pour résultat chez lui de ne plus faire d’effort et peut-être même de refuser de revoir la personne qui le rééduque.
Mais toute interaction médiatisée par le langage n’a pas pour but la rééducation, même lorsqu’elle relève de la pathologie. Parfois il s’agit de saisir l’organisation d’une pensée à travers le langage, de saisir les affects liés à une situation qui y seront exprimés. Il sera alors fondamental de suivre l’enchaînement du discours de la personne, sans se fier uniquement au nombre de mots d’un même champ pour en tirer des conclusions. Prenons l’exemple d’une personne déprimée : elle pourra utiliser des termes à connotation négative en nombre important. Cela indiquera évidemment de façon générale qu’elle est dépressive, mais le simple fait de regarder cette personne aurait indiqué son état. Il sera dans ce cas beaucoup plus important de suivre l’enchaînement de son discours, ce qui permettra de saisir véritablement les liens renvoyant à cette dépression, et ce qui la mobilise.
Voici, pour illustrer cette démarche, quelques éléments d’analyse à partir d’un texte remis à son psychanalyste par un patient.
Texte - La nuit dernière j'ai pleuré. Seul j'ai craqué. Je revoyais mon père, avec ses plans, j'ai pris subitement conscience que je dormais dans la pièce ou jadis il a exercé sa profession. Je me suis rappelé un souvenir de gosse très court. Mon Père était derrière son Bureau et moi gamin, j'arrivais juste au ras de la Table. Puis dans mon chagrin (j'ai chialé fort, avec des spasmes) j'avais envi de me Blottir dans les bras de Valérie, de Mireille. Pas l’envi de faire l’Amour mais de sentir le corps réconfortant de l’une d’elle. J'avais envi d’être embrassé, protégé, d’avoir des caresses. J'ai très peu dormi, 5 heures. Lorsque je me suis levé j'ai fait une crise d’allergie, comme si jamais une femme ne pourra m’aimer. Puis j'avais aussi le Sentiment de vivre que sur des échecs. Pourtant j'ai voulu m’arracher cette idée de la tête en allant passer mon code. Puis je l’ai pas eu. J'ai fait 5 fautes de trop.
Ce texte commence par un récit “ La nuit dernière, j’ai pleuré ”, suivi par un discours sur soi "seul j'ai craqué", puis discours réflexif "je revoyais... suivi d'un récit "mon père était derrière..." suivi d'un discours sur soi "puis dans mon chagrin" suivi d'un commentaire entre parenthèses “ (j'ai chialé fort) ”, d’une reprise du discours sur soi "pas l'envie de ...", d’un récit "j'ai très peu dormi" suivi d'un commentaire "5h" puis reprise du récit "lorsque je me suis levé" suivi d'un commentaire "comme si...". Reprise du discours réflexif "puis j'avais le sentiment" puis récit "puis je l'ai pas eu". Un commentaire termine le texte "j'ai fait 5 fautes de trop".
Quatre genres de discours organisent donc ce texte et le font fonctionner : récit, discours sur soi, discours réflexif et commentaire.
Allons plus loin. Le début du récit raconte un vécu, un fait, le passage au discours sur soi “j’ai craqué” introduit un état ; enfin un discours réflexif introduit une image (pensé) plus ou moins figée celle “du père avec ses plans”. Ces trois genres de discours abordent le thème sous des aspects différents : celui d’un vécu, d’un senti et d’un pensé.
Pour situer le (ou les) thèmes abordés, l’attention va se porter sur l’accentuation, la récurrence et le mouvement de certains termes qui renvoient à un thème commun. Elle permet également de découvrir une connotation depressive :
pleurer –> craquer –> père (revoir) –> souvenir vécu avec le père –> chagrin –> se blottir –> sentiment d'échec –> échec.
Si nous suivons maintenant la succession des termes, nous nous apercevons que dans ce texte le locuteur passe d’un monde à l’autre et que ces passages participent à éclairer le sens :
La nuit dernière : monde de la réalité présente ;
je revoyais mon père avec ses plans : monde du souvenir (général)
je me suis rappelé un souvenir de gosse très court : monde du souvenir (particulier) ;
j’avais envie de me blottir... : monde imaginaire ou fantasme ;
en allant passer mon code : monde de la réalité présente.
En résumé, le thème est annoncé dès le premier énoncé “j’ai craqué” et la raison évoquée “je revoyais mon père avec ses plans”. A ce monde de l’enfance, emprunt de tristesse et d’abandon se mêle et se substitue celui de l’attente présente d’être protégé, aimé, de ressentir le corps réconfortant d’une femme, dans un contexte de sentiment d’abandon. Ce sont ces aller-retour entre les genres et les mondes autour du thème qui mènent à une première compréhension du texte. L’interprétation, en tant que relation d’éclairage sur le fonctionnement d’un énoncé par rapport à la référence, au discours qui l’environne, etc. , c’est-à-dire finalement la façon dont il fait sens, va pouvoir la compléter.
Les outils issus des sciences du langage sont un moyen non négligeable à utiliser par le psychiatre. Ils ouvrent sur une technique où l’attention se porte aussi sur les mouvements du discours et où le processus thérapeutique peut être finement appréhendé. C’est la base éclairée d’une action possible.
Après avoir longtemps restreint son influence aux champs cliniques de la psychiatrie transculturelle et des ethnopsychiatries, l’apport de la sociologie et de l’anthropologie s’est considérablement enrichi au cours des vingt dernières années. Fruit d’un double mouvement de renouveau, tant de l’anthropologie que de la psychiatrie elle-même, les complémentarités entre la psychiatrie et les sciences sociales semblent enfin sortir des conflits et des controverses qui ont depuis les origines émaillé les tentatives de rapprochement inter et/ou transdisciplinaire. Mais ce faisant, la place et la fonction que l’anthropologie et, dans une moindre mesure, la sociologie occupent désormais en psychiatrie se sont profondément modifiées. Alors que jusqu’aux années 1980, la psychiatrie se fondait sur une anthropologie générale (au sens philosophique), l’anthropologie culturelle et sociale a progressivement remplacé cette anthropologie générale classique, passant du statut de référent général à celui d’instrument technique, d’une part, et de caution théorique d’autre part.
Ainsi, l’internationalisation de la psychiatrie occidentale et de ses classifications a imposé une validation transculturelle de ses outils et de ses pratiques à partir d’enquêtes de terrain empruntant aussi bien des concepts que la méthodologie de la sociologie et de l’anthropologie. Si, avant les années 1980, de telles approches avaient déjà vu le jour (cf. par exemple les travaux de Roger Bastide en France), elles concernaient essentiellement la recherche sociologique et n’appartenaient pas en propre à la psychiatrie. Le renversement des années 1980 marque l’entrée de ces recherches dans le champ propre de la psychiatrie. Dépassant le seul contexte de la psychiatrie transculturelle et/ou des ethnopsychiatries, l’anthropologie est non seulement venue renforcer l’approche épidémiologique, mais plus fondamentalement encore constituer progressivement un élément essentiel du socle du rapport normal/anormal fondateur de la clinique.
Ce mouvement est également contemporain d’une redéfinition des objets de l’anthropologie et de ses méthodes d’investigation qui a largement bénéficié aux différentes approches de la psychiatrie. La naissance de l’anthropologie médicale anglosaxonne dans la suite de l’ethnomédecine, l’apparition de professionnels de cette discipline au sein des instances de l’OMS, jusqu’à la toute récente anthropologie politique de la santé ont constitué les ingrédients de cette réorientation vers le champ de la psychiatrie.
Enfin, le troisième élément de cette ébauche de généalogie est plus politique et concerne le glissement de la psychiatrie vers le champ plus vaste de la santé mentale. Territoire de moins en moins réservé aux seuls professionnels soignants de la santé mentale, son expansion s’est accompagnée d’un redécoupage des frontières de la discipline psychiatrique au sein desquelles de nouveaux acteurs sociaux se sont vu attribuer des missions et des pouvoirs grandissants. Or, la mise en œuvre de plan de santé mentale repose sur une approche plus populationnelle que clinique utilisant, au moins partiellement, des méthodes de la sociologie et de l’anthropologie.
Ce tournant est donc marqué par un partenariat rénové avec les sciences sociales ; tantôt il s’agit d’un apport théorique et instrumental visant l’enrichissement de la discipline, tantôt il s’agit d’un regard critique sur le développement de la discipline, mais dans tous les cas, l’anthropologie et la sociologie jouent désormais le rôle d’un référent extérieur au seul domaine de la clinique pouvant asseoir tant la légitimité que la validité d’un savoir à vocation internationale.
Sans doute faut-il tenir compte, actuellement, des mouvements divers qui agitent les sociologues, au point de conduire à parler d’un éclatement des sociologies, sous des pressions culturelles et politiques. Par exemple, la redéfinition en cours, sous tendue d’exigences politiques et culturelle, des identités collectives (nationale, supranationales, communautaires culturelles) laissent le psychiatre en difficulté pour appréhender non les mécanismes identitaires mais leur formulation collective et individuelle.
L’intérêt de plus en plus prononcé pour l’histoire de la psychiatrie et les évolutions des sciences historiques et associées (archéologie, paléontologie, etc.) renvoient aux travaux des sciences de l’esprit sur la construction de la mémoire et des souvenirs articulés en un discours.
L'histoire n'est pas l'anamnèse. Si les patients souffrent, en général, de réminiscences, c'est bien justement qu'ils ne réussissent pas à avoir ou à se faire une histoire personnelle cohérente. Aussi n'est-il jamais question de reconstitution historique mais de pouvoir se raconter une histoire satisfaisante au moment ou on se la raconte.
De la même manière les évènements de vie, censés avoir des effets traumatiques en tant que tels, ne permettent pas de rendre compte de la psychogenèse de bon nombre de troubles. L'impact des accidents, deuils, stress dépend toujours de la manière dont on les a reçus, et ensuite métabolisés.
- 1 - A partir de ce constat de proximité ou d’analogies, on peut intégrer l’histoire aux sciences de l’esprit, puisque à l'évidence, il s'agit moins de recueillir les faits que de les interpréter en fonction d'un continuum, d'un sens de l'histoire. Il y a donc une recherche sur le fait choisi, et sur le temps (le tempo, le rythme, le "timing") privilégié.
- 2 - Mais les psychiatres peuvent-ils attendre beaucoup d’une science en mouvement ? Sans aucun doute, ne serait-ce que parce que les historiens, en général, annoncent clairement le point de vue qu'ils adoptent (marxiste, de droite, etc.). Les débats sur l'enseignement de l'histoire sont à la fois vains et éternels : les faits ; les dates renvoient au souci d'anamnèse qu'ont les psychiatres ; les grands mouvements renvoient a leur souci de fonctionnalité.
En revanche, les psychiatres, dans leur interprétation des faits devraient tenir compte des divers temps (F. Braudel). Il va de soi que le temps historique est, pour les psychiatres, a l'échelle de l'homme, de sa vie, et de ses souvenirs ou réminiscences ;
Dans un entretien, ces réflexions historiques sont utiles pour relativiser le temps chronologique au profit du temps vécu. Mais celui-ci peut être, comme en histoire, gradué, évalué, classé.
°°°
Ce survol forcément rapide et non exhaustif des liens entre sciences de l’esprit et psychiatrie permet de tirer quelques conclusions et vœux.
Il s’agit, comme dans toute démarche clinique en psychiatrie, d’un engagement personnel du psychiatre, engagement qui implique connaissance et investissement. Le « point de vue » scientifique doit toujours être corrélé aux autres points de vue. C’est ce qui permet de parler d’aller et retour permanent.
En ce qui concerne les pratique, nous avons délibérément laissé de coté la question de la formation, du contrôle et de la validation des psychothérapies en général. Elle sont pourtant des méthodes dérivées des sciences de l’esprit, et représentent une part importante de l’activité psychiatrique. Aussi faut-il rappeler que la formation aux diverses PST ne peut se faire qu’à partir d’une connaissance des autres méthodes possibles et un enseignement de la science qui la fonde.
En revanche, on a vu combien la connaissance sans cesse actualisée, des mouvements des sciences de l’esprit est indissociablement liée à l’évolution de la psychiatrie : travail d’équipe et en réseau, discontinuité des soins de longue durée, nouveaux champs d’action (nourrisson – personnes âgées) qui sollicitent des connaissances de psychologie individuelle et collective, du conscient et de l’inconscient.
La profession se doit de peser de tout son poids sur l’évolution de la clinique (pas de classification qui se croirait a-théorique), des pratiques, des organisations de soin en rappelant sans cesse l’importance capitale des sciences de l’esprit, sans aucun doute plus grande que celle des sciences de la nature actuellement plus médiatisées.
Outre le fait que chaque paragraphe de ce chapitre mériterait, quelle que soit la masse de documents existants, d’être remis à la question sous la forme d’un colloque d’un groupe de travail ou d’une publication sous l’égide éventuelle de la Fédération Française de Psychiatrie, quelques orientations plus politiques peuvent être dégagées dans les trois domaines classiques de la formation, de la recherche et des pratiques.
Les sciences de l’esprit devraient désormais être systématiquement incluses dans la formation initiale des psychiatres, au titre même des sciences fondamentales.
Il ne s’agit pas seulement de faire du psychiatre un « honnête homme ayant des clartés de tout » mais de remettre à leur place des corpus scientifiques indispensables à l’exercice de la psychiatrie.
Dans cette formation initiale, une place singulière devrait être faite à la psychanalyse car il ne s’agit pas seulement d’une méthode de travail, mais aussi et peut-être surtout, d’une approche particulière de la personne.
Bien entendu, ces formations aux différentes sciences de l’esprit ne peuvent s’envisager qu’accompagnées d’une réflexion sur les méthodes pédagogiques spécifiques qu’elles nécessitent.
En ce qui concerne la formation post-universitaire, elle doit impérativement compléter cette formation initiale.
En particulier, afin de faciliter les approches communautaires par les psychiatres (et favoriser le travail en réseau), il conviendrait d’organiser et de promouvoir des recherches-actions communes avec des disciplines affines de terrain.
Les internes en psychiatrie doivent pouvoir être formés, (formation intégrée à leur cursus), à la recherche (DEA) dans les branches des sciences de l’esprit.
De la même manière qu’il existe une commission Psychiatrie-INSERM, il serait important de créer des liens avec le CNRS et la Maison des Sciences de l’Homme.
Ces propositions d’intégration des sciences de l’esprit devraient être concrétisées par la FFP par des démarches auprès des Ministères de la Santé, de la Recherche et de l’éducation et des organismes nationaux et internationaux concernés.
En ce qui concerne les pratiques, sans doute seront-elles examinées, voire évaluées tout au long des chapitres de cet ouvrage. Mais on peut affirmer que c’est la diversité des pratiques qui fait l’unité de la psychiatrie ; toute tentative d’isolement, de sous spécialité, voire de nouvelle spécialité autonome, ne pourrait qu’être néfaste à l’ensemble de la psychiatrie, des psychiatres et des malades.
Rapport rédigé avec une contributions spécifique de D. WIDLOCHER et SD KIPMAN (Indroduction), D. WIDLOCHER (psychanalyse et sciences cognitives), J. MIERMONT (science des systèmes et éthologie), M. THURIN (linguistique), R. RECHTMAN (anthropologie et sociologie), SD KIPMAN (histoire).
Dernière mise à jour : jeudi 15 avril 2004
Dr Jean-Michel Thurin
 Commander l'ouvrage | 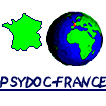
|