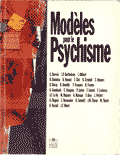
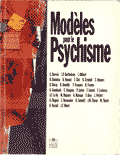
A partir des différents modèles qui ont soutenu l'explication de la folie puis de la pathologie mentale, il s'agit d'abord, dans le texte d'Hervé Bokobza, de dégager les tendances et variables qui participent à l'élaboration d'une théorie du fonctionnement psychique.
Persuadé que la pratique psychiatrique est un champ privilégié de l'étude du fonctionnement du psychisme humain, j'envisagerai son approche historique avec l'objectif de repérer quels modèles ont jalonné, et jalonnent, le chemin de cette discipline récente du champ médical.
Il y a, en effet, deux siècles qu'est née la Psychiatrie, et son arrimage à la médecine a eu pour corollaire social, la désignation de la folie comme maladie mentale.
Il est important, pour repérer dans quelles conditions cela s'est effectué, de retracer schématiquement le parcours du concept primitif de la folie.
Il a fallu attendre l'époque de la Renaissance et de la Réforme, pour sortir la folie des catégories du Sacré : soit du Sacré Religieux, soit du Sacré Démoniaque. En effet, à mesure que triomphe le Christianisme, un schéma manichéen du délire s'impose : il serait le fruit du péché, de la lutte de Satan contre Dieu. C'est lorsque la conception théologique du monde va s'amenuiser, que le fou va se trouver plutôt placé dans la catégorie des improductifs, des oisifs, des criminels, des dangereux ou autres mendiants, que les mécanismes de ségrégation et d'exclusion prendront alors le visage moderne que l'on a connu et que l'on connaît encore : l'enfermement.
Le bûcher et l'enfermement semblent être deux destins très différents réservés à la folie. Pourtant, leur communauté apparaît dans la question du bouc-émissaire. Celle-ci est posée depuis longtemps ; elle est toujours d'actualité et continuera à se poser encore. Il me paraît important d'en décrypter brièvement les mécanismes car ils participent encore aujourd'hui aux résistances propres à interdire à la Psychiatrie son intégration dans le champ de la recherche sur l'homme biologique, ce terme étant à entendre comme science de la vie.
En effet, depuis toujours, la normalité de l'individu sain se trouve confirmée par le masque inhumain du fou. En refusant de se reconnaître dans ce dernier, le premier accepte de bon coeur l'inhumanité de sa subordination. Il s'agit, au-delà d'un phénomène d'étrangeté, d'un phénomène qui serait étranger à la nature humaine : une altération radicale ; le fou est un être qui ne serait pas fait de la même matière que nous. Dans ce même mouvement se mettent en oeuvre des mécanismes d'extériorisation : c'est en dehors du Moi que se trouvent et doivent se trouver le Mal, le Péché, le Malheur. Reportez vous, comme témoignage de cette attitude, à ces fameux textes bibliques où Aaron, mettant les mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui, toutes les iniquités des enfants d'Israel, leurs forfaits, leurs péchés ; et il laissera aller le bouc dans le désert.
Avec la naissance de la Psychiatrie comme discipline médicale, ce phénomène a-t-il disparu ? S'est-il atténué ? Quel effet a eu cette naissance sur la conception du dis-fonctionnement psychique ?
A priori, en effet, médicaliser la folie était une façon de l'inscrire dans l'ère de la diffusion et des découvertes scientifiques ; c'était placer ce qui devenait «la Psychiatrie» hors du champ des croyances et du sacré. Cependant T. Satz se demande si cette démarche n'est pas issue de l'idéologie chrétienne agrémentée à la source du XIXème siècle : «le pouvoir passe de la Religion à la Science. Le fou est toujours dépossédé de sa folie ; la conception de la folie a toujours pour objet de garantir et de conforter le pouvoir existant».
La querelle entre organicistes et psychistes va se dérouler durant la seconde moitié du XIXème siècle. Elle verra d'abord la victoire des premiers et la tentative de faire correspondre certains types de délires avec certaines perturbations localisées du cerveau. Ce modèle est typique du modèle mécaniste ; à noter, entre autre, que rien n'explique pourquoi une inflammation des méninges donnerait un délire de grandeur... Ceci n'est pas une anecdote, ni un problème subalterne ; il n'est pas sûr que cette énigme n'ait pas encore aujourd'hui des effets organisateurs pour un certain modèle psychiatrique. Les conceptions de De Clérambault sont une illustration de ce courant mécaniste. Le noyau est d'ordre histologique, tandis que l'idéation est d'ordre psychologique. Ce grand psychiatre du début du XXème siècle déclarait : «Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, je n'y comprends rien, je n'y suis pour rien ; ceci constitue une preuve de la genèse a-psychique des troubles».
En 1856 naissent Kraepelin et Freud. Le premier, considéré comme le père de la psychiatrie moderne, assimile organicisme et endogénie ; il cherche à se maintenir dans l'ignorance de la langue du malade, seule condition d'observation. Quand au second, il va bousculer toute la problématique de la causalité en mettant en évidence le rôle de processus psychiques actuels, compatibles avec le substrat neuro-physiologique, qui trouvent leur source dans la passé. Nous allons y revenir.
C'est peut-être Bleuler qui, finalement, a introduit la première coupure dans le schéma organiciste primaire : s'il y a une base organique indiscutable, dit-il, la symptomatologie ne correspond pas aux effets immédiats de la maladie ; elle constitue des productions secondaires de la lutte du sujet contre l'envahissement psychotique. Le rôle de la personnalité intervient. La coupure organo-psychique ne devient plus aussi pertinente. Ainsi, à la conception d'une maladie organique à manifestations psychiques (de cause à effet), va progressivement se substituer celle du sujet humain comme totalité organo-psychique chez lequel peut se produire une transformation psychiatrique des conduites ; ce courant sera développé par Morel et surtout à la suite de Kretschmer, Follin, et Delmas qui soulignent le fait que n'est pas fou qui veut : il y a un terrain, une disposition, un caractère, comme dans la paranoïa qui ne serait qu'une hypertrophie de certaines tendances déjà existantes.
Nous laisserons à Jean-Michel Thurin le soin de nous exposer la conception du modèle Freudien. Pour notre part, il nous paraît important d'en dégager brièvement l'acquis qu'il représente pour la Psychiatrie.
En effet, l'approche psycho-dynamique proposée par Freud a bouleversé la conception psychique de l'homme. Elle est d'un apport pour la biologie d'une richesse encore peu exploitée mais elle a déjà transformé la pratique psychiatrique. En France, l'entrée de la psychanalyse a été lente ; elle n'a pris son essor qu'après la deuxième Guerre Mondiale. Elle a été, comme toute Révolution, combattue, déformée, exploitée, dénaturée. Elle reste une découverte incontournable car c'est pour, contre, avec, à côté d'elle que s'élaboreront les différentes théories ou modèles psychiatriques.
La Psychanalyse n'est pas la Psychiatrie ; la technique instituée par Freud n'est pas une panacée et ne peut-être érigée en technique unique de soin des malades mentaux. Qui plus est, en ce qui concerne la Psychose, Freud lui-même a érigé certaines limites aux traitements psychanalytiques. Mais on peut dire que l'apport Freudien a bouleversé notre façon de penser la Psychiatrie et de penser en Psychiatrie et ceci, grâce à l'articulation de deux concepts fondamentaux de son oeuvre : le transfert et l'identification. Ces deux concepts ont ouvert la possibilité d'un nouvel espace de soin en situant le psychiatre dans une position qui dépasse celle du simple observateur, du prescripteur médical ou du gardien de l'ordre social. Nous y reviendrons plus en détail. Sachons, dès à présent, que ceci nous permet de ne plus nous affronter à l'incohérence durable et inaltérable de la maladie mentale. L'objet même de la psychiatrie s'est trouvé modifié.
Mais la psychanalyse Freudienne a, elle-même, subi toutes sortes d'évolutions ; parmi elles, il importe de présenter ici celle issue du courant lacanien qui montre bien comment un modèle du psychisme peut se radicaliser donc s'affaiblir. D'une technique thérapeutique, la psychanalyse s'est trouvée érigée, sous l'influence de ce courant idéologique particulièrement virulent et a-biologique, comme une fin en soi, une panacée universelle, refoulant le biologique et l'organique au rang du «scientisme», façon élégante de mépriser les découvertes scientifiques et de situer l'apport freudien hors de ce champ.
Sous les deux facettes extrêmes que nous venons de présenter, l'histoire nous enseigne ainsi que le mariage entre Psychiatrie et Médecine a plutôt les allures d'un mariage de raison que d'un mariage d'amour ; d'une part, en posant cet acte devant la Loi, peu après la Révolution Française, c'est la dimension du soin possible qui est érigée ; ceci représente une rupture et un progrès considérable. Mais, dans le même mouvement, le soin se trouve référé aux idéaux d'une Médecine en plein essor positiviste : la Psychiatrie naît comme un enfant hybride, rivé au schéma de la neuro-pathologie et de la clinique médicale. Et pour reprendre les propos de H. Ey : «les conditions de naissance de la Psychiatrie ont été désastreuses». Ces conditions sont parties prenantes du débat qui a alimenté les passions depuis deux siècles : quelle est l'origine de la folie ? Certains au début du XIXème siècle, associent l'origine morale à la recherche de traits organiques de dégénérescence (Pinel, Esquirol). Cette tentative semble trouver une confirmation dans la description, par Bayle en 1822, de la paralysie générale. C'est la première maladie parfaitement décrite sur le plan anatomo-clinique (syndrome psychique, syndrome neurologique, syndrome humoral) ; sa nature syphilitique ne sera affirmée que quelques années plus tard. Cette affection va, dès lors, fonctionner comme modèle de la causalité en psychiatrie. Ainsi, pour les psychiatres de cette époque, les troubles psychiatriques sont parallèles à l'évolution des lésions inflammatoires. Cette découverte a eu un effet considérable pour appuyer les thèses de l'organicité des troubles mentaux et stimuler la recherche sous cet angle. Et pourtant, bien peu d'autres syndromes de pathologie mentale ont pu trouver une aussi belle corrélation organique... même en examinant de fond en comble, comme ce fut le cas, le cerveau, les humeurs et plus récemment les cellules et le patrimoine génétique de malade.
Ce modèle aurait dû perdre progressivement de son intérêt pour les scientifiques. Mais la psychanalyse des vingt dernières années a contribué, paradoxalement, à ressusciter le dualisme ; la psychanalyse s'est mise à occuper une place mystique, faisant figure d'un sacré qui n'a rien à envier au sacré primitif. Ceci a eu pour effet de reconstruire, reconstituer le socle de l'autre face du dualisme : la psychiatrie biologique. Quel désastre, quel déshonneur pour notre discipline que de voir une partie de ses praticiens devoir lui associer le terme «biologique», comme si il fallait se distinguer d'une autre psychiatrie qui ne le serait pas ; que de dogmatiques ont ainsi pu enfin émerger, réduisant le champ du psychisme humain au bout de la lorgnette du quotidien, la recherche à l'affrontement sans profit pour la science... Ainsi, le réductionnisme qui a tenté de régner dans certains cercles de la psychiatrie ces temps derniers s'appuie sur des éléments bien précis :
la renonciation à l'apport psychanalytique ;
l'appui sur l'histoire de la naissance de la psychiatrie. Nous l'avons déjà énoncé : à cette naissance correspond le placage d'identifications violentes et erronées de la psychiatrie à la médecine qui ont parcouru un siècle de pratique. Deux siècles après sa naissance, le courant dit de la psychiatrie biologique tente d'ériger en modèle les conditions mêmes de sa naissance ;
la découverte des médicaments psychotropes et la naissance d'une psycho-pharmacologie. Certes cette découverte a bouleversé la pratique psychiatrique ; jusque là, en effet, les théories organicistes n'avaient débouché sur aucune thérapeutique nouvelle ni sur une théorie cohérente à l'épreuve de la clinique.
Avec l'introduction des drogues psychotropes, les choses en vont autrement, puisque l'élaboration théorique part de la découverte (empirique) de drogues agissant non seulement sur le système nerveux, mais aussi sur les symptômes psychiques. Ainsi, c'est sur la base de l'expérience d'effets thérapeutiques que le problème de la connaissance scientifique du fonctionnement psychique va être posé. A partir de là, en rapport avec les progrès considérables de la biochimie, sont conçus des modèles biochimiques de la maladie mentale, avec une systématisation souvent hâtive et incertaine. La biochimie et les psychiatres biochimistes, peu nombreux, qui conduisent ces recherches, sont d'ailleurs relativement prudents dans l'interprétation de leurs résultats. Mais les psychiatres, qui n'étaient peut-être non préparés à la découverte de cette science venue d'ailleurs (du Laboratoire) ont subi la fascination, la passivité et le renoncement devant l'apparente solidité de cette belle étrangère. Nous le savons, les psychotropes apaisent souvent la souffrance ; ils peuvent permettre d'apaiser les conflits mais ne les résolvent pas. Leur utilisation mérite une réflexion éthique et thérapeutique qui doit se dégager du climat médical traditionnel. Un chiffre : entre 1960 et 1977, la littérature dans le domaine de la neuro-biologie a quadruplé, alors qu'elle ne faisait que doubler dans le reste de la littérature scientifique. Cette exploration semble cependant marquer le pas aujourd'hui et l'enthousiasme des premiers résultats fait place progressivement à un climat de modestie, voire de scepticisme. Certains psychiatres ont tenté de rassembler les deux découvertes du XXème siècle : psychanalyse et médicaments psychotropes. Henri Ey, grande figure de la Psychiatrie Française, a conçu un organo-dynamisme qui prétendait dépasser la tradition cartésienne du dualisme en France : la maladie mentale serait l'expression d'une dissolution de l'activité psychique conditionnée par un processus organique. Nous pensons, cependant, que cette conception a participé au delà des souhaits de son auteur, au maintien du dualisme, en préservant le caractère individuel de la vie mentale, ce qui implique de situer l'origine de ses troubles dans la matière cérébrale.
Aujourd'hui, où en sommes-nous ? S'il n'est quasiment plus question d'affirmer, sauf pour quelques irréductibles, une relation de causalité directe entre une anomalie biologique qui serait initiale et une maladie mentale qui en serait la traduction psychique, la question de la causalité reste posée. Si vivement posée, si difficile à aborder, qu'il semblerait qu'on cherche à l'éviter. Les conflits ont été si aigus, si improductifs, si passionnels, qu'un temps de pause était peut-être nécessaire ; un temps de confrontation et de conflictualité positive ou simplement de vide, voire de béance. Le temps d'intégrer, d'élaborer, de digérer les dernières découvertes. Mais voici que certains, et pas des moindres, ont utilisé ce temps à l'élaboration d'une nouvelle classification des Maladies Mentales. Eliminant d'un trait de plume la question de la causalité, l'Association Américaine de Psychiatrie a proposé aux psychiatres du monde entier son Manuel Diagnostic et Statistique de Systèmes de Critères Diagnostics. Ceux-ci permettent de définir chaque classe nosologique. Le diagnostic est fondé sur une analyse multi-axiale, pouvant être traitée par ordinateur et destinée à permettre un consensus d'évaluation des troubles mentaux entre tous les psychiatres. Renonçant de façon systématique à l'approche psychopathologique, elle se dit a-théorique et s'appuie sur un positivisme réaliste, intégral, total. En fait, sous ce couvert d'a-théorisme, c'est la grande remédicalisation de la psychiatrie qui est proposée. Certains parlent de la mise en place d'un courant néo-kraepelinien dont l'influence est considérable car elle noue une alliance solide entre la clinique descriptive et la psychiatrie dite biologique. En quelque sorte, elle renonce à la théorisation du domaine psychique pour la confier à un domaine où l'on ne traite que la matière non psychique.
Cet a-théorisme se veut scientifique car objectif. La confusion entre objectivisme et scientifisme est savamment entretenue. Ce qui est dit «objectif», c'est que l'on s'intéresse exclusivement aux symptômes, qu'à ce qui est exprimé dans ce symptôme. Il est difficile d'être plus catégorique dans l'évacuation du sens. Il faut éliminer la notion de transfert, purifier le champ sémiotique ; en dernière analyse, éliminer le psychiatre ; ainsi, on ne parle pas de l'homme atteint d'un accès maniaque, mais de la crise de manie comme entité isolée et objectivable, comme si nous revenions à la physique classique où l'étude de l'objet ne prenait pas en compte l'univers qui l'entoure et même ce qui le secrète. Voici venu le temps de la fumée sans feu, ou pour prendre une métaphore médicale, du pus sans agent infectieux. Certes, ce souci d'objectivité pourrait avoir comme substrat le souhait de soustraire l'homme malade au psychiatre et à ses positions théoriques, affectives ou idéologiques; mais peut-on le faire en «abandonnant» à ce psychiatre la Maladie Mentale qu'il est présumé contenir ?
La clinique du symptôme (liée à la découverte Freudienne de l'existence d'un conflit psychique qui tente de s'exprimer ou de prendre sens) ne doit pas pour autant être disqualifiée. Beaucoup de signes ont une valeur diagnostique et peuvent nous orienter pour le choix des méthodes thérapeutiques : attitudes, nature du lien que nous pouvons instituer avec un patient, conditions de soin que nous pouvons lui proposer. C'est en fait l'idéologie qui anime cette clinique du signe et non l'utilisation qui peut en être faite que nous pouvons regretter. En fait le risque est de surdéterminer l'importance du signe aux dépens du processus qui le sous-tend et de l'action que le thérapeute peut y avoir. La psychiatrie a déjà une longue expérience de la façon dont l'objectivation d'un «objet malade», par la recherche de signes cliniques traditionnels a bloqué la dynamique de crise et ses potentialités thérapeutiques incluses dans son instabilité. Là aussi pointe le réductionnisme pseudo-scientifique où la psychiatrie se rangerait en médecine comme toutes les disciplines médicales : signes, diagnostic, traitement. Ce schéma aussi simpliste que simplificateur emprunte un chemin où, dans le champ biologique restreint qui est le sien, l'homme serait un système entier recevant de l'extérieur, calories, apprentissage, information, un homme vivant dans un univers non psychique ; en quelque sorte une biologie marquée par l'idéologie de l'insensé et d'un ordre rigidifié des dépendances.
Nous l'avons repéré, ce modèle psychiatrique est aussi vieux que la naissance de la psychiatrie elle-même. Mais aujourd'hui, il prend appui sur des découvertes scientifiques, en les pervertissant ; peut-être occupe-t-il cette place en réaction à une perversion de l'apport Freudien traité comme une véritable mystique. L'un comme l'autre, en dernière analyse, dépossèdent l'homme de sa production psychique ou de sa folie. La folie est rejetée au dehors, abandonnée tantôt au champ médical, tantôt au champ mystique.
Ces évolutions chaotiques peuvent nous aider à appréhender comment tout un courant sociologique a pu envahir le champ psychiatrique : selon celui-ci, la maladie mentale serait liée à l'oppression et à l'exploitation du sujet ; ou encore, le fou serait une victime sacrificielle et l'étiquette de malade mental aurait pour fonction de stigmatiser et de punir le comportement de membres déments ou déviants de la Société. Je ne développerai pas les tenants et aboutissants de ces modèles (centrés autour du courant anti-psychiatrique) car je ne pense pas qu'ils aient leur place dans ce Colloque. Cependant il faut savoir qu'ils infiltrent peu ou prou la pratique psychiatrique notamment dans ses dimensions éthique et philosophique.
Où en sommes-nous à l'aube de ce XXIème siècle ?
R. Angelergues dans un ouvrage pertinent pose magistralement les problèmes. Il pense que la psychiatrie est dans une crise idéologique et théorique très importante : «En fait, il est possible d'affirmer, nous dit-il, que la découverte de la psychanalyse et des psychotropes a eu pour conséquence de conforter le dualisme. Il faut tenter de décrypter ce dualisme car il ne s'agit plus de la trop claire opposition entre âme et corps, mais plus précisément de la séparation entre somato et psychique co-habitant dans un même organisme corporel, ayant entre eux des rapports et des interactions, mais séparés par une barrière fictive et théorique qui renvoie le somatique vers les sciences biologiques et le psychisme vers les sciences humaines. Cette conception n'a rien à voir avec une conception psychosomatique dont elle accepterait éventuellement quelques ponts de passage ou d'interaction entre les deux domaines. De ce dualisme nouveau, le psychique risque d'y perdre son âme au sens où Victor Hugo écrivait : «Le corps humain cache notre réalité, la réalité, c'est l'âme. (...)». A ce point, l'auteur poursuit : «Car au lieu de chercher à découvrir cette réalité cachée dans l'apparence et la complexité du corps, on la cherche dans l'extérieur où l'homme se manifeste ou est manifesté par les formes sociales et par le tissu culturel d'une civilisation (...)». Nous tenons à souligner l'importance de ces propos, car ils nous paraissent refléter le moment actuel de l'histoire de la psychiatrie. R. Angelergues poursuit «plus qu'une crise qui serait propre à notre discipline, c'est la crise de l'idée de l'homme qu'il s'agirait aujourd'hui de traiter ; faute de vouloir ou de pouvoir penser l'homme, on cherche à retrouver sa réalité en agissant sur lui par tous les moyens. Cette crise tend à réduire les oppositions traditionnelles et la psychiatrie participe peu ou prou à ce prurit généralisé ; ce dualisme traditionnel, même s'il change de formulation, construit tous les jours son édifice en séparant ce qui serait de l'intérieur du sujet (l'endogénie traditionnelle), et ce qui serait l'action du milieu (exogénie ou notion de pathologie réactionnelle)».
A l'aube du XX ème siècle, la psychiatrie est animée par différents types de pratiques ; faudrait-il laisser ces divers champs s'ignorer, se contredire voire s'opposer ? Certains pensent qu'une confrontation, un essai de rapprochement ou une pensée intégrant une convergence serait néfaste à la spécificité de leur approche ; chapelles à défendre, certitudes à confirmer, à priori dévastateurs. Ces territoires à préserver nous paraissent, hèlas, être le produit de l'histoire de la psychiatrie précédemment décrite et le maintien, sous une autre forme, du dualisme âme-corps, aujourd'hui dénommé biologique-psychique.
A notre sens, ces positions aboutiront à une impasse qui pourrait s'avérer gravissime pour l'avenir de la psychiatrie et pour la conception de l'homme en général.
Bien au contraire, pour faire avancer la biologie de l'homme, comme science de l'être vivant, il nous parait indispensable de faire appel au psychisme dans une perspective qui doit mettre en mouvement une autre forme de pensée, ouverte à la recherche de ce qui fonde l'homme singulier dans toutes ses dimensions (sociale, physiologique, psychanalytique).
Quel que soit son type d'intervention, la pratique psychiatrique nous apporte des éléments fondamentaux dans la compréhension de l'homme malade et de l'homme tout court :
la maladie mentale est la maladie de la relation. Elle s'exprime dans la relation à l'autre ; les symptômes de souffrance sont toujours exprimés, vécus, nommés en référence au milieu extérieur : il délire («moi qui ne délire pas, je ne comprends pas ce qu'il dit»), il est replié sur lui-même («je n'arrive pas à entrer en relation avec lui»), il est dépressif («il refuse tout ce que je lui propose pour sortir de sa tristesse») etc...
le fonctionnement d'un être humain est le produit de l'interférence entre le milieu extérieur et l'intérieur (l'organisme vivant qu'est l'homme) ; ainsi, il en est de même pour le malade mental.
la rencontre d'un psychiatre et d'un malade obéit aux mêmes lois générales qui régissent la rencontre entre deux êtres humains car la maladie appartient à celui qui la porte, c'est-à-dire qu'elle est l'expression de son fonctionnement psychique et de ses difficultés, à un moment de son histoire.
C'est la position du psychiatre (articulation entre fonction, place, rôle), le cadre de soins proposé, qui permettront le développement d'une relation spécifique. A cet égard, quel que soit le type de pratique, les phénomènes d'identification et de transfert seront au premier plan. Ainsi, nous savons que l'effet d'une prescription médicamenteuse va dépendre, au-delà du produit, de la manière de prescrire, de l'idée que s'en fait le prescripteur, de l'accueil du patient, du moment de la prescription, des effets attendus... ;
aussi le psychiatre représente t-il le milieu ; il agira en conséquence avec, pour l'autre, celui qui est à ce moment le patient. Dans cette rencontre, tout un champ de recherche, d'expérimentation, d'avancées et de reculs va se mettre en mouvement ; il ne s'agit plus de penser le malade en soi ; il s'agit de penser et de vivre l'interférence avec un homme qui souffre ; le psychiatre n'observe pas passivement une maladie mentale. C'est un fait d'expérience où les deux protagonistes sont les acteurs d'une relation ;
souvenons nous qu'à l'origine de la connaissance scientifique, nous trouvons la répétition, qui n'est pas la reproduction des mêmes phénomènes agissant sur un spectateur passif, mais l'essai répété, l'expérience multipliée et diversifiée d'un observateur actif. De plus la physique quantique, en bouleversant les conceptions classiques, nous a enseigné qu'il est illusoire de vouloir lire une réalité indépendante ; la réalité ne peut justement être épuisée par une représentation unique. Nous pouvons dire que la maladie en soi n'est pas une réalité indépendante, tout en existant objectivement.
La rupture, avec le modèle traditionnel, est opérée et peut devenir opérante, dans le processus thérapeutique, si nous abandonnons la conception mécaniste ou linéaire du fonctionnement psychique.
il ne s'agit plus d'éliminer la subjectivité du psychiatre mais de la poser comme un postulat indispensable et incontournable lors du processus de rencontre thérapeutique. Aussi, rien ne nous empêche de lire la pathologie de la relation, en dehors d'une démarche scientifique ou en opposition à elle, en prenant l'observateur comme un acteur de cette démarche. Cette méthode est de ce point de vue similaire à toute méthode scientifique ;
cette subjectivité s'exprime par la transformation que fait le psychiatre du message qu'il reçoit du patient ; par ailleurs, comme dans toute rencontre, ce message va, consciemment ou à l'insu du protagoniste, transformer celui qui le reçoit ; l'objectif est la modification ou le changement du sujet malade ; mais notre expérience nous enseigne qu'ils seront impossibles, si le psychiatre ne possède pas en lui, les capacités à être modifié à son tour, par la dynamique relationnelle engagée avec le patient ;
les difficultés se logent dans le choix de la méthode et de la théorie car dans cette discipline, le psychiatre est non seulement l'instrument de mesure et l'observateur mais aussi le représentant du milieu extérieur, sur lequel va buter le patient. R.Angelergues nous le confirme : «Sa fonction objet observateur instrument de mesure est complexe... De cette fonction, il doit établir la distance, le repérage propre à son travail d'objectivation qui est contradictoire et inséparable de son travail d'objectalisation...»
Poser la maladie mentale comme une maladie de la relation appartenant à celui qui la vit, évoluant dans l'interférence entre le milieu et l'intérieur, nous amène à évoquer deux questions majeures de cette fin de XXème siècle : la causalité de la maladie et les repères nosographiques. Le developpement des neurosciences et de la pharmacologie devrait-il imposer un diktat sur la pensée en psychiatrie qui reléguerait la dimension de la causalité au rang d'un accessoire ou pourquoi pas d'un «surcroit inutile» ? Certains ont, hélas, tendance à répondre positivement à cette question, considérant ainsi la maladie mentale comme la plus banale des affections médicales idiopathiques ou fonctionnelles... Nous pensons, au contraire, que la question de la causalité est plus que jamais à l'ordre du jour car elle permet d'aborder le fonctionnement de l'homme, en général. Un cerveau machine pourrait il rendre compte de la variable plaisir/déplaisir, de l'intrication des pulsions de vie et des pulsions de mort, des contradictions et des conflits qui procèdent à la construction d'un symptôme ? Ce serait alors revenir à la psychiatrie du symptôme, annulant ainsi la réflexion indispensable à toute pratique : pourquoi ces symptômes ? Là aussi des oppositions réductionnistes et régressives nous ont lamentablement envahies : entre ceux qui ne voulaient pas s'occuper du symptôme et ceux qui voulaient les traiter à tout prix (ou à n'importe quel prix) que d'errances et de malentendus... Un psychiatre doit se soucier du symptôme sans oublier que la souffrance est aussi la richesse de celui qui la ressent, qu'elle n'est pas une excroissance tumorale qu'il faudrait opérer, ni une simple expression d'un masochisme mortifère unique gardien de la vie. Les objets extérieurs, pour un individu, prennent sens dans et par la relation sujet-objet. Et c'est le sens qui fonde la causalité psychique car c'est lui qui nous anime, nous fait vivre et entrer en relation.
La nosograhie en psyhiatrie a donné lieu à de multiples débats et continuera à en produire ; nous savons tout simplement aujourd'hui que le terme de structure (névrotique ou psychotique) cache peut-être un pessimisme profond ou une peur ancestrale (le fou c'est l'autre) ; alors devant ce fou, avec qui la relation aurait un caractére d'impossible, nous serions en attente d'une médication miracle... En attendant, combien de mesures d'assistance ont pu recouvrir la peur, la pitié, le rejet ou l'indifférence...
Cette coupure radicale, entre névrose et psychose, étayée par la dimension structurale, a vu son existence ébranlée par une pathologie que le repère structural ne pouvait identifier à lui seul ; nommés tour à tour «cas limites», «borderline», «frontaliers», ces patients ont même imposé aux psychiatres la notion de «nouvelles pathologies» : psychoses camouflées, psychoses latentes, états pseudo- névrotiques. Ils entraînent la psychiatrie sur un terrain très mouvant : dans le domaine des faits cliniques, l'accord peut éventuellement se dégager ; sur les questions de techniques de soin, c'est déjà plus difficile ; quant aux options théoriques, les difficultés sont immenses, à la hauteur sans doute, des questions essentielles que ces sujets posent : limites entre psychose et névrose, c'est à dire entre l'homme normal et le fou ; faut-il dès lors élaborer la théorie d'une charnière entre névroses et psychoses ou faut-il élaborer une nouvelle théorie qui les dépasserait ? Comme on le voit, l'enjeu est considérable et concerne les capacités et les potentialités les plus profondes de l'être humain. Certains avancent l'hypothèse qu'existerait, soit la necessité d'une psychose, soit la possibilité d'une psychose. Les années à venir seront sans doute capitales dans l'avancée de ce travail qui présuppose les notions de risque et de potentialité. Le temps du démoniaque et du sacré est décidement fort loin...
Pour conclure
La psychiatrie est au carrefour de différentes disciplines : médicales, psychanalytiques, sociologiques, philosophiques, physiologiques ; ainsi, elle est partie prenante de la science du vivant : la biologie.
Son ou ses modèles dépendent des fluctuations de l'histoire et des avancées des différentes disciplines dont elle est issue. Le psychiatre est confronté, dans sa pratique, à un grand paradoxe : soigner des êtres humains «déviants» de la société tout en s'appuyant sur les acquis de notre culture et les importants progrès scientifiques des deux derniers siécles.
La psychiatrie est inscrite socialement comme une branche spécifique de la médecine. Le psychiatre est un médecin spécialiste. Cette position, parfois encombrante, nous apparait cependant comme vitale : elle exprime que la rencontre entre un patient et un médecin est marquée du sceau de la possibilité d'une thérapeutique. Ceux qui voudraient rompre le lien entre la médecine et la psychiatrie ont oublié l'histoire de la naissance de cette discipline. Ce courant est porteur d'un radicalisme erroné : il n'y aurait pas de maladie mentale, les symptômes ne sont que «sociaux», les nommer enferme l'homme dans sa supposée souffrance, la société seule en changeant résoudra ces problèmes etc... La maladie ne serait plus le produit de l'interférence entre le milieu et l'extérieur mais issue d'une faille de cet extérieur. Avant la naissance de la psychiatrie, on supposait que la folie naissait à l'intérieur du sujet sans lui appartenir. On voit que ces deux positions se rejoignent sur un point : la maladie n'appartient pas à celui qui en souffre.
Un modèle inverse nous est également proposé : au sein de la médecine, la psychiatrie devra perdre son caractère spécifique. Signes, diagnostic, traitement seraient le triptyque fondateur de la psychiatrie ; cet ordre du signe, de la causalité mécaniste ou linéaire relègueraient le champ de la vie psychique et ses vicissitudes à celui d'une vie organique coupée de sens.
Nous avons souvent repéré la co-existence de ces deux courants dans la pratique quotidienne ; non seulement les deux extrêmes peuvent se rejoindre ; ils peuvent aussi faire bon ménage et apparaître comme des solutions de repli et de confort dans des situations de grandes difficultés thérapeutiques.
Ce sont des tentations qui traversent la psychiatrie ; le dualisme guette toujours ; il stigmatiserait les concepts, ce qui ne manquerait pas d'aboutir peu ou prou à désigner le malade mental comme un objet d'expérience dont il serait exclu. Il n'existe pas d'homme malade en soi (selon le schéma bio-médical traditionnel) ou d'homme malade produit d'un système social sans réalité psychique propre.
Il n'y a pas de théorie psycho-dynamique pure, isolée du fonctionnement biologique humain. «Il n'y a pas de biologie qui ne tienne compte de ce qui peut lui apparaître comme immatériel ou illisible car alors cette biologie négligerait l'homme ; il existe des zones d'ombre, nombreuses et variées, qu'il ne faudrait plus appeler charnières ou ponts, mais dont la conflictualité devrait trouver matière, dans tous les sens du terme, à s'exprimer», nous rappelle R.Angelergues.
C'est l'introduction du sens en biologie c'est-à-dire prendre en compte pourquoi et comment les messages sont traités qui peut nous permettre d'appréhender la réalité génétique et environnementale, non comme des mécanismes conjoints et cumulatifs, mais comme des chances, des potentialités qui permettent à l'être humain d'accéder à sa singularité ; c'est dans ce sens que les psychiatres peuvent penser la maladie comme une expression créatrice, parfois la seule richesse que possède un individu.
Dernière mise à jour : dimanche 5 octobre 2003
Dr Jean-Michel Thurin