Les
administrations
Le
déploiement de la psychiatrie vers le champ de la santé mentale
se fera avec les administrations
Actuellement, la
programmation hésite entre les différents niveaux
géographiques (région, département, État), elle
multiplie les documents. La psychiatrie ne bénéficie pas toujours
d’un soutien important des services déconcentrés de
l’État ; on pourrait dire quelle est devenue, au fil des ans,
une sous-planification. La reconnaissance que la santé mentale devrait
être un domaine décliné à chaque niveau (Etat – région –
département – local) n’a jamais été fait et
assurerait pourtant des cohérences entre décideurs.
Le peu d’investissement des services déconcentrés
est à rapprocher du
problème de la réorganisation des services centraux, dont le fonctionnement en “ tuyau
d’orgues ” ne contribue pas à une clarification de la
commande mais renforce, là aussi,
la segmentation des problèmes.
Segmentation que l’on retrouve sur le plan des découpages
territoriaux : chaque service
de l’Etat (sanitaire, médico social, éducation nationale,
justice) et des collectivités locales (ASE ; circonscription, coordination
gérontologique, centres de secours etc…) dispose d’un
découpage différent, découpages auxquels s’ajoutent
maintenant les “ Pays ”.
Les professionnels de
santé publique de terrain attendent depuis des lustres de voir la DATAR,
l’INSEE ou le Commissariat général au Plan, proposer
à l’ensemble des partenaires des zonages géographiques qui
pourraient être communs à tous les intervenants en
s’emboîtant les uns dans les autres de l’aire la plus petite
à la plus grande.
Les schémas
régionaux d’organisation sanitaire (SROS) distinguent les
activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) de la
psychiatrie. Même si l’on peut noter un frémissement avec
l’adoption récente de quelques SROS de deuxième
génération unifié. L’espace sanitaire
régional, tout comme les territoires pertinents ou bassins de
santé, militent pour une planification régionale.
L’unicité du SROS (MCO, psychiatrie) gagnerait alors en
cohérence.
Les services de
l’État mettent toujours en avant la planification MCO et lui attribuent hommes et
compétences. Souvent, les autres planifications sont effectuées
de surcroît. Ici, il faut clairement établir les
responsabilités, la même exigence de service public, la même
formation des acteurs et des responsables. C’est aussi un engagement de
ces professionnels qui permettra un changement institutionnel dans
l’appareil de l’État.
La planification de
l’offre de soins psychiatriques souffre également d’une
carence majeure d’articulation avec la planification
médico-social. Dans ce domaine, la situation est
relativement semblable. Pour les prises en charge par le médico-social,
sans plans et sans programmes articulés tout peut être fait, y
compris le pire, c’est-à-dire la confusion des genres et les
créations de “ structures dépotoirs ” ou de
“ nouveaux ghettos sociaux ” ? (MAS, Foyer à
double tarification etc).
Il en va de même
pour la cohérence des Plans Régionaux d’Accès
à la Prévention et aux Soins (PRAPS), (toutes les régions,
sauf une, ont placé la Santé Mentale en priorité dans leurs
dispositifs), des Conférences de Santé et des SROS.
Tout se passe comme si
les conducteurs de ces travaux (DGS-DHOS-DGAS) poursuivaient
parallèlement des objectifs parfois identiques et parfois divergents.
Or, il existe depuis 1998 dans chaque région un comité
régional des politiques de santé où se retrouvent notamment les services de
l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes
d’assurance maladie. C’est en principe une instance de
concertation, de suivi et d’évaluation des priorités de la
conférence régionale, du PRAPS et des autres programmes
régionaux de santé. La question est de savoir si leur
efficacité a été évaluée : ces
comités remplissent-ils
pleinement leurs missions et impulsent-ils des actions ?
Plusieurs groupes de travail coordonnés
par la Direction des Hôpitaux et de l’Offre de Soins tentent
depuis bientôt dix ans, d’élaborer un programme de
médicalisation du système d’information (PMSI)
adapté à l’activité des services de psychiatrie. Les
échéances de test et de mise en application sont sans cesse
repoussées, les concepteurs eux-mêmes doutant de la pertinence de
l’outil qu’ils continuent pourtant de développer.
On peut s’inquiéter des carences
massives du plan de communication qui accompagne actuellement la mise en
œuvre de ce PMSI-Psy qui est chargé d’autant de fantasmes
qu’il est obscur, centré sur l’hospitalisation temps plein,
beaucoup trop bureaucratique dans sa mise en acte, favorisant et
renforçant les réponses hospitalières, au détriment
du travail en réseau et n’évaluant pas l’offre de
soin associative et “libérale”.
Le risque déjà annoncé et
prévu est que cet outil permettra de mettre en évidence des
"profils" d’établissements et des écarts par
rapport à une moyenne. Il ne permettra peut-être pas de
déterminer quel est le “ bon profil ” pour
répondre aux besoins de prise en charge en matière de
santé mentale aujourd’hui. D’une certaine façon le
PMSI-Psy paraît à beaucoup de professionnels comme un
“ contre sens ” et une modalité
“ impertinente ” de recueil de données.
Au-delà d’un classement des
établissements “ chers et pas chers ”, les
informations recueillies par le PMSI-Psy permettront au mieux de mettre en
évidence le fait que les prises en charge sont très différentes,
pour des patients aux caractéristiques semblables. Mais ces
résultats ne sont-ils pas déjà connus ? En effet, on
sait déjà que, selon les secteurs, des patients sont en
hospitalisation complète, d’autres en hôpital de jour,
quasiment à temps plein, d’autres en hôpital de jour
séquentiel, en CMP prolongé, d’autres dans le secteur
médico-social, et les psychiatres avouent que “ce sont les
mêmes”. Le PMSI va donc dire que ces "mêmes"
patients sont tantôt ici et tantôt là, selon les services et
les secteurs. On peut à juste titre se demander si la montagne ne va pas
accoucher d’une souris.
Il faudra obligatoirement passer par un outil
pertinent d'évaluation des pratiques des STP et RTSM. Cet outil devra
être basé sur le dossier du patient qui doit recueillir l'ensemble
des actes de soin le concernant.
L’activité d’un service
n’est pas corrélée avec son effectif de personnel. Mais
pour que le débat s’engage, il faut tout connaître et
garantir la transparence dans les équipes soignantes et à
l’extérieur. C’est le préalable à
l’égalité des français devant les soins.
Les stratégies de soin en santé mentale
s’inscrivent dans la dynamique plus vaste des évolutions
sociologiques et donc dans l’action politique au sens strict
d’ “ ensemble des options prises collectivement ou
individuellement par le gouvernement d’un Etat ou d’une
société ”[1].
L’absence de dispositif de secteur
réellement intégré dans la communauté (ce qui est
le cas de la majorité des secteurs existants), témoigne de la
carence conjuguée de volonté politique et professionnelle
à le réaliser, au profit d’un hospitalocentrisme dominant.
La décision
politique de confier la gestion du secteur psychiatrique à
l’hôpital, en 1986, est de ce point de vue une date historique de
remise en cause des principes de la sectorisation, comme de toute autre forme
de véritable psychiatrie communautaire.
Cette décision
n’a pas permis de réaliser le but poursuivi par ceux qui
l’avaient pensé au moment de l’élaboration de la
politique de sectorisation à savoir : transférer le budget des
sites hospitaliers vers la communauté.
Il faut situer la
Santé Mentale dans la dynamique générale
d’intégration, d’inclusion et tourner le dos à la
dynamique ancienne de la psychiatrie qui participait des stratégies
d’exclusion. Notons que là où les acteurs l’ont voulu
, avec quelle énergie, l’intégration dans la
communauté a été réalisée. Mais les expériences en France se sont
souvent bornées à des réalisations très partielles,
trop souvent dépendantes de l’engagement d’une ou deux
personnes motivées. Le secteur privé associatif s’est la
plupart du temps glissé dans les niches laissées en friches par
le secteur public, sans en changer son fonctionnement, aggravant en cela
l’éloignement du dispositif psychiatrique de la communauté
urbaine. La rupture avec cette perspective gestionnaire, administrative et
technicienne, impose de nouvelles organisations. Il faut déplacer le
centre de gravité de ce système de l'hôpital vers la
cité.
Cependant,
aujourd’hui, ce cours de rupture avec les stratégies de
discrimination, de ségrégation, d’exclusion se heurte
à plusieurs réalités politiques majeures :
§ la gestion du dispositif dans la conception des
logiques hospitalières donne
à l’administration des hôpitaux le pouvoir de conforter
souvent le secteur comme une excroissance de l’hôpital -
l’extra-hospitalier - et non d’administrer le secteur comme le
gérant, l’organisateur et le garant (avec la place des usagers et
de leurs associations !) d’une psychiatrie ouverte à la ville
et centrée sur la personne (sa singularité, son parcours et son
environnement) ;
§ l’instrumentalisation des sentiments
d’insécurité de la population se retrouve en
psychiatrie par la volonté de continuer à lui faire jouer
un rôle sécuritaire important ; les patients sont donc
abordés comme porteurs de danger social (troubles de l’ordre
public et à la sécurité des personnes ; nuisances par
leur être “ a-social et déviant ” et leur
maladie, ...).
§ Enfin, le point de résistance majeur
à la réalisation complète de la politique de sectorisation
est le frein serré que représente la survivance des
concentrations psychiatriques hospitalières, toujours installées dans les lieux des
anciens asiles de la fin du 19ème siècle,
qui ne peuvent, car ce serait contre nature, programmer de
l’intérieur leur transformation institutionnelle. Presque tout les en
empêche :
ü
la tradition
asilaire qui est attachée
à l’histoire de ces institutions ;
ü
l’impréparation
de l’opinion publique et la
stigmatisation encore très forte qui colle à la personne dite “ malade
mentale ” ;
ü
les formations
hospitalo-centriques de tous les
personnels (administratifs, médicaux et non médicaux) qui sont
mal préparés pour envisager leurs pratiques professionnelles dans
les perspectives d’évolution dynamique qu’imposent les
missions de santé mentale ;
ü
les fonctionnements
hiérarchiques figés,
issus directement du fonctionnement asilaire et de la tradition mandarinale
hospitalo-universitaire ;
ü
la tendance actuelle
au repli derrière les différents statuts professionnels, la technocratisation et la hiérarchisation
nocives qui aboutit à des clivages dans l’équipe
pluri-professionnelle et à la sous-utilisation des plus nombreux acteurs
du soin : les infirmiers ;
ü
la part grandissante
de la population en situation de précarité et l’état de suffocation des acteurs
sociaux (dont les dispositifs sont pour le moins difficile à
décrypter) ;
ü
la méfiance
historique de ces acteurs sociaux face à la psychiatrie (corrélée à la stigmatisation et
à l’exclusion qui s’attachent aux personnes ainsi
qu’à la frilosité du travail ambulatoire) qui se double
d’une méconnaissance de ses évolutions, le tout entretenu
par les malentendus plus ou moins volontairement mis en avant par certains
professionnels des deux champs ;
ü
l'assimilation
systématique des troubles du comportement aux troubles mentaux ;
ü
l’augmentation
croissante des demandes d’hospitalisation du fait d’urgences surchargées, du
recours parfois abusif aux internements, favorise le repli dans l’hôpital
et parfois amène à des demandes paradoxales de réouverture
de lits dans les secteurs ;
ü
la réticence
des élus locaux à mettre en œuvre ce changement de
fonctionnement des CHS, pour des
raisons d’aménagement du territoire, de craintes pour
l’emploi ou dans un souci purement clientéliste ;
ü
l’extrême
rigidité de notre société qui sait très bien empiler les
réponses en strates figées et est incapable de faire
évoluer ces réponses et encore moins de supprimer celles qui se
révèleraient inadéquates quand ce n’est pas
inopportunes.
Pourtant, il n’y
a aucun argument scientifique, thérapeutique, éthique,
économique, social au maintien des hôpitaux psychiatriques dans le
monde[2].
La tendance actuelle du système psychiatrique
français est orientée vers un éclatement des dispositifs
de soin en Santé mentale avec :
Une médecine psychiatrique qui reçoit
préférentiellement les classes aisées qui
s’adressent à la psychiatrie “ libérale ”
(nous mettons entre guillemets pour souligner la particularité de ce
privé à but lucratif, qui est financé essentiellement par
les deniers publics, par le biais des remboursements de la
Sécurité Sociale).
Cette offre de soin
est pléthorique et
protéiforme à Paris, mais aussi à Lyon, en région
PACA et dans d’autres grandes villes universitaires. Cette offre inégale sur le territoire
national entraîne des réponses inégales et n’assume
que de manière marginale ou individuelle, un rôle dans les actions
de santé publique, les soins d’urgence, les pathologies graves.
Ainsi, seuls 0,7% des actes des psychiatres
“ libéraux ” franciliens sont-ils des actes de prévention[3].
Par ailleurs, la psychiatrie “ libérale ” concerne
beaucoup plus les personnes célibataires et divorcées.
Il ne s’agit pas pour nous de
méconnaître la gêne afférente aux troubles mentaux
dits « mineurs ». Celle-ci est bien réelle et doit
être prise en compte car, en terme de santé publique, on sait
combien les troubles névrotiques par exemple sont pourvoyeurs de
dépressions graves, tentatives de suicides, conduites addictives,
surconsommation médicale, arrêts de travail etc. Mais il
n’est pas évident que certains troubles psychiques doivent
être pris en charge automatiquement ou exclusivement par des psychiatres.
La psychiatrie publique qui s’adresse, en
théorie, à toutes les populations est le plus souvent
utilisée par les catégories les moins aisées, les pauvres
et les démunis. Ce sont aussi globalement les
personnes les plus gravement atteintes psychiquement et socialement ; et
l’on connaît les liens dialectiques entre situation sociale
défavorisée et état de santé dégradé.
Les relais de la psychiatrie publique avec la psychiatrie
“ libérale ” et le champ social sont variables
d’un secteur à l’autre et globalement insatisfaisants.
Ailleurs une pratique de la psychiatrie trop
expéditive dans les durées de séjour, non articulée
à des pratiques fortes de
soins, d’insertion et d’accompagnement dans la communauté,
entraîne souvent des phénomènes d’exclusion
d’un certain nombre de patients.
Nous voyons cela dans les sorties parfois trop rapides de
l’hôpital de patients en souffrance psychique et en situation de
détresse sociale. Ils sont
alors orientés dans les structures sociales qui, sans le soutien des
équipes de soin, sont rapidement dépassées par la
problématique des troubles psychiatriques. A l’inverse les
prolongations abusives d’hospitalisations, parfois par absence de
réponses sociales adaptées, entraînent également des
situations d’exclusion.
La psychiatrie publique, qui couvre en
réalité un vaste champ, a été souvent
cantonnée ou s’est souvent réfugiée dans la
spécificité de soigner les psychotiques,
spécificité parfois revendiquée contre l’idée
même de psychiatrie ouverte aux questions des souffrances psychiques
communautaires. L’expérience montre que les résultats sont
limités. Les soins en hospitalisation sont globalement insatisfaisants.
La prise en charge de la psychose doit donc être pensée
majoritairement hors des structures d’hospitalisation.
La psychiatrie
n’est pas une discipline comme les autres.
Le paradoxe qu’elle doit résoudre est de réaliser son
intégration tout en assurant le maintien de son identité.
Pour les populations les plus exclues, il existe une
prise en charge sociale des souffrances psychiques qui entretient des liens
ténus avec la santé mentale, quand ils existent. Là encore
la situation est variable suivant les zones car il existe ici et là des
expériences innovantes et probantes. La demande de travail en commun
avec la psychiatrie énoncée par les travailleurs sociaux
n’a jamais été aussi grande.
Cette tendance à une psychiatrie à
plusieurs vitesses ne demande qu’à s’accentuer si l’on
ne prend pas les décisions politiques urgentes pour l’inverser,
c’est à dire si l’on ne redéfinit pas
l’organisation de l’ensemble de l’offre de soin.
Cependant les
avancées théoriques, l’évolution des techniques, les
résultats thérapeutiques, la volonté de nombreux
professionnels, une partie de l’opinion publique, presque tout, depuis un
demi-siècle, participe du rapprochement et d’une meilleure
intégration entre la psychiatrie et le reste de la médecine (en
ce qui concerne les psychiatres libéraux c’est fait depuis
longtemps, selon les règles du libéralisme bien
entendu).
On peut souligner un certain nombre d’erreurs commises au niveau
national, dans l’histoire récente de l’organisation de
la psychiatrie de secteur :
§
le défaut, pour
ne pas dire l’absence, par les pouvoirs publics, de conduite de la
politique annoncée ;
§
le débat, qui
est resté un débat de spécialistes, doit en sortir pour
impliquer l'ensemble de la société
§
le pouvoir de
décision concernant le développement de la sectorisation a
été confié aux établissements hospitaliers sous le
contrôle des tutelles, d’orientation plus comptable que santé publique. En effet, si on ne
s’arrête pas à quelques exemples isolés rassemblant
exceptionnellement des personnalités aux objectifs convergents, le
constat n’est pas positif, quel que soit l’établissement
hospitalier siège des secteurs de psychiatrie :
ü
Dans les
hôpitaux généraux
les secteurs qui se sont implantés, avec peu de moyens pour la plupart
d’entre eux, ont généralement vu leurs projets et leurs
moyens soumis à la concurrence inégale des projets des autres
spécialités médicales (chirurgie, radiologie…) ainsi
qu’aux logiques hospitalo-centriques qui les fondent. Il suffit pour
comprendre de se reporter, par exemple, aux différentes publications issues
de l’association PsyGé et aux interventions des professionnels des
secteurs de psychiatrie implantés dans ces structures qui
décrivent tous des situations de pénurie et de carence dans les
possibilités d’offre de soin.
ü
Dans les centres
hospitaliers spécialisés
le même constat peut être fait, avec certaines nuances cependant
dues à l’absence de concurrence avec les exigences des services
somatiques, en raison de la prévalence des logiques hospitalo-centrique
et comptable qui sont à la base du fonctionnement de beaucoup de
directions et des tutelles (quand elle ne voient pas la psychiatrie comme une
réserve de personnels).
Le résultat de
tous ces facteurs est un développement inégal des pratiques de
soin dans la communauté.
Il y a là
démonstration de l’incompatibilité actuelle entre la logique
hospitalière et la logique de développement de la psychiatrie
vers le champ de la santé mentale.
Il y a nécessité à revoir la loi de 1990 et nous
apportons ici, modestement car le sujet est d’une extrême complexité, notre
contribution à un débat qui devrait précéder
l’élaboration d’une loi nouvelle.
Le nombre des soins sous contrainte n’a pas
fortement augmenté ces dernières années, passant de 11
à 13% des hospitalisations. C’est beaucoup plus le nombre des
hospitalisations qui a augmenté alors que les durées moyennes de
séjour continuaient de décroître.
Selon une enquête,
portant sur 80% des départements français, en 1999, 13%
des entrées en secteurs de psychiatrie l’ont été
sous contrainte[4].
§
46 000 en HDT, dont 14 000 selon la procédure
d’urgence (un seul certificat médical), dont 6 400 d’une
durée de plus de 3 mois et donnant lieu à 10 262 sorties
d’essai ;
§
7.450 en HO, dont 5 000 en urgence par les maires dans le cadre
de mesure provisoire, dont 1 900 d’une durée supérieure
à 4 mois et donnant lieu à 7 115 sorties d’essai.
Au-delà des chiffres, le sens même de ces soins contraints
est à interroger.
En France on identifie
toujours, pour les traitements psychiatriques sous contrainte, la notion de
danger pour soi-même et celle de danger pour autrui. Pour nous ces deux
notions devraient être très nettement distinguées.
Le danger pour
autrui
La mise en danger
d’autrui renvoie à l’ordre public. Cette notion entre dans
le cadre des missions de chaque Etat qui doit garantir la
sécurité des citoyens par la Loi, les procédures et les
moyens pour l’appliquer. Dans un état de droit les citoyens
doivent respecter la Loi et ne pas porter atteinte aux personnes et aux biens.
La justice et la police sont là pour veiller au respect de ces lois.
Le Réseau
Européen des usagers et survivants de la psychiatrie, que nous ne suivons pas, justifie le danger pour
autrui tout en refusant la notion de soin obligatoire en cas de danger pour soi
et préfère que le placement involontaire en psychiatrie soit une
détention argumentée par la dangerosité et non un temps de
“ traitement obligatoire ” argumenté par
l’état psychiatrique de la personne concernée.
Si, pour raison de
dangerosité envers autrui, “ détention ” il
doit y avoir, celle-ci ne peut être pensée que dans un cadre
pénitentiaire (où des soins peuvent et doivent être
apportés) et non pas dans un
cadre soignant psychiatrique. On est alors dans le droit commun et il n’y
a pas lieu d’inventer des mesures spécifiques pour telle ou telle
catégorie de contrevenant.
Le danger pour soi
Par contre le danger
pour soi-même réfère aux notions de liberté
individuelle d’une part et d’assistance à personne en danger
d’autre part. Donc à la fois à la justice comme garante de
ces droits et à la santé pour les soins. En effet il s’agit
avant tout de respecter la liberté individuelle. La
société exige également des professionnels de santé
qu’ils portent assistance aux personnes en danger pour elles-mêmes
(et qui ne sont pas en mesure, pour de multiples raisons, de donner leur accord
aux soins).
Cette absence de
distinction entre danger pour soi et autrui présente
l’inconvénient de confondre les soins obligatoires et
l’ordre public, la santé et la justice.
Actuellement cette
assimilation, qui concerne uniquement les malades mentaux, est
gérée par les préfets qui ont le double pouvoir sanitaire
et de police. Il n’est pas souhaitable que cette organisation,
désormais unique en Europe, persiste.
En ce qui concerne les
soins aux personnes placées sous main de justice, et à la suite
des très nombreux ouvrages et rapports parus ces derniers mois, il ne
peut être seulement envisagé une simple adaptation de l’offre
actuelle des soins spécialisés. La question du sens que donne la
société à l’appareil pénitentiaire est au
centre de la réflexion. “ Surveiller et punir ”
résumait en son temps M. Foucault.
C’est dans la
position du naïf que nous pouvons poser la question du sens de la prison.
Pourquoi celle-ci se cantonnerait-elle à la part sécuritaire,
coercitive, punitive - légitime et importante bien entendu - de sa
mission ? Dans cette part d’enfermement des hommes,
l’expérience prouve que les cages n’ont jamais appris
à vivre, au contraire. L’autre mission essentielle de la prison
est de préparer ces hommes à un retour à la liberté
dans une perspective, apaisée, d’insertion qui éloigne la
tentation de la récidive.
L’évolution
fondamentale des orientations, des organisations et des moyens internes au
milieu pénitentiaire est un préalable indispensable.
S’il ne suffit pas
d’humaniser ou de réhabiliter les locaux, il faut en revanche
rendre décentes les conditions de vie des détenus[5].
Le débat doit être national et il est urgent, car la situation
actuelle dans les établissements est explosive.
Au Centre de
Détention des Jeunes de Fleury Mérogis, la preuve est
donnée que des modifications, sans excès, de l’organisation
du travail de surveillance ont, en un an seulement, supprimé quasi
automatiquement la violence des jeunes détenus. En Suède nous
avons visité une prison qui présentait quelques solutions
intéressantes. Mais l’on sait que les moyens y sont 6 fois plus
importants qu’en France et que 2 surveillants sur 3 sont en fait des
éducateurs.
C’est un
défi, mais comment ne pas s’y engager ? Des
établissements de petite dimension, des conditions sécuritaires
adaptées aux différentes personnes détenues et non pas les
plus strictes pour tous. Des innovations pour résoudre la contradiction
qui transforme les présumés innocents que sont les
prévenus, en détenus particulièrement
surveillés ; des regroupements semi ouverts seraient novateurs.
L’expérience,
issue du cheminement de la psychiatre des anciens asiles vers les
hôpitaux puis le travail de secteur, nous a appris que
le changement de notre regard sur les
“ aliénés ” a permis les transformations
institutionnelles radicales.
L’organisation actuelle des soins psychiatriques aux
détenus a montré ses limites et ne doit plus être prise en
exemple immuable pour l’évolution future.
Les équipes des Services Médico-Psychologiques
Régionaux (SMPR) dispensent des soins psychiatriques dans les centrales
ou les maisons d’arrêt, auprès des détenus souffrant
de problèmes psychologiques. Quand la pathologie psychiatrique devient
trop “ lourde ”, le détenu peut être
transféré en service d’hospitalisation psychiatrique, sur
ordre du Préfet (article D398 du CPP). Il revient alors aux
équipes de soins des secteurs ordinaires d’assurer à la
fois la garde du détenu et les soins psychiatriques requis.
L'article D 398 du Code de Procédure Pénale transforme
obligatoirement l'établissement de soins en établissement d'enfermement...
Il présuppose en outre que le soin psychiatrique se fera
nécessairement en pavillon fermé, ce qui n'est plus obligatoire
depuis la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 du Code de Santé Publique,
qui fait disparaître toute référence à l'enfermement
qui était juridiquement la règle sous l'empire de l'ancien texte
du 30 juin 1838."[6]
Si le détenu-patient est violent ou jugé potentiellement
dangereux, il peut être transféré en Unité pour
malades difficiles (UMD). Toutefois, les UMD n’accueillent que peu de
détenus (cf. plus loin).
Le
fonctionnement de nombreuses équipes des SMPR, au regard de
l’offre de soin proposée, paraît assez restrictif et
insuffisamment déployé dans l’espace et dans la
durée. Les équipes des actuels SMPR fonctionnent la plupart du temps
“ en vase clos ”. Cet isolement se manifeste notamment
par l’énorme difficulté à mettre en place les suivis
spécialisés après la détention, avec les CMP
concernés. Cela se manifeste aussi par des hospitalisations obligatoires
(suivant l’article D398), mal préparées, mal comprises et
souvent bâclées rapidement par les secteurs, effrayées par
l’ “ étiquette ” de détenu, et
ceci in fine au détriment
des soins aux personnes.
Il n’est plus
possible de continuer à passer sous silence que les SMPR n’ont jamais
été en mesure d’assurer, dans le cadre des
établissements pénitentiaires, des soins en hospitalisation
complète.
La grande
majorité des psychiatres travaillant en prison estiment que l’on
ne peut forcer quelqu’un à se soigner en prison, car cela correspondrait
à un doublement de la peine : rajouter une
“ peine ” psychiatrique à la peine judiciaire. Mais
la double peine ne serait-elle pas plutôt de ne pas donner de soins
à quelqu’un qui en nécessite ? En effet, personne ne remet en question la double peine
que constitue de fait, la mise en UMD ou en chambre d’isolement dans un
service de psychiatrie de secteur, avec soins imposés et pour le
moins non satisfaisants !
Sachant que 80% des
budgets de la psychiatrie en milieu carcéral vont dans les SMPR, que ceux-ci
ne sont que 26 et qu’il y a 187 établissements, il est
évident que les moyens ne sont pas donnés pour la prise en charge
psychiatrique des détenus en dehors du travail fait par les
équipes des SMPR, dont la motivation et l’engagement professionnel
sont à souligner.
Les quatre Unités
pour Malades Difficiles (UMD), situées dans les CHS et totalisant
environ 400 lits, prodiguent des soins spécialisés de
qualité à des
détenus malades mentaux, mais ne reçoivent pas que des
détenus. Le plus grand nombre d’infirmiers dans ces structures est
justifié essentiellement pour des raisons de sécurité et
non pas pour mener à bien des projets thérapeutiques.
Y sont également
hospitalisés-enfermés des “ malades
difficiles ”, ayant bénéficié d’un
non-lieu (selon l’article 122-1 du Code Pénal),
c’est-à-dire jugés irresponsables mais plus ou moins
dangereux.
Y sont
hospitalisés-enfermés une majorité de malades issus de
secteurs ordinaires, en hospitalisation d’office, sans contrôle
judiciaire suffisant, du seul fait qu'ils sont en soins contraints par
décision préfectorale et qu'ils ont, par des troubles du
comportement, débordé momentanément les capacités
contenantes des équipes de ces secteurs.
Dans une unité d’hospitalisation ordinaire la peur de la
violence potentielle entraîne souvent l'enfermement préventif, ce
dernier étant en lui-même source de violence. Et la boucle est
alors bouclée ! Une évaluation fine des situations entraînant
les transferts vers les UMD et l'utilisation plus fréquente qu'en font
certaines équipes par rapport à d’autres, justifiée
parfois d’une visée "punitive", est indispensable.
Il surtout
nécessaire qu’un débat entre professionnels ait lieu sur la
clinique qui peut s’attacher à la contention et à
l’enfermement.
Une réponse doit être apportée à la question
posée par les personnes détenues que leur état de
santé psychique rend durablement porteuses de troubles violents du
comportement et dont les soins ne peuvent être envisagés que dans
le temps de la chronicité même de la pathologie.
Mais combien sont ces personnes ? Où sont-elles actuellement?
Sont-elles regroupées dans les UMD ou bien sont-elles avec des
détenus particulièrement dangereux mais non malades mentaux ? Ces
données ne sont pas disponibles. On sait seulement que 10 à 15 %
des files actives des UMD sont constituées de détenus. On ne peut
oublier certains problèmes rares de patients très malades et très
violents pour lesquels des solutions devraient être pensées dans
le cadre de la réforme des soins obligatoires que nous proposons et en
prenant le temps d’en évaluer toutes les conséquences.
Etant
donnée l’évolution des missions et des pratiques des
équipes de secteur, il n’est plus possible de continuer à
exiger, en se voilant hypocritement la face, que ces équipes de soins
assurent en même temps la garde et les soins en structures ouvertes.
Alors que dans le même temps les équipes de soins somatiques
envisagent la création de services d’hospitalisation en
Hôpital Général, où la garde sera confiée aux
agents de l’Administration Pénitentiaire ou de la Police.
Par ailleurs le dogme,
défendu par certains psychiatres, de l’irresponsabilité
pénale des personnes malades mentaux ne peut être un argument
suffisant pour refuser de repenser l’organisation de soins adaptés
aux personnes détenues présentant des troubles mentaux.
“ La confrontation à
la justice pour l’acte commis et prouvé est chose
nécessaire pour lever le déni et contraindre le mis en cause
à s’interroger sur son propre fonctionnement ”[7].
Et “ cette antonymie
judiciaire peut provoquer une situation dans laquelle la personne
obligée perçoit, malgré sa vulnérabilité
pénalement stigmatisée, que n’est pas niée son
autonomie, qui substitue à l’obéissance à l’autre,
l’obéissance à soi-même ”[8].
A notre avis ce texte, situé dans un ouvrage sur les délinquants
sexuels, a une portée générale.
Pour
l’irresponsabilité pénale, nous pensons qu’il manque
un débat sur le concept de crime. La folie n’étant en aucun cas une cause de non
imputabilité de l’acte commis, nous prenons fermement position
pour la révision de l’article 122-1 alinéa 1. Nous sommes
pour la nécessité du procès, y compris la
possibilité d’un temps de soin préalable pour que le sujet
et citoyen “ y soit ” dans ce procès. Notons cette
contradiction qu’il n’existe pas d’irresponsabilité
civile pour les malades mentaux, en droit français, et que ceci
n’a jamais soulevé la moindre polémique.
Pour les soins
psychiatriques en prison, les mêmes principes de rapprochement avec les
soins généraux ainsi que le développement des soins de
proximité doivent sous-tendre les modifications indispensables.
La persistance de l’opposition entre les logiques de soin
(“ les psychiatres ne sont pas là pour tout
calmer ”[9]) et pénale est stérile tant au plan des
intérêts de l’individu que de ceux de la
société et mérite mieux que des anathèmes. Ceci
impose que les acteurs du soin et ceux de la justice dialoguent
intensément et sereinement :
§
en respectant les
langages et les règles de chacun,
§
en respectant les
règles des secrets professionnels de chacun,
§
en partageant des temps
de réflexion en commun.
[1] Petit Larousse
[2] Dr Benedetto SARACENO, responsable de la division santé mentale à l’OMS-Genève.
[3] Etude de l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France URMLIF février 2000
[4] Source DGS.
[5] On ne doit plus voir, par exemple, ce qu’aux Beaumettes on appelle les “ robinets marseillais ”, c’est-à-dire des cellules aux conditions d’hygiène dégradantes.
[6] Observatoire International des Prisons, 28 septembre 2000
[7] C. Balier, C. Parayre et C. Parpillon (1995),
[8] X. Lameyre (2000), reprenant P. Ricoeur
[9] Dr Paulet du SMPR des Beaumettes
suite
| Dernière mise à jour : mardi 4 septembre 2001 8:30:51 Dr Jean-Michel Thurin |
| 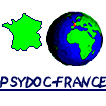
|